- un programme en L1 (traducteur ou compilateur, ces deux termes sont
synonymes) remplace chaque instruction du programme en L2 par la suite
équivalente des instructions en L1 (traduction ou compilation). L'ordinateur
exécute ensuite le programme en L1 ainsi obtenu.
- on utilise un programme en L1 (interpréteur) capable, après avoir lu
une instruction en L2, d'exécuter immédiatement la séquence en L1
équivalente. L'interprétation évite de générer un programme en L1 ;
elle a l’inconvénient d’être plus lente que l’exécution d’un
programme compilé en L1.
Du point de vue de l'utilisateur, l'ordinateur doté d'un
traducteur ou d'un interpréteur obéit aux instructions écrites en L2 aussi
docilement que si elles étaient écrites en L1 : l'ensemble constitué de
la machine physique M1, des langages L1 et L2 et de
l'interpréteur (ou du traducteur) constitue la " machine virtuelle" M2.
Lorsque l'on écrit un programme, on peut considérer que M2 est aussi
" réelle " que M1.
Il existe des limites à la complexité acceptable pour un
traducteur ou un interpréteur. De ce fait L2, bien que plus commode que L1,
peut ne pas être le langage le plus convenable pour programmer. On écrit dont en L2
un ensemble d'instructions, et on construit un nouveau langage plus commode, L3,
qui définit la nouvelle machine virtuelle M3.
Langages et machines virtuelles s'empilent ainsi jusqu'à la
couche n.
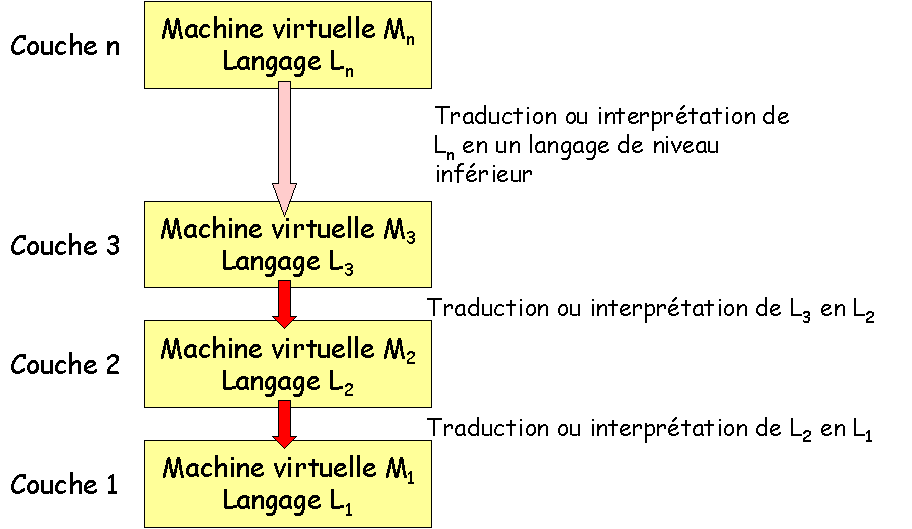
Dans les années 40, les ordinateurs n'avaient que deux couches
(ou " niveaux ") : le niveau machine traditionnel, dans lequel on programmait,
et le niveau physique qui exécutait les programmes. Les circuits de ce dernier niveau
étaient complexes, difficiles à construire et peu fiables.
Maurice Wilkes eut en 1951 l'idée de concevoir un ordinateur à
trois couches pour simplifier le matériel. La machine disposait d'un interpréteur
exécutant les programmes du niveau machine traditionnel. Le matériel ne devait plus
alors exécuter que des microprogrammes au répertoire d'instructions limité, et non des
programmes en langage machine. Les assembleurs et compilateurs furent écrits dans les
années 50. Au début des années 60, on créa les " systèmes d'exploitation ".
La plupart des ordinateurs actuels possèdent six couches :
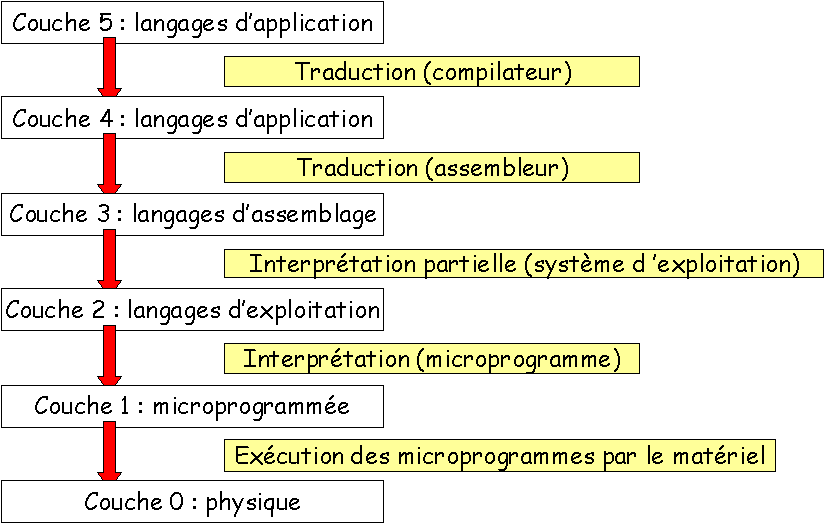
Quelqu'un qui utilise un ordinateur (par exemple en se servant
d'un traitement de texte) utilise un programme dont les instructions arrivent à la couche
physique de l'ordinateur (processeur et mémoires) à travers une cascade de traductions
et d'interprétations. Mais l'utilisateur peut ignorer ces opérations : pour lui, et dans
le cadre de cette application, l'ordinateur fonctionne comme une machine de traitement de
texte, et il n'a à connaître que cette machine virtuelle.
Une instruction du niveau applicatif, traduite ou interprétée
en cascade dans les langages des couches inférieures, engendre de nombreuses instructions
dans la couche microprogrammée. Si l'on cherche à optimiser les délais de traitement,
il faut donc programmer dans les " couches basses ". Cependant l'accroissement
des performances des processeurs et de la taille des mémoires limite l'utilité d'une
telle optimisation, sauf pour des applications où la rapidité est cruciale (certaines
applications militaires). En général on se soucie peu désormais d'optimiser
l'utilisation de la ressource physique, et les programmes sont presque tous écrits dans
des langages de niveau élevé.
Ce qui précède illustre deux des principes des modèles en
couches, qu'ils soient utilisés en représentation ou en organisation :
- l'utilisateur n'a à se soucier que du service rendu par la couche dont il se
sert, et qu'il considère comme une ressource physique (" matériel et logiciel sont
équivalents ") ;
- l'optimisation de l'utilisation des ressources se fait couche par couche, non en
considérant le processus d'ensemble.
Modèle en couches des télécommunications
Supposons que deux chimistes, l'un allemand, l'autre espagnol,
ne parlant chacun que sa propre langue, veuillent échanger une correspondance
scientifique. Ils se mettent en contact avec des traducteurs, et l'échange s'organise
ainsi :+-

Nous avons affaire à un modèle à trois couches : "
interlocuteurs " (niveau 2), " traducteurs " (niveau 1) et " Poste
" (niveau 0).
Protocole
Les interlocuteurs respectent des règles dans la rédaction de
leur correspondance : outre les formules de politesse par lesquelles ils se manifestent de
la considération, les informations qu'ils échangent doivent être conformes aux canons
de leur discipline et respecter des notations normalisées, faute de quoi leur dialogue ne
serait pas un échange scientifique (protocole de niveau 2).
Chacun reçoit des lettres écrites dans sa propre langue, et
pour lui tout se passe comme s'il correspondait avec un compatriote. Si les traducteurs
sont efficaces, les chimistes n'ont pas à s'interroger sur la qualité de la traduction
ni à corriger les contresens des traducteurs.

Les traducteurs doivent respecter un protocole entre eux : ils
se communiquent des textes dans une langue qu'ils comprennent tous deux (par exemple en
anglais). Si des difficultés de compréhension surgissent, ils doivent les régler par
des échanges complémentaires de lettres (protocole de niveau 1).
Les services postaux espagnols et allemands respectent le
protocole de tri et acheminement du courrier international (protocole de niveau 0).
Interface
Un chimiste doit organiser ses rendez-vous avec son traducteur
pour lui remettre les lettres qu'il a écrites et recevoir celles qui lui sont destinées.
Le traducteur doit mettre les lettres dans une boîte aux lettres après avoir écrit
l'adresse de l'autre traducteur, en se conformant aux conventions utilisées pour libeller
une adresse. En retour, la poste met dans sa boîte aux lettres personnelle le courrier
qui lui est destiné.
Ainsi, entre deux couches différentes, une interface doit
être respectée pour que l'information puisse transiter correctement.
Service
Il importe peu pour le chimiste de savoir qu'une lettre a été
portée par la poste : il a reçu une lettre écrite dans sa langue ; il appellera "
service de traduction " l'ensemble des fonctions remplies par la poste et par le
traducteur.
On appelle ainsi " service de niveau n " l'ensemble
des fonctions remplies par les couches de niveau inférieur ou égal à n.
Modèle OSI
Les notions de " couche ", " protocole ",
" interface " et " service " introduites ci-dessus sont au fondement
des modèles en couche des télécommunications. La répartition des fonctions entre
couches, la détermination du nombre de couches ainsi que de leur poids respectif, sont
affaire de convention. Il est cependant important pour les fournisseurs d'équipements et
exploitants de réseaux de se mettre d'accord sur un modèle normalisé, et de partager
une même définition des protocoles, interfaces, etc.
C'est pourquoi l'ISO (International Standard Organization) a
publié entre 1977 et 1986 le modèle OSI (Open Systems Interconnection) pour les réseaux
téléinformatiques. La définition des couches devait être faite de sorte :
- que les démarches de conception et de gestion du réseau puissent être
réalisées selon un ordre méthodique clair ;
- que l'optimisation globale soit correctement approchée lorsque l'on optimise
successivement chaque couche.
Le modèle OSI comprend sept couches ; nous n'entrerons pas dans
leur description fonctionnelle, mais voici le schéma d'ensemble :
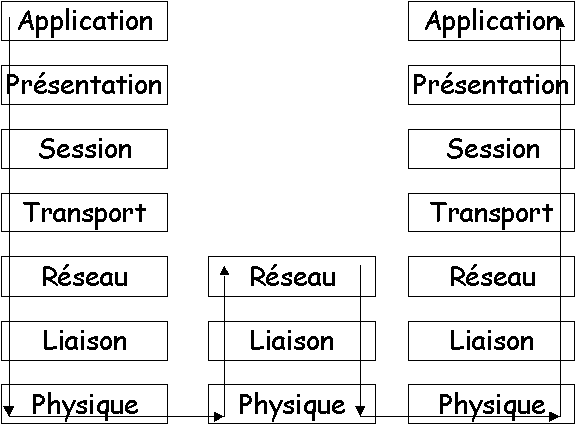
Un commutateur, représenté par la petite colonne au milieu du
dessin, rend le service " réseau " en assurant le routage des communications ;
le service "transport " assure la communication entre les deux extrémités.
2. Généralisation du modèle en couches
Le caractère technique des exemples ci-dessus ne doit pas
aveugler : le modèle en couches a une portée plus générale, y compris dans la vie
quotidienne.
Ainsi la conversation entre deux personnes emprunte les couches
suivantes : conception et compréhension des idées à communiquer (logique) ; expression
et décodage de ces idées dans un langage (sémantique) ; expression et décodage de
ce langage dans des phonèmes (phonétique) ; mécanismes de l'articulation et de
l'audition (physiologie) ; émission et réception d'ondes sonores (physique).
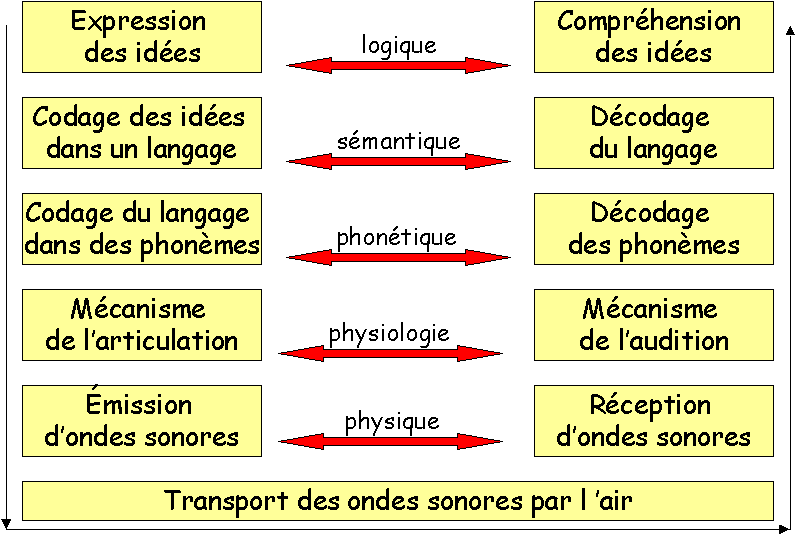
Deux personnes qui conversent utilisent chacune de ces couches
qu’elles font fonctionner alternativement dans les deux sens, mais ne s'intéressent
qu'aux idées qu'elles émettent ou reçoivent. Les couches inférieures n'attirent leur
attention que si elles fonctionnent mal :
- le passage de la couche phonétique à la couche sémantique se fait mal si l'un
des locuteurs parle une langue ignorée de l'autre ;
- des interfaces peuvent être détériorées : ce sera le cas si l'un des deux
interlocuteurs est sourd ou aphasique ;
- l’utilisation des ondes sonores n’est praticable que si les deux
interlocuteurs sont assez proches l’un de l’autre, et si le milieu sonore
ambiant n’est pas trop perturbé par le bruit.
Il suffirait d’ajouter quelques couches en bas du modèle
pour représenter une conversation par téléphone : l’onde sonore est codée
sous la forme d’une onde électromagnétique, transportée par le réseau, et
décodée à l’arrivée.
Cet exemple montre comment un modèle en couches représente un
empilage de conditions nécessaires. Si, dans un produit qui comprend des 0 et des 1, tous
les termes sont égaux à 1 sauf un qui est égal à 0, le produit sera nul. De même,
lorsqu’un phénomène obéit à plusieurs conditions nécessaires, elles doivent
toutes êtres respectées pour que le phénomène se produise. Dès lors il est vain de se
demander laquelle de ces couches est " la plus importante ", ou de
tenter d’établir entre elles une " hiérarchie " : elles sont
certes ordonnées et reliées par des interfaces, et chacune d’entre elle comporte un
protocole qui lui est propre, mais le phénomène ne peut avoir lieu que si elles
fonctionnent et communiquent toutes ensemble.
Avoir ce modèle en tête épargne des réflexions stériles.
Ainsi on tente souvent de déterminer l'origine et le responsable de la réussite d'un
processus, alors que celui-ci a traversé plusieurs couches toutes nécessaires à cette
réussite. Par ailleurs, s'il est opportun pour un manager de se concentrer sur la
question la plus importante du moment (la " contradiction
principale ", si l'on se rappelle les écrits de Mao Zedong), il n'en doit pas
moins rester attentif à la coordination de couches toutes indispensables au processus.
Son aptitude à coordonner des activités diverses se fonde sur sa perception de leur
articulation. Cette coordination n'est pas mélodique (une seule ligne dont il faut suivre
le déroulement dans le temps), mais polyphonique (plusieurs lignes qu’il faut suivre
ensemble, et qui s’articulent entre elles).
Le modèle en couches s'applique aussi aux représentations
courantes. Un paysage " naturel " se présente comme un empilage de couches : le
support géologique date de quelques millions d'années, la couverture végétale de
quelques siècles ou dizaines d'années, les constructions et routes, plus récentes, s'y
déploient et les animaux s'y déplacent. Chacune de ces couches se relie aux autres en
obéissant à sa propre logique. Il serait impossible de rendre compte d’un paysage
selon un seul langage, une seule logique, si ce n'est la logique de la superposition des
couches qui le composent.
Modèle en couches et économie
Le modèle en couches peut être utilisé pour décrire
l'économie, qu'il s'agisse du marché ou de l'organisation de l'entreprise. Nous en
proposons ci-dessous des exemples. Il existe plusieurs façons de découper les couches et
de les nommer, et nous ne prétendons pas avoir choisi ici les meilleures conventions.
Couches du marché
L'entreprise s'organise en quatre couches : conception,
distribution (ou première ligne), production, transport. Les diverses couches comprennent
deux aspects, selon que l'on considère le côté offre ou le côté demande : la
conception correspond aux besoins, la fabrication (ou production matérielle) à la
consommation, la commercialisation (détermination du prix, des canaux de vente) à la
distribution.
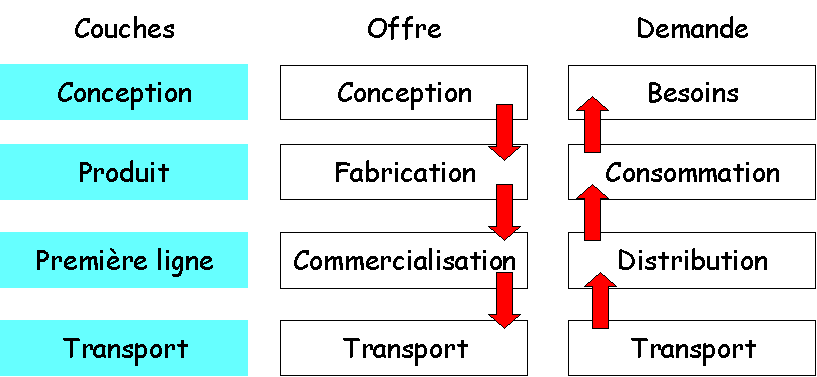
Couches du management
On peut représenter une grande entreprise par trois couches
superposées : la couche " physique ", est celle où s'opère la mise en
relation des ressources avec la production. Le maître mot est ici "dimensionnement
" : les réseaux (de données, de distribution, de voyageurs) doivent offrir des
tuyaux assez larges pour assurer le transport des flux sans pertes ni retards, des
nœuds (ordinateurs, centres de tris, installations de transformation, aéroports)
assez puissants pour accueillir les inputs, les traiter, et les expédier vers le
nœud suivant sans engorgement des files d'attentes.
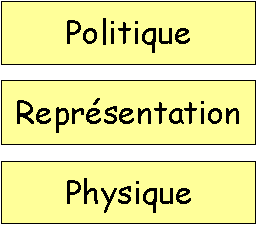
La couche " politique " est celle qui relie
l'entreprise avec les forces dont elle dépend : actionnaires, banquiers, médias,
gouvernement, administration, syndicats, etc. Sa logique est celle de la communication, de
l'image. Son enjeu est la structuration favorable du champ de forces qui entoure
l'entreprise. Elle détermine sa pérennité en confortant la crédibilité du management
et notamment le crédit que ses créanciers lui accordent.
La couche " représentation " est celle de
l'organisation interne, du partage des fonctions, pouvoirs et informations.
Une entreprise ne se pilote pas comme une machine docile (une
automobile qui tourne, ralentit, accélère conformément aux ordres du conducteur), mais
comme un véhicule capricieux dont il faut anticiper les réactions (un avion qui tourne
légèrement à gauche lorsqu'on l'engage à droite, un camion dont le centre de gravité
est placé haut et qui déverse dans les virages, etc.).
Le management de l'entreprise travaille sur ces trois couches à
la fois. Le plus souvent il est très sensible aux contraintes de la couche "
politique " et de la couche " représentation ". S'il ignore les
contraintes de la couche "physique ", elle se vengera pares pannes, des grèves
ou des clients insatisfaits. Nous reviendrons sur ces questions au chapitre XII.
Recherche et société
La compréhension de la relation entre recherche et société
est obscurcie par un antagonisme entre sociologues et techniciens. Or elle est cruciale
dans le STC, qui accorde la plus grande importance à l'innovation et à la conception.
Quiconque ose évoquer la possibilité d'une influence de la
technique sur la société se fait taxer de " technicisme " par les
sociologues. Quiconque ose évoquer un possible conditionnement social de la science se
fait taxer de " sociologisme " par les chercheurs. Ces attitudes n'empêchent
pas le sociologue de regarder la télévision, de circuler en voiture, de voyager en TGV,
d’utiliser la carte orange dans le métro parisien, voire de
" surfer " sur le " Web ", et donc
d'organiser sa propre vie en utilisant comme tout le monde les apports d'une technique
dont il réfute théoriquement l’importance pour la vie sociale ; ni le chercheur
d'orienter ses recherches selon le jugement de ses pairs, la progression de sa carrière,
et donc de se conformer à la sociologie de son milieu. Insérer une cloison entre la
connaissance des techniques et celle de la société, c’est pourtant prendre le
risque de tomber dans le piège repéré par McLuhan, et de prendre le média pour le
message. La controverse révèle d’ailleurs que ce n'est pas la connaissance qui est
en jeu, mais les intérêts de corporations se disputant influence, budgets, légitimité
etc.
Les chercheurs travaillent sur le front de taille des relations
entre la société et la nature : les recherches sur les molécules chimiques, les
propriétés de la matière (microélectronique, supraconductivité), la génétique,
ainsi que celles qui explorent les applications des technologies fondamentales,
élargissent pour le meilleur ou pour le pire le champ du possible offert à l'action.
Leurs travaux sont orientés par des mécanismes d'ordre sociologique qu’il est utile
de classer selon un modèle en couches.
En effet si le monde des chercheurs baigne, comme celui des
autres, dans le contexte sociologique général, il possède aussi une sociologie
particulière, professionnelle. Les orientations de leurs travaux ne peuvent donc
s'expliquer qu'en partie par le conditionnement sociologique général. Si l'on veut
comprendre leur orientation, il faut une analyse locale. C'est d'ailleurs ainsi que
procèdent les sociologues qui se donnent la peine d'étudier la logique de l'innovation.
La recherche est-elle tout entière dictée, comme le disent
volontiers les chercheurs, par le souci de perfectionner le rapport des hommes avec la
nature ? Non, car cette représentation ne permet pas de comprendre certaines attitudes
courantes que nous avons évoquées plus haut. Ce souci est-il totalement absent de
l'esprit des chercheurs ? Non, ne serait-ce que parce qu'il est souvent à l'origine de
leur vocation professionnelle. Mais il n'est pas indispensable de postuler que la
recherche vise intentionnellement le progrès scientifique ou technique pour en déduire
que celui-ci sera atteint dans les faits, de même qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer
une intention aux mutations génétiques pour expliquer l'évolution qu'elles provoquent.
Les travaux de recherche, orientés par une sociologie
particulière, ne sont pas endogènes à la sociologie générale, propre à l'ensemble de
la société. En outre leur portée pratique dépasse souvent les intentions des
chercheurs. Ils ont donc un caractère accidentel, exogène au social, même si la façon
dont le social s'en empare obéit à la sociologie générale. Leurs résultats tombent
sur la société comme des météorites, inattendus, difficiles à assimiler. Ils
infligent à la société des chocs et impulsent des dynamiques inédites.
Imaginons une société, avec ses strates sociales, ses rapports
de force, sa culture, ses élites etc. ; supposons qu'un gisement de pétrole, ou une
mine d'or, soient découverts sur son territoire. Cette nouvelle ressource sera l'enjeu de
conflits entre ceux qui veulent se l'approprier ; il en résultera une nouvelle
répartition de la richesse qui modifiera les structures sociales et déplacera
l'équilibre antérieur. Ceux qui anticipent un déplacement défavorable s'efforceront
d'interdire l'utilisation de cette ressource.
Mutatis mutandis, une innovation scientifique ou technique
équivaut à la découverte d'une ressource naturelle abondante et à bas coût de
production, puisqu'elle rend plus efficace la fonction de production de l'économie. Les
effets sociaux des travaux des centres de conception relèvent de cette logique. La baisse
du coût de production de la microélectronique suscite sous nos yeux une évolution de
l'organisation des entreprises et de la société dont l'Internet est l'une des
manifestations les plus visibles.
L'étude de cette dynamique nécessite une démarche attentive
à la fois aux particularités du milieu des chercheurs et concepteurs, fussent-elles
apparemment anecdotiques, et aux réactions et déformations du champ des forces sociales
"impactées " par la recherche. Cette démarche doit surmonter les
accusations croisées de " technicisme " et de " sociologisme " par
laquelle les corporations rivales cherchent à l'inhiber.