|
Chapitre II : Rendements croissants
(extrait de Michel
Volle, e-conomie, Economica 2000)
Fonction de production et fonction de coût
La
« fonction de production » d’une entreprise donne la quantité produite Y en
fonction des volumes de facteurs de production consommés : capital (K) et
travail (L) :
(1) Y =
f(K, L).
C’est
une relation entre quantités physiques, les prix n’y interviennent pas. K mesure
le volume du capital physique utilisé dans la production : on peut l’interpréter
comme un « nombre de machines ». Le travail L est la quantité de travail
consommée dans un intervalle de temps : ce sera par exemple le nombre d’heures
de travail consommées en une année. K est une variable de stock, L une variable
de flux.
On dit
que la fonction de production est à rendement constant (on encore « homogène de
degré un ») si, lorsqu’on multiplie les quantités des facteurs par un
coefficient la production est multipliée par le même coefficient :
(2) f(λK,
λL) = λf(K, L)
Lorsque
λ>1, le rendement est croissant si f(λK, λL) > λf(K, L), décroissant si f(λK,
λL) < λf(K, L). Une même fonction de production peut être à rendement croissant
sur certaines plages de valeurs de K et de L, à rendement décroissant sur
d’autres plages de valeurs.
Les économistes utilisent diverses
spécifications de la fonction de production entre lesquelles ils choisissent
selon le problème à traiter :
-
fonction de Cobb-Douglas :
Y = aKαLβ , avec a, α et β > 0.
Le rendement est :
constant si α + β = 1,
croissant si α + β > 1,
décroissant si α + β < 1.
-
fonction à élasticité de substitution
constante (CES) :
Y = a[(1 - α)K(σ -1)/ σ + α L(σ -1)/ σ ] σ /( σ - 1),
-
fonction à facteurs complémentaires :
Y = min (aKα ; bLβ).
Si l’on connaît les prix unitaires
r et w des facteurs K et L, on peut déterminer la combinaison des facteurs K et
L permettant de produire la quantité Y pour un coût minimal. On appelle
« fonction de coût » l’expression c(Y) qui associe à Y son coût minimal de
production (cf. annexe du chapitre).
Lorsque
l’on connaît la fonction de coût, on peut définir les rendements en termes de
coût. Les expressions « rendement croissant » ou « rendement décroissant »
s’appliquent alors, selon le contexte, soit au coût moyen de production, soit au
coût marginal.
Une des
formes les plus classiques de la fonction de coût est celle où la concavité de
la courbe représentative est dirigée d’abord vers le bas, puis vers le haut :
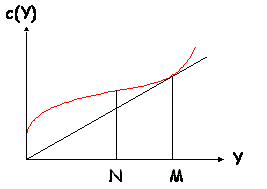
Si l’on
considère le coût moyen c(Y) = c(Y)/Y, on dira que le rendement est
croissant si c(Y) diminue lorsque la production augmente, qu’il est
décroissant dans le cas contraire. Dans le cas représenté par le graphique
ci-dessus, le rendement est croissant pour Y < M, et décroissant pour Y > M.
Si l’on
considère le coût marginal c’(Y) = dc/dY, on dira que le rendement est croissant
si c’’(Y) < 0, qu’il est décroissant si c’’(Y) > 0. Notons N l’abscisse du point
d’inflexion dans le graphique ci-dessus. Le rendement défini par référence au
coût marginal est croissant pour Y < N, et décroissant pour Y > N.
Les
deux notions sont donc compatibles, sauf si Y est compris entre N et M : dans le
cas où le rendement est d’abord croissant, puis décroissant, le changement de
signe du rendement se produit plus tôt si l’on considère le coût marginal que si
l’on considère le coût moyen.
Considérons une fonction de production « à coût fixe » : c(Y) est alors une
constante indépendante de la quantité produite. Dans ce cas, c’(Y) = c’’(Y) =
0 : l’examen du coût marginal ne donne aucune information sur le rendement ; par
contre, le coût moyen diminue indéfiniment lorsque Y croît. On est donc en
rendement croissant.
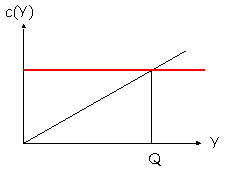
En
supposant les fonctions de production « à coût fixe » et donc le coût marginal
nul, nous sommes dans un cas extrême de rendement croissant : pour que le coût
moyen décroisse davantage lorsque le volume de la production croît, il faudrait
que le coût total décrût, hypothèse qui n’est jamais vérifiée en pratique.
Notons
c le coût fixe, supposons que le prix de vente soit p, posons Q = c/p. Si la
quantité demandée pour le prix p est supérieure à Q, l’entreprise fait un
profit ; si elle est inférieure à Q, l’entreprise fait une perte. La
confrontation entre le coût fixe et l’anticipation de demande détermine la
décision d’investissement.
L’hypothèse des rendements décroissants
Les
formulations les plus simples et les plus puissantes de la théorie économique
postulent que les fonctions de production sont à rendements
décroissants ;
lorsqu’elles admettent que la fonction de coût comporte une zone initiale à
rendement croissant, elles supposent la demande suffisamment forte pour que
l’équilibre économique conduise à produire dans la zone des rendements
décroissants.
Cette
hypothèse, dite « néoclassique », procure des résultats mathématiques puissants
fondés sur la convexité de la zone de production ; elle fonde l'équilibre de
concurrence parfaite, permet de construire des courbes d'offre (prix égal au
coût marginal), de raisonner en équilibre partiel, etc. Elle est à la base de
l’enseignement de la théorie économique. John Hicks a cru que son abandon «
ruinerait la plus grande part de la théorie économique
».
Outre
leurs vertus théoriques, les rendements décroissants existent bien sûr dans les
faits : par exemple en agriculture les parcelles sont ensemencées dans l'ordre
des fertilités décroissantes. Sont‑ils pour autant universels ? Il est prudent
de répondre à cette question par la négative, car il peut exister des secteurs
où la zone des rendements croissants s’étend jusqu’à des niveaux de production
permettant de satisfaire toute la demande ; depuis les débuts de la science
économique certains économistes ont donc exploré l'hypothèse des rendements
croissants. Cette réflexion, longtemps minoritaire, n'a jamais cessé.
Dans
les dernières décennies l'intérêt pour les rendements croissants s'est accru ;
leur théorie s'est enrichie et ses difficultés ont été prises d'assaut. La
question est d'actualité : les rendements croissants sont au cœur du procès
intenté à Microsoft par le gouvernement des États‑Unis. Les camps se forment, la
polémique fait rage.
Origines de l’hypothèse des rendements croissants
Adam
Smith explique la spécialisation et la croissance économiques par les rendements
croissants que procure la division du travail
et leur assigne pour seule limite la dimension du marché. Mais ce point de vue
fut abandonné par Ricardo et Stuart Mill, qui avaient besoin de rendements
constants pour définir l'équilibre concurrentiel et lier la valeur aux coûts de
production. A partir de ces auteurs, c’est l’hypothèse des rendements
décroissants qui est retenue par la majorité des économistes.
Cournot
développa pourtant les théories du monopole et de l'oligopole pour traiter les
situations de rendement croissant, et Marshall
lui-même les a évoquées pour fonder la théorie des externalités. Puis quelques
économistes continuent à creuser le sujet : dans les années 30, Edward
Chamberlin
et Joan Robinson
construisirent des modèles de concurrence monopoliste, c'est‑à‑dire de
concurrence avec rendements croissants. Nicholas Kaldor a étudié dans les années
1950 leurs effets sur la croissance économique.
L’intérêt pour cette voie de recherche renaît à la fin des années 70 : des
économistes américains ‑ Mike Spence, Avinash Dixit, Joe Stiglitz, Kelvin
Lancaster, Steve Salop, Paul Krugman ‑ l’utilisent essentiellement pour
perfectionner la théorie des échanges internationaux : il s'agit d'expliquer les
échanges croisés (« comment se fait‑il que simultanément la France vende des
automobiles à l'Allemagne, et l'Allemagne vende des automobiles à la France ? »)
et la localisation des industries.
Leurs travaux sont relayés en France par un théoricien de la concurrence
imparfaite comme Jean Tirole.
Brian
Arthur commence en 1979 ses recherches sur les processus stochastiques présidant
à la sélection de l'équilibre en rendements croissants
et sur l'enfermement (« lock‑in ») éventuel d'une économie dans un équilibre
inefficace en cas de choix irréversible (« path dependance »).
En 1981
Elhanan Helpman
articule les théories classiques du commerce international avec les rendements
croissants. Mike Spence
étudie les relations entre les rendements croissants et les nouvelles
technologies.
Au
début des années 80, les travaux sur le commerce international et les rendements
croissants reçoivent le nom de « nouvelle théorie du commerce ». Helpman et
Krugman en publient la synthèse.
L'étude de Paul Romer
sur les rendements croissants, la croissance économique et le « progrès
technique endogène »
devient le point de départ d’une « nouvelle théorie de la croissance ».
Apport des rendements croissants
Les
rendements croissants sont dès lors un des thèmes importants de la réflexion
économique. Si l’on suppose la fonction de production à coût fixe, le rendement
est croissant quel que soit le volume de la production ; alors le marché du bien
considéré obéit soit au régime de monopole ou d’oligopole, soit au régime de
concurrence monopoliste, mais en aucun cas au régime de concurrence parfaite.
Certains économistes, attachés à la limpidité du modèle néoclassique, peut‑être
aussi victimes du conformisme optimiste que ce modèle suscite parfois,
croient devoir continuer à douter de l’existence des rendements croissants. Il
n’est pas facile en effet, lorsque l’on s’est habitué au modèle néoclassique,
d’accepter le modèle de concurrence monopoliste qui semble a priori plus
compliqué et donc sans doute moins fécond au plan théorique en termes de rapport
entre portée des résultats et complexité des hypothèse. Mais d'autres, comme
Arrow qui a amplement prouvé sa maîtrise du modèle néoclassique, manifestent un
vif intérêt pour ces développements.
Certaines des questions soulevées par la théorie des rendements croissants sont
d’ailleurs moins nouvelles qu'on ne le dit. Ainsi, la multiplicité des
équilibres existe dans le modèle néoclassique, et il n'est donc pas besoin des
rendements croissants pour l'introduire.
Par ailleurs, les décisions des agents économiques sont souvent prises sur la
base d'anticipations erronées ou hasardeuses, et ils ne peuvent pas refaire
l'histoire lorsque les conséquences de leurs choix se révèlent négatives : on
peut donc expliquer la « path dependance » avec la théorie des anticipations,
sans faire appel aux rendements croissants. Les exemples souvent évoqués pour
illustrer le « lock‑in » peuvent être discutés indéfiniment (choix du clavier
QWERTY, des systèmes d'exploitation MS‑DOS et Windows, de la norme VHS).
On peut
dire toutefois qu’avec les rendements croissants le risque d'erreur est plus
élevé : comme tout le coût de production est payé dès le début, la part du pari
sur le futur est plus forte ; en outre, en situation de monopole, la
concentration de la décision diminue les chances de correction d’un choix
erroné. Donc si les rendements croissants n'expliquent pas seuls le « lock‑in »
ils en accroissent la probabilité.
L'apport le plus intéressant des récents travaux sur les rendements croissants
nous semble résider dans l'élucidation des formes nouvelles de concurrence ou,
plus précisément, d’un nouveau « style » économique. Reprenons un développement
de Brian Arthur
:
Avec les rendements
croissants, la concurrence ressemble à un casino. Les joueurs s'appellent
Gates, Gerstner, Grove etc. Les tables de jeu s'appellent « Multimédia », «Web
», « Paiement électronique » etc. Vous vous asseyez à une table et demandez :
«Quelle est la mise ? » Le croupier répond : « Trois milliards de dollars. » «
Qui sont les joueurs ? » « On le saura quand ils seront là. » « Quelles sont
les règles du jeu ? » «Elles se définiront d'elles‑mêmes durant la partie. » «
Quelles sont mes chances de gagner ? » « Impossible à dire. ».
Une telle partie n'est pas
pour les timides!
Expertise, capacité
financière, volonté et courage comptent, mais jusqu'à un certain point
seulement. Le succès ira au joueur capable d'extraire du brouillard
technologique les nouvelles règles du jeu, et de leur donner un sens. La
force de Bill Gates réside moins dans son expertise technique que dans son
aptitude à discerner la forme du prochain jeu.
Il
s'agit de tenir l'adversaire à distance du marché que l'on convoite. La tactique
utilise les fausses annonces, les alliances souvent renouvelées et rompues. Le
stratège doit maîtriser des effets de « feedback » négatifs ou positifs qui
s'entrelacent en un contrepoint complexe, chacun selon son propre rythme. Ce
tableau évoque l'art de la guerre de Sunzi,
qui est essentiellement l'art de déconcerter l'adversaire.
Les
polémiques récentes
Ces
nouvelles formes de concurrence suscitent un débat où les rendements croissants
et les phénomènes qui leur sont attachés sont souvent évoqués. « Wired », la
revue des « branchés » américains, appelle Gates « the Lord of Lock‑in », car
nombreux sont ceux qui pensent que Microsoft a enfermé les PC dans un système
d'exploitation sous-optimal. Les défenseurs de Microsoft nient que l'on puisse
prouver les effets négatifs du « lock‑in », et affirment que les utilisateurs
bénéficient de la baisse des prix que permettent les rendements croissants.
La
polémique s'est envenimée au début de 1998. Paul Krugman, dans un article de
« Slate », revue électronique de Microsoft, a reproché à Brian Arthur de
s'attribuer le mérite de la théorie des rendements croissants.
Arthur a vu dans cet article la riposte de Microsoft à son intervention dans une
conférence de Ralph Nader
. Arrow a écrit à Slate pour soutenir Arthur... Ces passes d'armes rappellent
les expertises économiques contradictoires publiées, avant le démembrement
d'AT&T, à propos du monopole naturel dans les télécommunications.
L’enjeu
de ces controverses n'est sans doute pas de savoir s'il existe ou non des
rendements croissants, si le lock‑in a des effets négatifs, encore moins
d'établir une antériorité entre chercheurs : il réside dans les nouvelles formes
de concurrence et de stratégie d'entreprise corrélatives des rendements
croissants, et dont Bill Gates est l'acteur le plus visible.
Le
procès intenté à Microsoft vise en première analyse à contenir un monopole de
fait des systèmes d'exploitation, progiciels et applications pour PC. Plus
profondément, il faut y voir une réaction contre le jeu économique inédit que
suscitent les rendements croissants, jeu devant lequel le droit, l'expertise,
les habitudes sont également déconcertés. Or pour maîtriser un tel jeu il ne
sert à rien de réagir contre : il faut d'abord le comprendre.
Annexe 1 : Fonction de production et fonction de coût
Définition
de la fonction de coût
Considérons une entreprise dont la fonction
de production est :
(1) Y = f(K, L)
Notons p le prix de Y, w le salaire horaire,
r la rémunération « normale » de l’utilisation d’une machine pendant un an, pK
le prix d’achat d’une machine. Supposons w et r exogènes.
La minimisation du coût de production pour
produire la quantité Y si w et r sont donnés implique des quantités K et L des
facteurs telles que :
(2) w (=) λ∂Y/∂L,
(3) r (=)λ∂Y/∂K.
(Nous utilisons le signe (=) pour noter les
égalités vérifiées à l’équilibre ; elles se distinguent des égalités comme (1)
qui représentent des définitions).
Notons c(Y) le coût de production de Y. La
fonction c(Y) est la « fonction de coût » de l’entreprise. λ est égal au coût
marginal c’(Y).
Si en outre l’entreprise maximise son profit
:
- en concurrence parfaite, le prix p est
exogène et Y doit être tel que :
(4) Y (=) c’-1(p)
- en situation de monopole (ou de
concurrence monopoliste), la demande p(Y) est exogène et Y doit être tel que :
(5) c’(Y) (=) Yp’(Y) + p(Y) ; c’(Y) est
inférieur à p(Y), car p’(Y) est négatif. Donc :
(6) p (=) µc’(Y), où µ > 1 est le « taux de
marge » par rapport au coût marginal.
Si en outre le marché est à l’équilibre
concurrentiel avec libre entrée (ce qui ne peut se produire qu’en situation de
concurrence parfaite ou de concurrence monopoliste, mais non en situation de
monopole) :
(7) pY (=) wL + rK
L’« annulation du profit » que symbolise
cette équation ne signifie pas que l’entreprise ne fasse pas de profit
comptable, ni qu’elle ne distribue pas de dividendes : le profit qu’elle dégage
permet de rémunérer les actionnaires au niveau d’équilibre compte tenu du risque
qu’ils ont pris. Il vaut mieux parler de « norme de profit » que de profit nul.
Le « taux de rentabilité interne » (TRI) de
l’entreprise est le taux d’actualisation qui annule sa « valeur actuelle nette »
(VAN) ; dans le cas considéré ici, la VAN correspondant au taux d’actualisation
T est :
(8) VAN = - pKK + (pY - wL) / T,
d’où :
(9) TRI (=) (pY - wL) / pKK
(=) r / pK = i + π,
où i est le taux d’intérêt sans risque et π
la « prime de risque » d’équilibre, c’est-à-dire la prime qui rémunère
« normalement » le risque pris par l’actionnaire ; selon la théorie du risque :
(10) π (=) β(τM – i), avec
:
(11) β = cov(X, M)/σ2M
où τM est le taux de rentabilité
interne du marché, σ X et σ M les écarts types respectifs
des rendements de l’entreprise X et du marché, cov(X, M) leur covariance.
Le prix d’utilisation r du capital est ainsi
:
(12) r (=) (i + π)pK
r n’est donc pas comme on le dit parfois
égal au taux d’intérêt du marché i. Si tout le capital avait été emprunté (ou si
les actionnaires s’étaient endettés pour le financer), il faudrait ipKK
pour payer les intérêts de l’emprunt ; la rémunération nette du capital
est donc égale à πpKK, et dépend de la prime de risque. L’équation
(12) est compatible avec une rémunération « normale » des actionnaires (que ce
soit sous forme de dividendes ou d’une plus value correspondant à
l’accroissement du capital par autofinancement). La capitalisation boursière de
l’entreprise est alors égale à la valeur pKK de son capital,
c’est-à-dire à son actif net.
Calcul de la fonction de coût
A titre d’exemple, calculons les fonctions
de coût associées aux fonctions de production classiques. Il s’agit de choisir
la combinaison (K, L) qui minimise le coût de production d’une quantité Y
donnée, w et r étant exogènes et donnés. Cela conduit à identifier la fonction
de coût c(Y) qui pour chaque quantité indique le coût de production minimal.
Fonction de Cobb-Douglas
Considérons
l’isoquante correspondant à la quantité Y : K et L sont tels que :
(13)Y = aKαLβ
Cherchons sur
cette isoquante le couple (K, L) qui minimise le coût. En ce point, il existe λ
tel que :
(14) ∂Y/∂K = aαK
α-1Lβ = λr
(15) ∂Y/∂L = aβKαLβ-1
= λw
L ’élimination de
λ entre (14) et (15) donne :
(16) aαKα-1Lβ
= aβKαLβ-1r/w
d ’où
(17) K/L =
(w/r)(α/β)
Remplaçons K dans (13) par son expression
en fonction de L ; cela donne L en fonction de Y :
(18) L = (Y/a)1/(α
+ β)[(w/r)(α/β)]- α /(α + β), et par symétrie :
(19) K = (Y/a)
1/(α + β) [(r/w)(β/α)]- β /(α + β),
d ’où le coût de
production de Y :
(20) c(Y) = wL +
rK
(21) c(Y) =
[Yw βr α(α/β) β/a]/(α+β) (α+β)/α
Cette expression
montre l’incidence, sur le coût de production, des divers paramètres α, β, w et
r. Il est intéressant d’observer la forme que prend, lorsque ces paramètres sont
fixés, la relation entre c(Y) et Y :
(22) c(Y) = γY1/(α+β),
γ étant une constante regroupant tous les termes autres que la puissance de Y.
Si α + β > 1, le
rendement en termes de coût est croissant puisque c(Y) est de la forme γYδ,
et que :
(23) δ = 1/(α +
β) < 1 (le coût de production croît moins vite que la quantité produite).
Si α + β <
1, le rendement est décroissant.
Fonction à facteurs complémentaires
(24) Y = min (aK
α ; bL β), avec a, b,
α, β > 0
Cette fonction rend compte des cas où les
quantités de facteurs à utiliser dépendent l’une de l’autre. Ici, on trouve :
(25) L = (a/b)1/ β Kα/β
et réciproquement :
(26) K = (b/a)1/ α Lβ/α
Le capital est donc une fonction puissance
du travail d’exposant β/α.
Pour produire Y,
il faut au moins (Y/a)1/α de K et (Y/b)1/β de L, d’où la
fonction de coût en supposant les coûts unitaires r et w exogènes :
(27) c(Y) =
r(Y/a)1/α + w(Y/b)1/β
Si β < 1 < α ou
α < 1 < β le rendement est tantôt croissant, tantôt décroissant.
Par exemple avec la fonction de production :
(28) Y = min (K5 ; 5L0,2)
et w = r = 1,
le coût moyen est minimal pour Y* = 3,82 et
la fonction de coût a l’allure suivante :
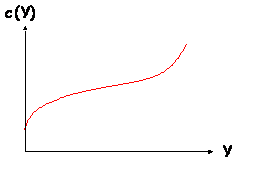
Le cas où les valeurs de α et β entourent 1
donne à la fonction de production une forme souvent rencontrée en pratique,
celle où les rendements sont d’abord croissants, puis décroissants. Il permet
aussi de construire un équilibre de concurrence parfaite avec une taille
d’entreprise non nulle, ce qui n’est pas le cas si les rendements sont
continûment décroissants (dans ce cas en effet il faut que le nombre et la
taille des entreprises soient exogènes, car sinon on trouvera que les
entreprises ont toutes la taille minimale et emploient un seul salarié).
On obtient une fonction à coût fixe à partir
de (4) en prenant β petit et α et b grands : tout se passe alors comme si le
coût du travail était (pratiquement) nul tant que Y < b, et devenait très grand
lorsque Y atteint ou dépasse b. Si l’on prend une petite valeur pour b, on
obtient une fonction de coût que nous retrouverons au chapitre VIII lorsque nous
étudierons le coût des réseaux.
Si l’on considère par exemple la fonction de
production suivante :
(29) Y = min (K100 ; 5L0,001)
et w = r = 1,
le graphe de la fonction de coût est :
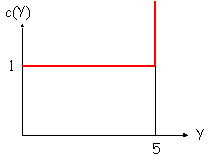
Annexe 2 : valorisation des entreprises
« La question, c’est de savoir quand la surprise partie va se terminer. Nous
n’en savons rien. La semaine dernière, c’était comme si la police avait frappé
à la porte pour nous dire de nous calmer. Mais nous avons fermé la porte, et
nous avons continué à boire et à faire la fête.
« Et quelle surboum ! Zapman n’avait pas vu un tel enthousiasme depuis les
années 20. Le bon navire Internet, à tout prendre, est aussi insubmersible que
le Titanic le jour de son lancement !
« Alors allez-y et remplissez vous la panse. J’y serai. Si vous me cherchez,
vous me trouverez assis près de la sortie ».
Zapman The wacky world of Web stocks, Who
cares if this doesn't make sense? CBS
MarketWatch, 1er mai 1999
Le texte ci-dessus est caractéristique de
l’opinion de certains investisseurs américains à la mi-99. Depuis, les cours
n’ont pas cessé de monter, ce qui accroît encore leurs angoisses. Certaines des
entreprises actives sur l’Internet, comme Amazon, n’ont apparemment jamais
dégagé de profit.
D’autres, comme eBay, sont toutes récentes. Et cependant le marché les évalue en
dizaines de milliards de dollars.
Certes, ces évaluations sont sans doute
spéculatives, excessives etc. Certes, on peut ne pas être d'accord avec les
managers qui se donnent pour seul but de « créer de la valeur »,
ce qui dans leur langage signifie non produire des biens utiles aux
consommateurs, mais faire monter le cours des actions de leur entreprise.
Certes, le zèle des néophytes de l’Internet est irritant. On peut être excédé
par les naïvetés qu’ils disent ou qu’ils font (et quand le
naïf abonde, les escrocs pullulent), mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec
l'eau du bain.
Pourquoi les actionnaires, en masse,
acceptent-ils de payer si cher (trop cher, certes) les actions des entreprises
de l’Internet ? Beaucoup d'entre eux sont sans doute des moutons de Panurge,
mais cela n'explique pas tout. Pourquoi vont-ils tous vers les NTIC (ou ce qui y
ressemble, car dans ce domaine nouveau il est difficile de distinguer le sérieux
du factice) ?
La réponse est simple : parce que les NTIC
sont très efficace ; parce que le commerce électronique, c'est une bonne façon
de faire du commerce ; parce que tout le monde pense, avec raison, que cette
nouvelle forme de commerce va prendre une part significative du marché (pas 100
%, certes, mais il suffit de quelques dizaines de pour cent du commerce pour
asseoir de belles entreprises).
___________
Nous
allons nous efforcer de classer les idées concernant l’évaluation de la valeur
des entreprises. Le développement qui suit s’enchaîne, par une sorte
d’aiguillage, à la partie « définition de la fonction de coût » de l’annexe 1
précédente. Nous reprenons donc la numérotation des relations juste après le
numéro (12) qui précédait cet aiguillage.
Le " price earning ratio " (PER) de
l’entreprise est :
(13) PER = capitalisation boursière / profit
(=) pKK / rK (=) 1/(i + π) = 1 / TRI
Si l’on suppose enfin que le profit de
l’entreprise croît au rythme annuel a, la VAN est égale à :
(14) VAN = - pKK + (pY - wL) / (T
- a), d’où le TRI :
(15) TRI = a + (pY - wL) / pKK
Observons que l’équilibre que nous venons de
décrire s’instaure sur des marchés obéissant à des dynamiques différentes. Plus
un marché est large, plus la dynamique d’ajustement du prix en cas de
déséquilibre sera lente toutes choses égales d’ailleurs, car elle nécessite la
coordination d’un plus grand nombre d’acteurs.
La dynamique la plus rapide sera celle du
cours de l’action, la moins rapide sera celle du salaire ; celle du prix du
produit est intermédiaire.
1)
la capitalisation boursière de l’entreprise est à
l’équilibre égale à la valeur de son profit futur anticipé, actualisé au taux (i
+ π). Elle varie si les actionnaires modifient leur estimation du profit
anticipé ou si le taux d’actualisation change (que ce soit i ou π qui change).
C’est sur ce marché fortement organisé que l’ajustement est le plus rapide
(mais, comme les évaluations dépendent d’anticipations par nature incertaines,
c’est aussi celui où l’ajustement est le plus incertain).
2)
le prix p du produit Y s’établit sur un marché
sectoriel, qui recouvre une partie de l’économie. Il s’ajuste plus lentement que
le prix de l’action, mais plus vite que le salaire.
3)
le salaire horaire w s’établit sur le marché du
travail qui est macroéconomique (il est sectoriel si le secteur emploie des
compétences spécialisées, ce que nous ne supposons pas ici). L’ajustement du
salaire nécessite donc une coordination plus large, et c’est lui qui se fera le
plus lentement.
Innovation incorporée au capital
Supposons que, par suite d’un progrès
technique, le prix unitaire pK des machines diminue de δpK
(ou, c’est équivalent, que la qualité des machines augmente de sorte que le même
travail puisse être fait avec moins de machines, le prix nominal des machines
restant constant) :
(16) p’K = pK - δpK
Supposons qu’à court terme le prix p du
produit et le salaire w ne sont pas modifiés, ces marchés obéissant à une
dynamique lente.
A court terme l’entreprise n’est donc pas
dans la situation d’équilibre résultant de la libre entrée, car atteindre cet
équilibre suppose le moyen ou long terme ; elle dégage donc pendant le délai
entre court et moyen-long terme un profit supérieur à celui qui rémunérerait
normalement le risque pris par les actionnaires ; nous nommerons quasi rente
ce surcroît de profit.
La quasi rente est supérieure à (i + π)δpKK
, car l’entreprise peut diminuer son coût de production par substitution du
capital au travail ; donc, sur les nouveaux projets :
(17) pY > wL + (i +
π)p’KK + (i +
π)δpKK
La quasi rente est propriété des
actionnaires, puisqu’ils sont propriétaires de l’entreprise et donc des profits
qu’elle dégage. Ils sont libres de la répartir sous forme de dividendes ou de la
réinvestir dans l’entreprise pour susciter une plus value durable.
La prime de risque apparente π’, supérieure
à la prime de risque d’équilibre π, est pour les nouveaux projets :
(18)
π’ > (i + π)pK/p’K
- i
Des déséquilibres se manifestent alors sur
plusieurs marchés. Ils suscitent à moyen terme des évolutions visant à restaurer
les équilibres :
1)
si les actionnaires estiment durable
l’accroissement du profit, le cours de l’action va croître. Les actionnaires
anciens font une plus value « extra », supérieure à celle qui accompagne
normalement l’autofinancement. Les nouveaux actionnaires, acheteurs d’actions
« d’occasion », paieront leurs actions plus cher et bénéficieront seulement dans
le futur de la prime de risque d’équilibre π.
2)
s’il y a libre entrée (ce que nous supposons), des
entreprises nouvelles vont se créer, attirées par la rentabilité π’ du capital
« frais » dans ce secteur. Cela fera diminuer le prix p.
3)
la quasi rente est constatée par les salariés. Ils
vont dans les négociations réclamer un accroissement du salaire w. Ceci ne
pourra toutefois avoir lieu que si la quasi rente s’étend à de nombreux secteurs
en raison du caractère macroéconomique du marché du travail.
A moyen et long terme, si l’on suppose
inchangés les déterminants de la prime de risque, les évolutions de p et
éventuellement de w la ramèneront à son niveau d’équilibre et l’on retrouvera la
norme de profit.
Le cours des actions correspondra alors à la
prime de risque d’équilibre ; il reviendra au niveau antérieur augmenté de la
plus value procurée par l’autofinancement.
Cette évolution inéluctable rend
problématiques les anticipations de profit des actionnaires : il se peut qu’ils
croient durable un niveau de prix qui ne pourra pourtant pas être maintenu. Dans
ce cas, ils surestiment l’entreprise, et le retour à la normale s’accompagnera
d’une baisse du cours de l’action.
A court terme, et dans l’attente des
ajustements qui ramèneront les marchés vers l’équilibre, le partage de la valeur
ajoutée se déforme en faveur des actionnaires : la diminution du prix pK
du capital entraîne en effet une substitution du capital au travail. A moyen
long terme, le partage de la valeur ajoutée revient au niveau correspondant aux
valeurs d’équilibre.
Innovation de procédé
Supposons que l’entreprise trouve un
meilleur procédé de production : elle est capable de produire avec le même
capital et le même travail une quantité Y’ > Y.
A court terme, le prix p et le salaire w ne
changent pas. Il en résulte un accroissement du profit permettant de dégager une
quasi rente :
(19) pY’ = wL + r’K, avec
r’ > (i + π)pK
On peut appliquer un raisonnement analogue
au précédent, à quelques nuances près :
1)
l’innovation de procédé s’applique non aux projets
nouveaux, mais à toute l’entreprise, puisqu’elle est supposée ne pas nécessiter
de technique nouvelle. La nouvelle prime de risque concerne donc non les
nouveaux projets, mais la totalité du capital qui se valorise d’autant.
2)
l’innovation de procédé est plus aisément mise en
œuvre dans l’ensemble du secteur que l’innovation incorporée au capital : la
dynamique d’ajustement du prix est plus rapide que celle induite par une
innovation incorporée au capital.
3)
l’innovation de procédé entraîne à court terme un
accroissement de la part du capital dans la valeur ajoutée, puisque les
actionnaires perçoivent, outre la rémunération normale du capital, une quasi
rente.
Observons enfin que dans les deux cas
(innovation incorporée au capital ou innovation de procédé) la hausse immédiate
de la prime de risque, qui entraîne rapidement une hausse du cours des actions,
n’est que temporaire : la dynamique lente des prix et des salaires la ramène
vers son niveau normal. Ainsi la quasi rente est éphémère : l’innovation, après
avoir permis aux actionnaires de réaliser des plus values, finit par bénéficier
aux consommateurs (par le biais des baisses de prix) et / ou aux salariés.
Si le flux d’innovations est renouvelé en
permanence, l’écart peut toutefois se renouveler lui-même. Tant que le flux
d’innovations se poursuit, le partage de la valeur ajoutée est plus favorable au
capital qu’à l’équilibre, et les actionnaires perçoivent la quasi rente qui
s’ajoute à leur rémunération normale.
On peut pour illustrer ce type de phénomène
utiliser le formalisme de la croissance endogène (Romer,
Arrow). Considérons un secteur où la fonction de production des entreprises est
de Cobb-Douglas, l’un des facteurs de production étant l’expérience acquise At
:
(27) Yt = aKtαLt1-αAtγ
L’expérience est, comme le capital, une
variable de stock ; dans un même secteur, on peut supposer les variables de
stock corrélées au capital. Il est alors naturel d’approcher la mesure de
l’expérience acquise par celle du capital.
L’expression de Y devient :
(28) Yt = aKtαγLt1-α
Le rendement est alors croissant (1 + γ >
1), et on est nécessairement en situation de concurrence monopoliste (certains
auteurs le pensent toutefois compatible avec la concurrence parfaite, le
rendement croissant jouant selon eux au niveau sectoriel mais non à celui de
l’entreprise considérée individuellement).
Supposons que la croissance endogène
devienne plus rapide dans le secteur considéré. La part du capital dans la
valeur ajoutée devient alors durablement supérieure, car d’après (22) :
(29) rK / pY = (αγ/(1 + γ), et α < 1.
Evolution de la capitalisation boursière
La rémunération « normale » d’une action,
c’est TRI (=) i + π, où i est le taux d’intérêt du marché et π la prime de
risque caractérisant l’entreprise considérée. (10) et (11) fournissent la valeur
d’équilibre de la prime de risque. Si l’entreprise est endettée, la prime de
risque et le risque lui-même sont modifiés par l’effet de levier ; toutefois un
actionnaire rationnel doit corriger cet effet pour évaluer l’entreprise : pour
son propre arbitrage entre rendement et risque, il est indifférent que ce soit
l’entreprise ou lui-même qui s’endette.
La capitalisation boursière d’une
entreprise, c’est-à-dire la valeur que lui attribue le marché boursier, c’est la
valeur anticipée de ses profits futurs actualisés par le TRI « normal ».
L’anticipation des profits comporte une incertitude que la prime de risque a
pour rôle de rémunérer. Cette anticipation peut en outre, si l’actionnaire fait
une erreur de jugement (hypothèse que l’on ne peut exclure s’agissant
d’anticipations), comporter un biais qui altère l’évaluation de l’entreprise.
Lorsque se produit une innovation incorporée
au capital, ou une innovation de procédé, ou encore une accélération de la
croissance endogène, le délai d’ajustement des prix ouvre un intervalle de
déséquilibre favorable au profit, donc aux actionnaires. Le marché qui
s’ajustera le plus vite, avant que les autres marchés ne soient en équilibre,
c’est le plus volatil, celui des actions. La valeur de l’action croîtra dans des
proportions diverses selon que le marché perçoit la hausse du profit comme :
-
temporaire (« bosse » avant retour au niveau
antérieur),
-
durable (« marche d’escalier » portant le
profit à un niveau où il restera),
-
extrapolable (l’accroissement récent se
prolongera).
Durant cet intervalle de déséquilibre,
l’évaluation des actions est difficile. Si le phénomène touche plusieurs
secteurs et plusieurs entreprises, le marché peut avoir des anticipations
optimistes et exiger en outre de toutes les entreprises (y compris de celles qui
ne dégagent pas de quasi rente) des profits élevés. L’évaluation des entreprises
s’écarte de la mesure de leur actif net, les entreprises jugées obsolètes
subissant une dépréciation, les entreprises innovantes bénéficiant d’une
valorisation.
La hausse du profit est synonyme d’une
modification du partage de la valeur ajoutée en faveur des actionnaires : étant
propriétaires de l’entreprise, ils sont propriétaires du profit qu’elle dégage.
S’il n’y avait pas de fluctuation du partage de la valeur ajoutée, donc du
profit, la capitalisation boursière croîtrait comme le capital des entreprises,
donc comme le PIB si l’on suppose le flux de valeur ajoutée proportionnel au
capital.
A terme toutefois, la concurrence et la
libre entrée entraînent un ajustement des prix (baisse de p d’abord, puis hausse
éventuelle de w) ramenant la rémunération du capital à son niveau normal. La
capitalisation boursière des entreprises redevient égale à la valeur de leur
actif net. L’innovation a apporté aux actionnaires une « bosse » temporaire de
revenu, mais finit par bénéficier aux consommateurs et aux salariés à travers la
baisse du prix, et éventuellement la hausse du salaire.
Le cours des actions revient à son niveau
initial, accru toutefois des plus values accumulées par autofinancement. La
quasi rente a disparu. Les actionnaires qui ont acheté lorsque les cours étaient
élevés sont évidemment les grands perdants de cette histoire.
|