|
Économie des nouvelles technologies
Chapitre 12
Obstacles au changement
Une phrase que l’on entend souvent révèle l’importance
des obstacles à surmonter : " pour mettre en place un système d’information, il
faut que le Président ou le Directeur général s’impliquent personnellement ". Il
n’en est pas de même dans les autres domaines de l’entreprise : si les décisions
d’investissement, d’organisation, sont soumises à l’approbation des dirigeants,
personne ne dit que dans ces domaines les choses ne pourront avancer que s’ils
s’impliquent.
On entend dire aussi que le système d’information
rencontre des " obstacles culturels ". Cela signifie qu’il touche aux valeurs,
aux habitudes de l’entreprise, que sa mise en œuvre suscite des questions
profondes et confuses, et provoque des résistances instinctives. Pourquoi cela ?
Enjeux de
pouvoir
Les tensions que le système d’information suscite dans
l’entreprise concernent trois pôles : les " métiers " (direction de la
production, direction commerciale etc.), l’informatique, l’" administration "
(direction générale, direction financière, contrôle de gestion).
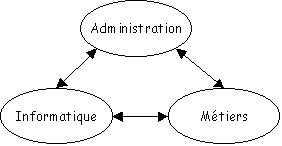
Figure 8 : pôles institutionnels du système d’information
Le modèle M2 convient bien aux métiers, car
il fait correspondre le système d’information à leur pratique. Ce pôle, qui
représente 95 % des effectifs de l’entreprise et détient son expérience
professionnelle (à l’exception de l’expérience informatique) est favorable au
passage de M1 à M2, même s’il n’en maîtrise pas les
aspects techniques.
L’informatique reste sur la défensive. Le passage de M1
à M2 implique pour elle la perte de toute ambition dans le domaine
fonctionnel, et un recentrage sur sa compétence propre. Or souvent les
directions informatiques ont cherché à empiéter sur les responsabilités
fonctionnelles des maîtrises d’ouvrage pour se rendre indispensables et éviter
l’outsourcing. Elles jugent donc le passage de M1 à M2
risqué.
Quant à l’administration de l’entreprise, il lui est
demandé d’admettre deux idées nouvelles :
- que l’usage du système d’information requiert un
professionnalisme, différent celui de l’informatique mais tout aussi
technique. Ce professionnalisme nouveau s’incorpore dans les assistances à
maîtrise d’ouvrage, qu’elle doit pourvoir en effectifs, former, et admettre
autour des tables de négociation.
- que la dialectique entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, où
chacun doit défendre ses exigences professionnelles tout en respectant celles
de l’autre, apporte à l’entreprise une dynamique utile (1). Or les directions
d’entreprise ont coutume d’éviter ces dialectiques, et de les couvrir d’un
manteau hiérarchique censé arbitrer (2).
Ajoutons que les dirigeants qui animent
l’administration n’ont souvent aucune expérience de l’informatique : ils n’ont
pas de micro-ordinateur, ignorent l’usage de la messagerie, etc. Leur
incompétence ne les empêche pas de prendre des décisions, puisque telle est leur
fonction ; seulement ces décisions seront souvent inappropriées.
Ainsi, alors que le pôle " métier " veut aller de
l’avant, le pôle " informatique " résiste et le pôle " administration " refuse.
Ce refus provoque des freinages répétés quand il faut dégager un budget ou
arbitrer les questions d’organisation. Des difficultés qui seraient, avec le
soutien de l’administration, comme de petits cailloux sur la route, deviennent
de gros rochers qui empêchent la progression.
Une
sémantique incomplète
Le système d’information alimente les tableaux de bord
de l’entreprise, et lui permet de construire son expertise. On peut représenter
cette construction par un modèle en quatre couches :

Figure 9 : couches sémantiques du système d’information
A la base se trouve l’enregistrement des faits, qui
s’opère dans le modèle M2 de façon automatique à partir des processus
(communications des clients pour un opérateur télécoms, tickets de caisse pour
un magasin, coupons de vol pour un transporteur aérien, etc.).
A partir de ces enregistrements élémentaires,
l’entreprise peut produire des indicateurs de tendance (portant sur la demande,
les coûts, le partage du marché, etc.). Il faut savoir ici surmonter divers
obstacles : faire la différence entre indicateur économique et donnée comptable,
estimer les données manquantes, analyser les séries chronologiques, corriger le
mouvement saisonnier, extraire la tendance, produire les segmentations de la
clientèle, nécessitent une compétence en production statistique de la part des
métiers, et une compétence en utilisation de la statistique du côté de
l’administration de l’entreprise, destinataire final des tableaux de bord. Or
souvent les dirigeants confondent économie et comptabilité, refusent les
corrections de variations saisonnières, etc. (3).
La recherche opérationnelle utilise les indicateurs
pour établir et tester divers modèles décrivant les comportements de la demande,
des concurrents, des fournisseurs, explorer des hypothèses et enfin éclairer la
stratégie.
L’expertise se présente sous deux formes : celle qui
est dans les têtes, celle qui est incorporée dans les outils :
- le responsable qui a longuement travaillé les données, testé les
hypothèses, exploré les scénarios, dispose d’une représentation claire de son
domaine d’action, ainsi que d’une aptitude au diagnostic qui lui permet de
voir d’un même coup d’œil les problèmes à résoudre et leur solution (4).
- le système d’information fournit à la première ligne de
l’entreprise, dans des fenêtres qui s’affichent à l’écran, des indications
permettant de traiter chaque client en tenant compte de la valeur qu’il
représente pour l’entreprise (sa " life time value ") ; il fournit aux
régulateurs une aide qui soulage leur charge mentale lorsque les problèmes
d’exploitation s’accumulent, etc.
Cette expertise se construit sur la base des
indicateurs et des modèles de la recherche opérationnelle.
Or il arrive qu’une entreprise demande au système
d’information de fournir cette expertise (dans les têtes des dirigeants, dans
les outils de la première ligne) sans pour autant la soutenir par une
statistique et une recherche opérationnelle, comme si l’expertise pouvait
découler directement de l’enregistrement des faits :
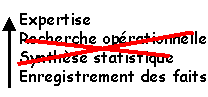
C’est comme si un opérateur télécoms voulait
économiser les câbles et les commutateurs et faire communiquer ses clients par
télépathie, comme si un transporteur aérien voulait faire voyager ses passagers
sur un tapis volant. Ces solutions ingénieuses existent en effet … dans " Les
mille et une nuits ".
Essai
d’explication
Pour expliquer cette situation, nous proposons un
modèle en trois couches : en bas se trouve la couche " économique " de
l’entreprise (on pourrait dire aussi " couche physique "), où réside la fonction
de production (capital, emploi, produits), la formation de la demande, la
formation des prix, les relations de concurrence, les partenariats, etc. C’est
ici que se trouvent les " métiers ".
En haut se trouve la couche " politique ", celle où se
nouent les relations avec les puissances extérieures et où se négocie le crédit
accordé à l’entreprise : actionnaires, banquiers (et en outre, dans le cas des
grandes entreprises publiques : ministère de tutelle, gouvernement, parlement,
Bruxelles, direction du Trésor etc.).
La couche politique a des effets économiques : il
n’est pas indifférent pour une entreprise d’être jugée " crédible " par les
marchés, car cela lui permet d’obtenir des crédits pour un prix raisonnable ;
pour Air France, il était crucial d’obtenir que l’aéroport de Roissy passe de
deux à quatre pistes, et donc de contrebalancer les associations de riverains et
les écologistes.
Entre les deux se trouve une couche de
" représentation " (que l’on peut aussi nommer " organisation "), où se
découpent les concepts qui permettent à l’entreprise de se décrire, de se
connaître, de communiquer.
Gramsci oppose deux modèles d’organisation sociale
donnant chacun l’hégémonie à l’une des deux couches extrêmes (5): l’économie, le
" business ", l’entreprise aux Etats-Unis ; l’Etat (ou plus précisément le
système politico-financier) en Europe. Dans le modèle américain, la direction de
l’entreprise colle au " business " (même si elle remplit bien sûr une fonction
politique de communication, notamment vis-à-vis des actionnaires et du marché
financier). Dans le système français, qui nous importe ici, elle colle au
politique (6).
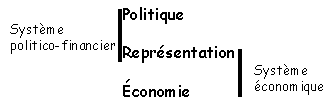
Les trois couches de l’entreprise
Dès lors le risque existe d’une coupure : la couche
politique peut vivre sur elle-même, sans contact avec la couche économique, à
laquelle elle demande seulement de fournir les signaux alimentant le jeu
politique. Dans ce cas, la couche " représentation " se coupe en deux.
La partie qui colle à la politique, et qui définit les
sphères de légitimité et la production d’images par lesquelles ces sphères se
font reconnaître, devient médiatique : la réalité économique de l’entreprise y
est représentée par son double symbolique, une image, qui mène sa vie propre
selon la mécanique de la communication, exactement comme l’image d’un homme
politique, d’une vedette, mène en tant que symbole une vie indépendante de la
vie réelle de la personne qui en est le support ou le prétexte.
Le partage du pouvoir entre dirigeants à l’intérieur
de l’entreprise obéit à la même logique médiatique ; les zones de légitimité
sont des territoires dont les frontières se défendent par des procédés
symboliques : qui figure ou non sur la liste de diffusion de telle note ; qui
participe ou non à telle réunion ; M. X prend il ou non M. Y au téléphone ; dans
quel délai M. X accorde-t-il un entretien à M. Y si celui-ci le lui demande,
etc. (7) Voilà les questions importantes !
La couche de représentation liée à l’économie de
l’entreprise n’est autre que le système d’information lui-même, qui fournit le
cadre conceptuel, l’outil d’observation et de synthèse dont elle a besoin pour
être représentée, c’est-à-dire pensable, partageable, communicable, mémorisable.
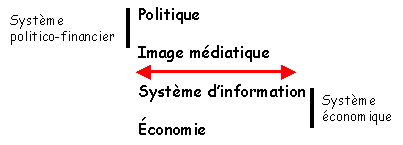
Coupure entre politique et économie
La coupure entre la couche politique et l’économie -
c’est-à-dire la coupure entre le milieu des dirigeants de l’entreprise et le
fonctionnement économique de celle-ci – est manifeste lorsque le système
d’information ne parvient pas à communiquer avec les dirigeants. La pierre de
touche est la qualité des tableaux de bord. Le fait qu’une entreprise n’accorde
pas d’importance à l’observation des faits, à leur synthèse, à l’analyse des
tendances, à la confrontation des divers modèles explicatifs, révèle que pour
ses dirigeants la légitimité se cantonne au politique, à leur image auprès des
actionnaires, des banquiers ou du gouvernement. Il est d’ailleurs bien naturel
qu’une personne se conforme aux critères de jugement de ceux à qui elle doit son
emploi.
Il arrive ainsi que les deux couches économique et
politique coexistent et mènent leur vie chacune de son côté, les frictions ne se
produisant que lorsqu’une décision économiquement nécessaire bute sur un refus à
motivations politique. Si l’on sait éviter ce type de situation, l’entreprise
peut prospérer - et d’ailleurs, nous l’avons vu, la couche politique peut avoir
une action favorable à la survie de l’entreprise.
Décision et information
On peut illustrer le raisonnement ci-dessus en
examinant la façon dont sont prises les décisions. De nouveau, nous allons
pouvoir confronter deux modèles d’entreprise, " à la Française " et " à l’Américaine "
(8).
Des dirigeants comme Robert Crandall (American
Airlines) ou Herbert Kelleher (Southwest) travaillent beaucoup pour préparer
leurs décisions (9). Crandall tient tous les lundis, pendant toute la journée,
une réunion de brainstorming avec les autres dirigeants de l’entreprise. Ils
épluchent les données, modèles, simulations concernant le comportement des
concurrents, des clients, des fournisseurs, et explorent les stratégies
possibles. Malheur à celui qui ne dispose pas à l’instant des données
nécessaires à la réflexion (10)! C’est cette méthode de travail qui a permis à
American Airlines d’inventer presque tous les procédés économiques nouveaux du
transport aérien : GDS, yield management, b-scale, etc. De même, Kelleher
procède avant d’ouvrir une navette à des études soigneuses sur les synergies
possibles entre les deux villes que la navette va relier, et l’externalité
croisée qui peut en résulter entre la navette et l’économie de ces villes.
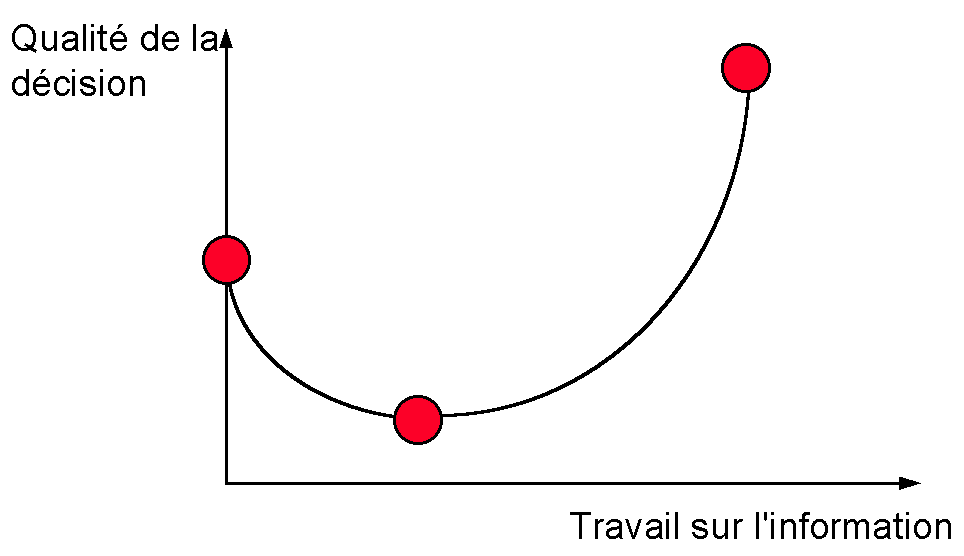
Figure 13 : système d’information et qualité de la décision
Ces dirigeants, qui travaillent beaucoup sur
l’information, sont des experts dont les réflexes sont affûtés par l’examen
anticipé des scénarios possibles et par la connaissance des ordres de grandeur
et des réactions du marché. La qualité de leurs décisions est élevée ; nous les
avons représentés par le point en haut à droite sur le graphique ci-dessus.
Le dirigeant " à la Française " vit dans le monde de
la politique ; il ne se soucie donc pas de l’information, ne réclame pas et ne
regarde pas les tableaux de bord. Il décide donc " au pif ", ce qui ne veut pas
dire que la qualité de ses décisions soit nécessairement déplorable :
l’intuition, affinée par des contacts informels avec des collaborateurs et par
des visites sur le terrain, peut permettre d’éviter les plus graves erreurs.
Cependant ses décisions ne peuvent pas avoir la précision, l’énergie, la
continuité que l’on trouve chez des dirigeants comme Crandall ou Kelleher. Nous
représentons donc le dirigeant " à la Française " par le point situé à gauche
sur le graphique (11).
Supposons que ce dirigeant, conscient de ses lacunes,
se mette à compulser des statistiques, à regarder les tableaux et les courbes.
Cet effort méritoire a d’abord un effet négatif : la fraîcheur, le bon sens qui
soutenaient son intuition sont détruits sans qu’il soit pour autant devenu un
expert. L’arbre lui cache la forêt, tel détail vu dans les tableaux de nombres
le préoccupe à l’excès. Il se trouve au point bas du graphique ci-dessus. La
qualité de ses décisions a baissé, et ses collaborateurs regrettent le temps où
il travaillait moins, mais où il était plus raisonnable.
Le dirigeant qui commence à regarder l’information
passe ainsi par une phase pénible durant laquelle ses décisions seront moins
bonnes, son intuition moins fidèle. Il fait la même expérience que le chercheur,
parti plein d’espoir sur une piste prometteuse, et qui ne peut parvenir au
résultat qu’après une période aride où ses idées simples sont détruites avant
qu’il puisse les remodeler. L’effort finira par payer s’il est poursuivi avec
sérieux - et alors le dirigeant sera devenu un expert redoutable.
Mais cet idéal n’est pas celui du dirigeant " à la
Française ", car ce n’est pas ce qu’attendent de lui les pouvoirs qui l’ont
nommé. L’expertise fonde des convictions fortes, incompatibles avec la
" souplesse " que souhaitent avant tout les politiques. Il ne perçoit donc pas
la possibilité ou l’utilité d’une position analogue à celle de Crandall ou
Kelleher. Sa position naturelle est maintenue à gauche de notre graphique, où le
rendement marginal du travail est négatif. Si l’entreprise est disciplinée, si
la légitimité des dirigeants n’est pas écornée par leur manque d’expertise (il
suffit pour cela qu’ils sachent bien jouer le rôle médiatique qui leur est
reconnu), les choses ne se passent pas trop mal - tant que l’entreprise n’est
pas en concurrence avec une autre dirigée par un expert, car alors sa direction
ne pourrait plus faire le poids.
Les trois règles du conformisme
Dans une entreprise où la direction est
essentiellement politique, les métiers eux-mêmes sont incités à s’écarter de la
rigueur professionnelle, et à obéir aux trois règles classiques du conformisme :
" Pas de vagues ", " Pas vu, pas pris ", " Après moi le déluge ".
Illustrons les par des exemples. Ceux qui évitent avec
pudeur les vérités désagréables les jugeront de mauvais goût (12), d’autres y
reconnaîtront leur expérience.
" Pas de vagues "
Le premier devoir d’un responsable est de couvrir les
fautes de ses subordonnés ; il n’y a jamais de sanctions - sauf envers ceux qui
" font des vagues ", " du zèle ", et font ainsi apparaître des problèmes qu’il
vaudrait mieux ignorer.
Le mot " compétence " possède une acception
administrative qui s’écarte de l’usage courant. En français courant, la personne
compétente est celle qui a le savoir nécessaire pour faire son travail. En
français administratif, la personne compétente pour traiter une question est
celle dont cette question relève selon l’organigramme. Lorsque la compétence
administrative entre en conflit avec la compétence du savoir, c’est à la
première que l’on donne raison, car sinon ce serait l’anarchie.
Une innovation risque toujours d’entraîner des
réorganisations, donc un changement des conditions d’utilisation de la force de
travail. La meilleure tactique pour combattre l’innovation, c’est de faire un
épouvantail des " problèmes sociaux " qu’elle risquerait de susciter. Il est
opportun de se rengorger lors de cette manœuvre (le " goitre du dirigeant "
donne à la voix un son grave) et de prendre un air très préoccupé.
" Pas vu, pas pris "
Le pouvoir ne procure de plaisir que s’il est
arbitraire. Faire appliquer une décision rationnelle, ce n’est pas vraiment du
pouvoir, puisque ceux auxquels elle s’applique peuvent y adhérer en se fondant
sur leur propre raison. Les contraindre à appliquer une décision absurde, par
contre, c’est du plaisir à l’état pur. Il serait naïf d’ignorer le penchant de
l’être humain vers de telles voluptés - qui, comme l’adultère, sont sans
conséquences pour celui qui en jouit tant qu’elles restent indécelables.
La rétention d’information, le retard des signatures,
transforment les collègues en suppliants et constituent une monnaie d’échange :
c’est ainsi que l’on édifie son pouvoir et que l’on devient quelqu’un
d’important.
Il ne faut jamais se sentir tenu par un engagement.
Prendre un engagement ne coûte rien, et permet de se débarrasser d’une trop
forte pression de la demande, l’essentiel étant que la promesse soit oubliée (ou
qu’il soit de mauvais ton de la rappeler) lorsque l’engagement arrivera à
échéance.
Si l’entreprise contraint à faire des reportings, il
faut en retarder la fourniture en alléguant les difficultés de la collecte
d’information et les urgences opérationnelles, et entourer les évaluations d’un
tel flou qu’elles échappent à toute discussion.
" Après moi, le déluge "
La légèreté des informaticiens qui ont continué à
coder les années sur deux caractères alors que l’an 2000 approchait illustre à
elle seule cette rubrique.
L’insouciance avec laquelle les entreprises poussent à
partir les " anciens " qui emportent avec eux la compétence des métiers, ainsi
que la lenteur dans l’embauche des jeunes qui apporteraient des compétences
conformes à l’état de l’art en sont un autre symptôme.
L’insouciance se trahit dans les attitudes
velléitaires qui associent discours volontariste et pratique de l'immobilisme.
La violence du discours est symptôme de velléité : l’homme volontaire n’éprouve
pas le besoin de se montrer violent.
Evolution de l’organisation
L’organisation des entreprises peut se décrire selon
trois modèles qui se conjuguent dans chaque cas particulier selon des
proportions variables.
Système des caciques (13) : A
L’entreprise A est dirigée par des " anciens ". Chacun
a durant sa carrière construit un réseau de relations et négocié sa zone
d’influence. Le directeur général est un arbitre qui veille à l’équilibre des
pouvoirs en donnant raison (et budget) tantôt à l’un, tantôt à l’autre. Il
divise pour régner. L’énergie de A se consume en négociations internes.
Les qualités demandées au personnel sont discipline,
dévouement, fidélité, égalité d’humeur. Ses compétences, acquises avant l’entrée
dans l’entreprise, y progressent peu car elles ne constituent pas un critère
d’avancement.
La dynamique de A peut coïncider par hasard avec son
intérêt à long terme. En général, A ne peut survivre que si elle est protégée.
C’était le cas des monopoles publics avant que la concurrence n’arrive.
Système rationalisé : B
L’entreprise B est divisée en centres de résultat
dotés chacun d’objectifs et d’une comptabilité permettant d’évaluer l’efficacité
des managers. Pour construire la comptabilité analytique, il a fallu poser des
conventions âprement négociées (14) ; une fois ces choix faits, la négociation
concerne la décision d’investir, que le calcul éclaire sans ambiguïté sinon sans
incertitude.
B est caractérisée par la
décentralisation des responsabilités au sein du management.
L’organigramme qui définit les entités et désigne leurs responsables est la
pièce maîtresse de l’organisation. Il doit être assez stable dans le temps pour
que l’on puisse confronter engagements et résultats.
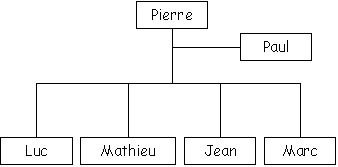
L’emblème de B (organigramme
et noms propres)
Ce système convient à des entreprises produisant en
série des produits standards, sur des marchés à évolution lente. Il facilite la
gestion des infrastructures, l’organisation d’une force de travail spécialisée,
la préparation des plans d’investissement.
Les compétences demandées sont des savoir-faire
correspondant chacun à des tâches définies. L’entreprise dispense les formations
nécessaires ; des qualifications standardisées rendent les individus
interchangeables.
Le passage de A à B a des avantages : rupture avec
l’inefficacité des caciques ; transparence facilitant la décision stratégique ;
compression des coûts. Il se fait souvent, sous la pression d’une concurrence
par les prix, pour diminuer les coûts et restaurer la marge. Il implique
l’élimination des caciques (15), la mise en place de centres de résultats et de
procédures de planification. Il comporte un changement des critères de gestion,
donc des points de repère du personnel.
Système organique : C
Pour l’entreprise C, le mot clé est processus,
au sens de " suite des opérations permettant de traiter une affaire " : un
processus part d’un événement extérieur (réclamation d’un client, demande d’un
agent) et parcourt une boucle qui se ferme lorsque cet événement extérieur a
reçu la réponse appropriée. Identifier les processus, les organiser, les
équiper, tels sont les enjeux de C.
Beaucoup de ces processus sont transverses à
l’organigramme : une structure de projet, une décision d’investissement, la
relation avec un client, demandent que s’enchaînent des opérations relevant
d’entités diverses. Alors que toute présentation de B commence par
l’organigramme, la présentation de C commence par les processus.
Pour C l'activité essentielle réside dans le système d'information.

L’emblème de C (boucle d’un processus)
La réalisation d’un processus implique une succession
de décisions. Il n’est pas possible de faire prendre chacune par la hiérarchie :
elles doivent donc être prises par le personnel. Le contrôle hiérarchique joue
a posteriori, et répond aux dysfonctionnements en adaptant le processus.
La hiérarchie est courte, le contact entre base et
sommet est facile. Le travail est qualifiant : les personnels se forment
en travaillant.Les qualités qui leur sont demandées sont l’adaptabilité
(pouvoir activer des processus divers) ; le bon sens (prendre la décision
juste face à un cas particulier imprévu) ; l’esprit de responsabilité
(assumer les décisions sans angoisse) .
Dans B, la responsabilité était décentralisée, mais
seulement au sein du management. Dans C, elle est décentralisée vers les
exécutants eux-mêmes.
Le passage de B à C est difficile. B résiste à la mise
en place des processus, d’autant plus qu’elle est mieux organisée. Pour des
entités jugées sur leurs comptes, tout échange avec l’extérieur doit en effet
être valorisé. Un processus qui traverse leur frontière doit être muni de
compteurs. Or la mesure, aisée lorsqu’il s’agit de biens, est délicate lorsqu’il
s’agit de services (comment évaluer une expertise ? si plusieurs entités
coopèrent à un processus, comment partager la responsabilité ?). Il est
difficile de mettre en place des structures de projet. Il est pratiquement
impossible de trouver le centre de résultat qui portera une dépense nécessaire
pour l’entreprise, mais qui aura un effet négatif sur ses propres comptes.
Il avait fallu casser le système des caciques pour
passer de A à B ; il faut casser le système des entités et des comptes pour
passer de B à C. Chacun de ces passages suppose sacrifices et destructions.
Culture de l’entreprise C
Dans l’entreprise C, la règle ne prend plus la forme
de consignes à appliquer automatiquement, ou d’une hiérarchie à laquelle on
obéit aveuglément, mais de processus dont la mise en œuvre suppose le traitement
responsable des cas particuliers. L’exercice de cette liberté suppose une
discipline plus intime et plus exigeante que l’obéissance à une règle.
Le fonctionnement organique de C rejoint les exigences
de la modernité (16), terme auquel nous donnons le sens suivant :
" conception du monde, et de l’insertion de la personne dans le monde, qui donne
la priorité à la liberté et à une éthique de la responsabilité ".
Dans cette phrase, le terme " personne " désigne l’être humain qui, affranchi
des caractéristiques accidentelles de son individualité (état civil,
tempérament, époque), découvre l’humanité qu’il partage avec tous et qui
est en ce sens universelle. Ce point de vue permet de fonder une réflexion
éthique rigoureuse (17).
La personne n’est pas seulement responsable de ses
actes dans le cadre du processus, mais elle est responsable aussi du processus
lui-même, qu’il faut faire évoluer. Si chacun est conscient de l’utilité des
règles, chacun doit percevoir aussi leur caractère construit, conventionnel. La
règle, la hiérarchie ne sont pas idolâtrées ; ce sont des instruments
subordonnés au service de l’entreprise.
Cette conception de la responsabilité concerne aussi
les représentations et le langage qui sert à les partager. La construction d’une
représentation est le fait d’une " intentionnalité " (18) qui reflète
à la fois la situation particulière d’une personne et l’action que cette
personne entend conduire. L’intentionnalité ne se réduit pas à l’individualisme
subjectif (la modernité rompt avec le romantisme), mais implique la prise de
conscience objective d’une situation particulière. La représentation ne se
réduit donc pas à une algèbre de concepts conditionnée sociologiquement : elle
se réfère selon un critère de pertinence à la situation particulière de
la personne et à l’action responsable dont elle vise à fournir le cadre
(19).
Cette démarche suppose une méthode permettant
de créer des règles pertinentes. L’art moderne a donné l’exemple : le créateur
définit librement, mais non arbitrairement, les règles qu’il va respecter (20).
Les exigences éthiques et intellectuelles de
l’entreprise C invitent à dépasser la trivialité et le cynisme du " business is
business ", du corporatisme, de l’autoritarisme.
Les modèles A, B et C entretiennent dans chaque
entreprise un contrepoint complexe. Dans C, avec la décentralisation des
responsabilités, la qualification par le travail, l’adaptabilité etc., le lieu
de travail rejoint la culture de notre temps. Ce n’est pas facile : la culture
de la liberté est exigeante, même si des personnes à l’esprit un peu rigide lui
trouvent les apparences du laisser-aller.
Dans B, avec l’organisation de compétences
spécialisées, c’est le règne de la règle explicite. On est dans le monde
industriel, avec sa force de travail embrigadée, son efficacité dans un cadre
fixe. Ce monde fait peu de place à la liberté et, s’il est moderne, c’est dans
un autre sens que celui que nous associons au mot " modernité ".
Un système féodal permet aux caciques de déployer leur
originalité individuelle, et la culture n’est pas absente de A – mais elle
renoue avec des formes archaïques.
La " tache
aveugle "
Les mécanismes sociologiques que nous venons de
décrire sont bien connus des cadres des entreprises, et alimentent les
conversations humoristiques ou désabusées qui se tiennent à la cafétéria – et
qu’il convient d’écouter attentivement, car elles sont symptomatiques. Si ces
mécanismes perdurent, c’est parce qu’ils ont pour racine un problème non
sociologique, mais philosophique, et donc difficile à poser simplement. Pour le
tirer au clair, nous allons devoir suivre une progression délicate.
Le système d’information d’une entreprise réside dans
l’espace des représentations, de leur production. A sa base se trouve un
socle sémantique, avec la définition des " populations " et des " individus "
qui les composent (" individus " et " populations " s’entendant ici au sens
qu’ils ont en statistique ; l’ " individu " peut être un client, une entreprise,
un franc de dépense, un îlot d’habitations, etc.), les nomenclatures selon
lesquelles s’organisent les concepts, les procédures d’identification etc.
Ce socle sémantique est mis en œuvre sur une
plate-forme technique constituée par les bases de données, la répartition des
mémoires et puissances de calcul l’architecture client serveur, les réseaux.
Cette plate-forme doit fournir une qualité de service convenable (taux de panne,
durées d’attente, coupures de communication), pour un prix acceptable : elle
doit être dimensionnée pour une " période de pointe ".
Or le dimensionnement des ressources doit anticiper
sur le comportement des utilisateurs. En effet, leur réseau n’obéit pas à
des lois déterministes ; il ne réagit pas comme un circuit hydraulique où la
transmission de la pression respecte des proportions prévisibles : l’utilisateur
d’un réseau " se comporte ", comme un automobiliste. Si une route nationale se
bouche, certains prendront leur mal en patience, d’autres la quitteront pour une
route secondaire ; la distribution de ces comportements sera aléatoire. Si le
débit des routes secondaires est suffisant ils soulageront la route nationale ;
sinon, ils encombreront aussi les routes secondaires et étendront le blocage sur
tout le réseau.
Il en est de même sur un réseau informatique. Si le
serveur de communication tombe en panne, certains utilisateurs chercheront à
passer par le serveur de télécopie ; si celui-ci est trop peu dimensionné il
tombera lui aussi en panne ; s’il est solidaire des serveurs applicatifs, la
panne se généralisera jusqu’au blocage de tout service.
Ainsi le dimensionnement doit tenir compte du
comportement des utilisateurs en cas de panne. Le calcul supposerait une
manipulation virtuose des probabilités (des trafics, des pannes, des
comportements en cas de panne etc.) à laquelle on se livre rarement. L’expertise
remplace le calcul. L’expert est déjà tombé dans les pièges et s’en est sorti, à
chaud, sous les lazzi des utilisateurs. Il a appris à anticiper, par
l’intuition, les accidents possibles sur un réseau.
Son intuition peut parfois s’exprimer de façon simple
: il peut ainsi prévoir que si une entreprise met en place un nouveau système
sans former les utilisateurs, ceux-ci commettront des erreurs, et que le " help
desk " sera surchargé de questions élémentaires.
Certaines des certitudes de l’expert sont plus
difficiles à communiquer. Supposons que l’entreprise souhaite construire un
système d’information sur sa clientèle. L’expert sait qu’il faut un répertoire
pour identifier les clients et réaliser au moindre coût les fusions de fichiers
pour rassembler toute l’information que l’on a sur un client, quelle que soit sa
source. Cependant la construction de ce répertoire a un coût et un délai, et des
managers impatients peuvent ne pas en percevoir l’utilité.
Il en sera de même des hypercubes qui accélèrent
l’utilisation des bases de données moyennant quelques limitations ; de
l’administration des données et de la modélisation des processus, qui clarifient
la sémantique d’une opération avant tout développement technique ; de
l’équipement des utilisateurs en interfaces multimédia qui élargit la gamme des
fonctionnalités possibles ; du dimensionnement de l’infrastructure de serveurs
et du réseau ; d’outils qui, comme le serveur de télécopie, économisent le temps
et l’attention de l’utilisateur ; de l’unification des messageries, qui permet à
l’utilisateur de trouver tous ses messages dans une même boîte aux lettres ; de
la documentation électronique et des forums ; de l’équipement des processus en
workflows, etc.
Sur tous ces sujets, l’expert est éclairé par une
évidence simple, aussi forte que celle qui s’impose à l’architecte qui équilibre
les forces en leur fournissant des points d’appui ; mais sauf exception cette
évidence ne sera pas partagée par les non-experts.
Pourtant d’autres expertises sont partagées par tous.
Si, dans une compagnie aérienne, quelqu’un proposait de faire voler les avions
sur le dos " parce que les passagers trouveraient cela amusant et que cela nous
distinguerait de la concurrence ", il serait déconsidéré : chacun sait que les
passagers n’apprécieraient pas cette acrobatie qui est d’ailleurs impossible.
Par contre, dans le domaine du système d’information, l’expert entend dire des
énormités qui équivalent à " faire voler des avions sur le dos ", et passent
pour des hypothèses à considérer (" on fera le répertoire en dernier ", " il ne
faut pas installer de serveur de fax parce que cela ferait croître la dépense en
télécoms ", " il ne faut pas formaliser le processus sous la forme d’un workflow
parce que cela reviendrait à graver en dur les erreurs que le processus
comporte ", " il faut des économies opérationnelles immédiates, la recherche de
la cohérence relève d’une démarche intellectuelle et donc superflue ", " la
maîtrise d’ouvrage doit être faite par l’informatique ", " l’administration des
données peut attendre la fin du développement ", " je ne crois pas à
l’Internet ", etc.).
Il est difficile de communiquer l’expertise sur le
système d’information parce qu’il s’agit d’une spécialité nouvelle. En outre, le
système d’information entoure les tâches pratiques, matérielles (faire une
réparation, livrer un produit, transporter un paquet) de représentations
fournissant la grille conceptuelle selon laquelle sont effectuées observations
et mesures. Il n’est pas facile de comprendre ce que l’on gagne en redoublant
ainsi des tâches pratiques par leur image, structurée par un cadre conceptuel.
L’efficacité matérielle d’une représentation immatérielle sera parfois perçue au
coup par coup, mais rarement dans son principe et sa généralité.
Chacun peut à la rigueur comprendre que le calendrier
de maintenance d’un équipement soit enregistré dans un programme informatique
qui édite les documents techniques, produit les " fiches de travail " permettant
de travailler dans le bon ordre (démonter une pièce, puis les pièces que ce
premier démontage dégage, exécuter les travaux sur les pièces dans l’ordre
inverse du démontage, etc.), enregistre les opérations, met à jour le programme
d’entretien etc. Mais il ne sera pas facile de comprendre que le système
d’information obéit à une " physique " qui lui est propre, celle du
dimensionnement des ressources et du modèle en couches de la représentation. Que
les contraintes de la sémantique soient aussi rigoureuses que celles de la
physique, c’est un fait que bien des managers ne sont pas prêts à reconnaître.
Lorsque l’expert exprime une évidence relevant du bon
sens, il observe le regard distrait de son interlocuteur, son empressement à
parler d’autre chose ; on lui enjoint finalement d’être " plus concret ". Cet
emploi du mot " concret " est très révélateur. Il a en effet une acception
différente selon que l’on utilise le langage philosophique, où il a un sens
technique précis, et le langage courant. Dans le langage philosophique,
" concret " s’oppose à " abstrait " comme " individuel " s’oppose à
" conceptuel ". Est concret cet objet-ci, que je peux manipuler s’il est devant
moi (cet ordinateur, cette tasse de café). Est abstrait le point de vue sous
lequel je considère un objet, et le concept sous lequel je vais le classer
(forme, poids, couleur, matière, etc.). Tout objet individuel (concret) réalise
de facto la synthèse de diverses catégories conceptuelles (abstraites).
Or dans le langage courant, " concret " est synonyme
d’ " habituel ", abstrait est synonyme de " nouveau ". Rien de plus concret,
pour un cadre qui s’inquiète de sa carrière, que des catégories comme " cadre
supérieur ", ou même " C6 ", qui n’ont de sens que dans le référentiel d’une
entreprise. Ainsi les catégories abstraites fréquemment utilisées par le
raisonnement (types d’actifs pour un financier, types d’outils pour un ouvrier,
subtilités de la mode pour une personne coquette) usurpent le caractère
" concret ".
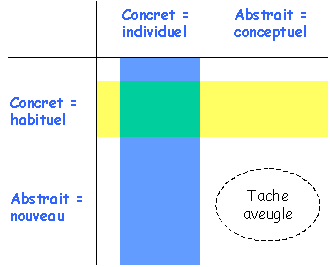
Figure 14 : place de la " tache aveugle "
Croisons les deux acceptions des termes " concret " et
" abstrait ". Chacun est à l’aise dans le monde de ses objets habituels, monde
en somme doublement concret. Les catégories abstraites dont il a l’habitude
déterminent la grille de représentation qui associe à chaque objet concret les
concepts dont il relève ; pour lui, ces catégories sont " concrètes ", car elles
délimitent ses intentions, désirs, craintes, répulsions, et confèrent un sens à
son action.
Les objets individuels dont il n’a pas l’habitude,
concrets au sens philosophique, se plient mal à sa perception parce qu’il ne
dispose pas de grille pour en rendre compte. Il ne saura pas les classer par
rapport à ses désirs, intentions etc., il ne saura pas quoi en faire. Si
ses sens les perçoivent, son entendement ne sait pas les " penser ". Ils seront
donc ignorés ou jugés " abstraits ", ce qui est une façon de dire qu’ils le
mettent mal à l’aise.
Quant aux concepts dont il n’a pas l’habitude, ils
n’existent pas. Inhabituels et imperceptibles (puisque à la différence des
objets individuels ils ne se présentent pas devant les sens), ils se trouvent
dans la " tache aveugle " de l’intellect. Leur évocation lui semble futile, du
" bavardage ", du " bruit ". Il attend qu’elle cesse pour pouvoir parler des
" choses réelles ", c’est-à-dire de celles dont il a l’habitude.
Regardez ce père de famille qui parle avec son fils de
dix-sept ans. L’adolescent vit avec ses copains, pense à son habillement, à la
musique qu’il aime. Si le père cherche à lui expliquer que ce qu’il apprend au
lycée sera utile, plus tard, dans sa vie professionnelle, il évoque quelque
chose qui se trouve très loin de ce que l’adolescent est prêt à entendre … que
le père soit éloquent, habile, clair dans ses explications n’y changera rien.
Lorsque l’interlocuteur est sourd, l’éloquence est inutile.
Jeanne Favret-Saada a bien décrit l’aveuglement devant
l’inhabituel (21):
"Les notes que je pris en 1971 d’après
la bande magnétique que j’avais enregistrée au cours de cet entretien portent
alors cette mention étonnante, significative de la surdité qui m’affecta si
souvent au cours de mon travail : " Suit une histoire inaudible [...] ".
Il me paraît invraisemblable aujourd’hui que seul ce passage ait été inaudible :
quand, plus tard, j’y entendis le ronronnement de la machine à laver des Babin,
cela ne m’empêcha pas de comprendre leurs paroles. Au pire, Joséphine m’avait
alors parlé avec un débit précipité [...]. L’hypothèse la plus probable est donc
que je ne voulais pas entendre le récit de cet épisode capital - sur lequel je
ne posai d’ailleurs aucune question - parce que de le prendre en considération
m’aurait conduite à réviser la version que je m’étais alors constituée de
l’histoire des Babin".
Nous construisons durant notre éducation la grille à
travers laquelle nous percevons le monde ; elle structure ce que nous pouvons
voir. Cette grille, imperceptible comme nos lunettes (" qui nous permettent de
voir, mais que nous ne voyons pas ", dit Heidegger), est indispensable mais nous
enferme dans les perceptions qu’elle autorise. Lorsque quelqu’un tient devant
nous un discours relevant d’une autre grille, nous cessons d’écouter, nous
sommes agacés, nous croyons perdre notre temps, nous avons hâte de retrouver le
terrain familier des représentations habituelles.
Le penseur sait interpréter ses propres réactions de
distraction, d’agacement, de surdité. Elles lui indiquent les voies par
lesquelles il pourra sortir de la prison de sa représentation, moyennant un
travail parfois pénible mais crucial. C’est d’ailleurs à cette ouverture, à
cette " simplicité " que l’on reconnaît le penseur. Mais les dirigeants ne sont
pas tous des penseurs. Ils ont reçu une formation dite supérieure, et la jugent
suffisante puisqu’elle leur a permis de " réussir ". Les représentations qui
sortent des habitudes de leur milieu leur semblent sans intérêt.
Le système d’information se trouve dans la tache
aveugle des dirigeants parce que la formation au système d’information ne fait
pas partie de leur bagage initial (22). Mais surtout la démarche qui fonde le
système d’information suppose que l’on soit libre envers les représentations,
que l’on sache les manipuler comme des instruments de l’action. Cette
relativisation des représentations, cette souplesse, vont de pair avec
l’aptitude à les reconcevoir, donc avec une attitude dont à présent seuls des
penseurs sont capables.
Pour que l’entreprise assimile la logique du système
d’information et sache en faire un instrument de l’action, il faut que ses
dirigeants deviennent dans une certaine mesure des penseurs, et qu’ils soient à
l’aise pour créer, réviser et détruire les concepts et catégories qui fondent
leurs représentations. L’importance que prend le système d’information dans la
vie des entreprises aidera cette évolution, mais celle-ci ne sera ni facile, ni
rapide.
_____________
(1) L’image qui
s’impose ici est celle de l’opposition - coopération entre le pouce et l’index,
qui permet de propulser un noyau de cerise.
(2) Des relations dialectiques existent ailleurs dans
l’entreprise (entre production et commercial, entre maintenance et
exploitation), mais elles sont subies comme un mal inévitable, et non organisées
de façon volontaire.
(3) Ils leur préfèrent souvent un indicateur fallacieux
comme " rapport entre le dernier mois et le mois correspondant de l’année
précédente ", dont l’évolution est impossible à interpréter et qui pourtant,
semble-t-il, leur " parle " davantage. Ils aiment bien aussi les " comparaisons
entre prévision et réalisation ", en nommant " prévision " l’affichage figurant
au budget.
(4) Le mathématicien exercé voit la solution
d’un problème pendant qu’il en lit l’énoncé, et n’a plus ensuite qu’à l’écrire.
Le stratège exercé voit la réponse aux manœuvres de l’ennemi, et gagne
les batailles (cf. Carl von Clausewitz, " Vom Kriege ", 1832-37).
(5) Antonio Gramsci, " Note sul Machiavelli ", Editori
Riuniti 1975. Par " hégémonie ", il faut entendre la direction politique et
intellectuelle de la société.
(6) Les élèves de l’ENA sont formés aux techniques de
l’administration (donc aux règles qui sont en France celles du jeu politique).
Le rôle occupé par certains d’entre eux dans la direction des grandes
entreprises françaises est l’un des indices qui valident ce modèle.
(7) ces deux derniers critères peuvent être représentés
par des matrices carrées à diagonale nulle et fortement dissymétriques.
(8) Il ne faut pas prendre ces qualificatifs comme des
absolus : certaines entreprises françaises travaillent paraît-il " à
l’américaine " (Suez-Lyonnaise des Eaux, SAGEM, Alcatel, Moulinex), certaines
entreprises américaines travaillent ou ont travaillé " à la française " (Pan Am,
AT&T, etc.).
(9) Thomas Petzinger, " Hard Landing ", Times Business
1996
(10) Crandall a un caractère difficile ; le seul moyen
de le tenir en respect, c’est de lui opposer un argument logique : " Some [...]
found they could bully him [...] if they had the wits to hit him
fast with a compelling intellectual argument. Logic, in the end, could snap
Crandall from a rage " (Petzinger, op. cit., p. 140). Essayez la logique avec un
dirigeant " à la française "…
(11) L’exemple vient du sommet : " Le mécanisme de
prise de décision me paraissait, depuis longtemps, constituer un des points
faibles de notre manière de gouverner " Valéry Giscard d’Estaing " Le pouvoir et
la vie " Compagnie 12 1988
(12) " Ce n’est pas la faute du miroir si tu as la
gueule de travers " Nicolaï Gogol " Les âmes mortes " 1842
(13) " roi des indigènes " (Littré).
(14) (1) contours des entités, (2) mesure de leurs
échanges mutuels, (3) prix à utiliser pour valoriser ces échanges, (4) règles
pour ventiler les frais supportés par les entités de niveau plus élevé. De tels
choix comportent un arbitraire inévitable. Ils peuvent avoir des effets pervers,
l’action se réglant non sur la production de valeur, mais sur l’obtention du
" bon " niveau des indicateurs.
(15) qui résistent : le passage de A à B ne se fait pas
sans combat.
(16) le terme " modernité " est ambigu. Il a d’abord
servi à désigner l’adaptation de l’être humain et de la société aux exigences de
la production mécanisée. Dans les thèses plus récentes sur la postmodernité et
le communautarisme, il désigne le déploiement de l'individualisme contre toute
loi commune. Ces acceptions ne sauraient convenir à l’entreprise C : elle a
dépassé l’ère de la production mécanisée, et a besoin d'une loi commune claire
et acceptée (ce que Christian Blanc traduit par " décentralisation centralisée "
: la centralisation n'est plus le fait des outils de gestion, mais résulte des
principes de l'entreprise).
(17) John Rawls " Theory of Justice " 1971
(18) on emprunte ce terme à la phénoménologie, qui
fournit son fondement philosophique à la modernité au sens retenu ici (Cf.
chapitre 14).
(19) nous nous écartons du sociologisme cher à la
" deuxième gauche " française, qui est tentée d’affirmer qu’une représentation
se construit socialement puis se soutient d’elle-même, sans avoir à être
confrontée au critère de pertinence.
(20) invention du langage (Céline, Vian, Pound), du
rythme (Bartok, Roussel), de l’espace (école du Bauhaus), du regard (Cézanne,
Klee), " table rase " libératrice (Dada), etc. Après le culte romantique de
l’émotion individuelle, la modernité a renoué avec la rigueur - non celle d’une
règle héritée de la tradition, mais celle de l’universalité personnelle et de la
responsabilité. On peut donc évoquer un " classicisme de la modernité ", et
d’ailleurs notre époque n’a pas le monopole de cette " modernité " : on peut
parler de la " modernité " de Scarlatti, Chabrier, Potocki, Montaigne,
Saint-Simon, Spinoza, Rousseau, Laclos, Stendhal etc.
(21) in " Les mots, la mort, les sorts ", Gallimard
1977, p. 233.
(22 )cela changera, mais notre économie peut-elle
s’offrir le luxe d’attendre la relève de cette génération-là ?
|