|
Le bâtiment a un avantage sur
le système d’information : quand un immeuble s’effondre, cela se voit. Combien
de nos SI sont bancals, entretenus à grands frais et à coup d’expédients ?
Combien d’entre eux sont inefficaces, imposés par la hiérarchie à des
utilisateurs dont les avis ne sont pas écoutés ?

L’effondrement d’une partie du
terminal 2E de Roissy le 23 mai 2004 donne l’image visible, donc scandaleuse, de
situations qui, dans le domaine de l’informatique, n’ont pas la même évidence.
* *
Il se peut que cet accident
s’explique par les mêmes causes qui ont conduit à équiper le bassin parisien
d’un ensemble mal fichu d’aéroports.
Il est malencontreux d’avoir
deux aéroports, Orly et Roissy, l’un au sud, l’autre au nord de Paris, entre
lesquels la liaison par train prend une heure via la correspondance à
Antony.
En outre lorsqu’il s’est agi
d’équiper Roissy, dans une plaine où a priori tout était possible, on y a
installé non pas une mais deux aérogares. La station du RER étant placée
entre elles, on ne pouvait les atteindre qu’en prenant l’autobus (on a implanté
par la suite un arrêt à Roissy 2 mais l’autobus reste nécessaire pour atteindre
Roissy 1).
Le plan de Roissy 1, avec des
terminaux en étoile autour de l’anneau central, interdit tout redimensionnement
: tel il a été conçu, tel il restera, bloqué dans sa capacité initiale. Roissy
2, lui, peut être agrandi : c’est ainsi que l’on a construit les terminaux 2E et
2F. Mais les passagers en transit doivent, pour passer d’un terminal à l’autre,
traîner leurs valises tout au long de l'aérogare ou prendre un autobus aux horaires aléatoires.
Les
aéroports parisiens n’ont pas été conçus pour les passagers en transit, ni
pour la piétaille qui emprunte le RER, mais pour les personnes qui viennent en
voiture et la garent au parking. Roissy 2 a été ainsi construit autour des parkings
: c’était négliger les encombrements de l’autoroute A1 et ne pas anticiper le
rôle de « hub » que jouent désormais les grands aéroports.
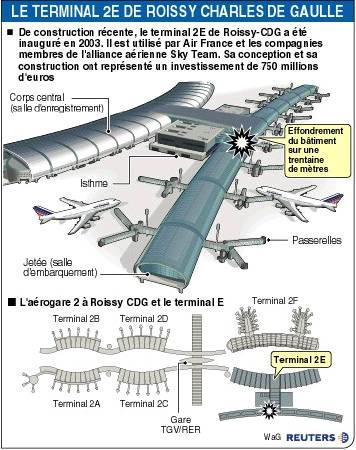
Au plan esthétique enfin
l’anneau central de Roissy 1, avec son entrecroisement de passerelles
transparentes, peut satisfaire le regard. Mais qu’en est-il des ondulations de
béton de Roissy 2 ? La perspective intérieure qu’elles procurent est rompue,
disent les puristes, par les guichets d’enregistrement et autres portiques
électroniques qu’ont installés les exploitants. C’est dire que l’aérogare serait
belle s’il n’y avait pas d’exploitants, donc ni passagers ni d’avions :
quelle conception féroce de l’architecture !
Lorsque l’on transite par
l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta, on découvre un plan en forme de gril.
Il est facile de le redimensionner en ajoutant des barres supplémentaires. Les
terminaux sont reliés, entre eux comme au terminal principal, par la navette
d’un métro automatique. Les transits sont rapides et peu fatigants. Cette
aérogare-là a la beauté de l’intelligence, cette beauté qui fait resplendir
toute architecture adéquate à sa fonction.
* *
Venons-en à l’effondrement
d’une partie de l’aérogare 2E. Comme, pour tout accident, il faut un coupable,
on le cherche. L’architecte ? Les entreprises ? Les vérificateurs ? Mais il
n’est pas besoin d’enquête pour rappeler un principe : le premier coupable,
c’est nécessairement Aéroport de Paris, maître d’ouvrage ; et si l’on tient
absolument à mettre au pilori une personne physique, ce doit être son président
et lui seul.
Le maître d’ouvrage est en
effet responsable de sa mission, de la qualité des outils qu’il met en œuvre
pour la remplir, de l'organisation dont il se dote. C’est lui qui a rédigé les
cahiers des charges, négocié les contrats, désigné le maître d’œuvre,
réceptionné les travaux. S’il y a eu un défaut de fabrication, il aurait dû le
détecter.
Quand on dit « maître
d’ouvrage », on désigne une personne morale, une entreprise, et non la personne
physique à qui l’on a donné mission de la représenter et à qui, trop souvent, l’on
refuse les moyens et la légitimité nécessaires.
La responsabilité du maître
d’œuvre et des entreprises vient en second, s’il y a eu tromperie sur la qualité
des fournitures : mais même alors le maître d’ouvrage sera coupable de ne pas
l’avoir perçue et de ne pas avoir fait corriger les défauts avant la mise en
exploitation.
* *
Il en est de même pour le
système d’information. Pourquoi plaidons-nous pour la professionnalisation de la
maîtrise d’ouvrage du SI ? Parce que la maîtrise d’ouvrage est responsable de
son organisation, de ses processus de travail et de leur automatisation, apport
spécifique du SI. Si une partie d'un SI s’effondre comme s’est effondrée une
partie de Roissy 2, ce sera de la faute de la maîtrise d’ouvrage. Comme
il lui serait alors commode de se réfugier derrière l’informatique, ou derrière
des fournisseurs qu’elle avait divisés pour mieux régner sur eux !
C’est pour pouvoir se défausser
de leur responsabilité en cas de « pépin » que des maîtrises d’ouvrage préfèrent
ignorer leur système d’information et confier sa conception à la direction
informatique de l'entreprise ou, pis encore, à une SSII. Cette démission est une
faute systémique plus grave, par ses conséquences, que l’étourderie ou la
négligence qui auront causé le « pépin ». |