|
Chapitre XII : Obstacles au changement
(extrait de Michel
Volle, e-conomie, Economica 2000)
On entend souvent prononcer une phrase qui révèle
l'importance des obstacles à surmonter : " pour mettre en place un système
d'information, il faut que le Président ou le Directeur général s'impliquent
personnellement ". Il n'en est pas de même dans les autres domaines de l'entreprise
: si les décisions d'investissement, d'organisation, sont soumises à l'approbation des
dirigeants, personne ne dit que dans ces domaines les choses ne pourront avancer que s'ils
s'impliquent.
On entend dire aussi que le progrès du système d'information
rencontre des " obstacles culturels ". Cela signifie qu'il touche aux
valeurs, aux habitudes de l'entreprise, que sa mise en œuvre suscite des questions
profondes et confuses, et provoque des résistances instinctives. Pourquoi cela ?
1. Enjeux de pouvoir
Les tensions que le système d'information suscite concernent
trois pôles de l’entreprise : les " métiers " (direction de la
production, direction commerciale etc.), l'informatique, l'" administration "
(direction générale, direction financière, contrôle de gestion).
Pôles institutionnels du système d'information
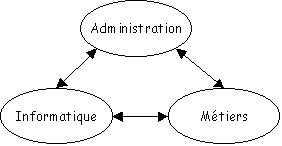
Le modèle M2 décrit au chapitre XI, fondé sur les processus,
convient bien aux métiers, car il fait correspondre le système d'information à leur
pratique. Ce pôle, qui représente 95 % des effectifs de l'entreprise et détient son
expérience professionnelle (à l'exception de l'expérience informatique) est favorable
au passage de M1 à M2 même s'il n'en maîtrise pas les aspects techniques.
L'informatique reste cependant sur la défensive. Le passage de
M1 à M2 implique pour elle la perte de toute ambition dans le domaine fonctionnel et un
recentrage sur sa compétence propre. Or souvent les directions informatiques ont cherché
à empiéter sur les responsabilités fonctionnelles des maîtrises d'ouvrage pour se
rendre indispensables et éviter ainsi l'outsourcing, ou simplement par goût instinctif
du pouvoir. Elles jugent donc le passage de M1 à M2 risqué.
Quant à l'administration de l'entreprise, il lui est demandé
d'admettre deux idées nouvelles :
- que l'usage du système d'information requiert un
professionnalisme, différent celui de l'informatique mais tout aussi technique. Ce
professionnalisme nouveau s'incorpore dans les assistances à maîtrise d'ouvrage qu'elle
doit pourvoir en effectifs, former, et admettre autour des tables de négociation,
- que la dialectique entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'œuvre, où chacun doit défendre ses exigences professionnelles tout en respectant
celles de l'autre, apporte à l'entreprise une dynamique utile. Or les directions
d'entreprise ont coutume d'éviter ces dialectiques et de les couvrir d'un manteau
hiérarchique censé arbitrer.
Ajoutons que les dirigeants qui animent l'administration n'ont
souvent aucune expérience de l'informatique : ils n'ont pas de micro-ordinateur, ignorent
l'usage de la messagerie, etc. Leur incompétence ne les empêche pas de prendre des
décisions, puisque telle est leur fonction ; seulement ces décisions seront souvent
inappropriées.
Ainsi, alors que le pôle " métier " veut aller de
l'avant, le pôle " informatique " résiste et le pôle "
administration " refuse. Ce refus provoque des freinages répétés quand il faut
dégager un budget ou arbitrer les questions d'organisation. Des difficultés qui
seraient, avec le soutien de l'administration, comme de petits cailloux sur la route,
deviennent de gros rochers qui empêchent la progression.
2. Une sémantique incomplète
Le système d'information alimente les tableaux de bord de
l'entreprise, et lui permet de construire son expertise. On peut représenter cette
construction par un modèle en quatre couches :
Couches sémantiques du système d'information

À la base se trouve l'enregistrement des faits, qui s'opère
dans le modèle M2 de façon semi-automatique à partir des processus (communications des
clients pour un opérateur télécoms, tickets de caisse pour un magasin, coupons de vol
pour un transporteur aérien, etc.).
A partir de ces enregistrements élémentaires, l'entreprise
peut produire des indicateurs de tendance (portant sur la demande, les coûts, le partage
du marché, etc.). Il faut qu’elle sache ici surmonter divers obstacles : faire la
différence entre indicateur économique et donnée comptable, estimer les données
manquantes, analyser les séries chronologiques, corriger le mouvement saisonnier,
extraire la tendance, produire les segmentations de la clientèle, nécessitent une
compétence en production statistique de la part des métiers, et une compétence en
utilisation de la statistique du côté de l'administration de l'entreprise, destinataire
final des tableaux de bord. Or souvent les dirigeants confondent économie et
comptabilité, refusent les corrections de variations saisonnières, etc.
La recherche opérationnelle utilise les indicateurs pour
établir et tester divers modèles décrivant les comportements de la demande, des
concurrents, des fournisseurs, explorer des hypothèses et enfin éclairer la stratégie.
L'expertise se présente sous deux formes : celle qui est dans
les têtes, celle qui est incorporée dans les outils:
- le responsable qui a longuement travaillé les données, testé les hypothèses,
exploré les scénarios, dispose d'une représentation claire de son domaine d'action,
ainsi que d'une aptitude au diagnostic qui lui permet de voir d'un même coup d'œil
les problèmes à résoudre et leur solution ;
- le système d'information fournit à la première ligne de l'entreprise, dans des
fenêtres qui s'affichent à l'écran, des indications permettant de traiter chaque client
en tenant compte de la valeur qu'il représente pour l'entreprise (sa " life
time value ") ; il fournit aux superviseurs une aide qui soulage leur charge
mentale lorsque les problèmes d'exploitation s'accumulent, etc.
Cette expertise se construit sur la base des indicateurs et des
modèles de la recherche opérationnelle. Or il arrive qu'une entreprise demande au
système d'information de fournir cette expertise (dans les têtes des dirigeants, dans
les outils de la première ligne) sans pour autant la soutenir par une statistique et une
recherche opérationnelle, comme si l'expertise pouvait découler directement de
l'enregistrement des faits :
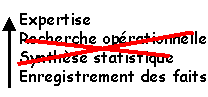
C'est comme si un opérateur télécoms voulait économiser les
câbles et les commutateurs et faire communiquer ses clients par télépathie, comme si un
transporteur aérien voulait faire voyager ses passagers sur un tapis volant. Ces
solutions ingénieuses existent, en effet, dans " Les mille et une nuits ".
3. Essai d'explication
Il serait trop facile, et faux, d’expliquer ce qui
précède par la sottise des personnes, leur mauvaise volonté, leur perversité etc. Les
explications de type psychologique ne peuvent pas rendre compte de questions
d’organisation. Il faut considérer la structure même de l’entreprise et son
fonctionnement pour chercher l’explication.
Nous proposons un modèle en trois couches : en bas se trouve la
couche " économique " de l'entreprise (on pourrait dire aussi " couche
physique "), où réside la fonction de production (capital, emploi, produits), la
formation de la demande, la formation des prix, les relations de concurrence, les
partenariats, etc. C'est ici que se trouvent les " métiers ".
En haut se trouve la couche " politique ", celle où
se nouent les relations avec les puissances extérieures et où se négocie le crédit
accordé à l'entreprise : actionnaires, banquiers (et en outre, dans le cas des grandes
entreprises publiques : ministère de tutelle, gouvernement, parlement, Bruxelles,
direction du Trésor etc.)
La couche politique a des effets économiques : il n'est pas
indifférent pour une entreprise d'être jugée " crédible " par les marchés,
car cela lui permet d'obtenir des crédits pour un prix raisonnable ; pour Air France, il
était crucial d'obtenir que l'aéroport de Roissy passe de deux à quatre pistes, et donc
de contrebalancer l’influence des associations de riverains et les écologistes.
Entre les deux se trouve une couche de " représentation
" (que l'on peut aussi nommer " organisation "), où se découpent les
concepts qui permettent à l'entreprise de se décrire, de se connaître, de communiquer.
Gramsci oppose deux modèles d'organisation sociale donnant
chacun l'hégémonie à l'une des deux couches extrêmes : l'économie, le " business
", l'entreprise aux Etats-Unis ; l'État (ou plus précisément le système
politico-financier) en Europe. Dans le modèle américain, la direction de l'entreprise
colle au " business " (même si elle remplit bien sûr une fonction politique de
communication, notamment vis-à-vis des actionnaires et du marché financier). Dans le
système français, qui nous importe ici, elle colle au politique.
Les trois couches de l’entreprise
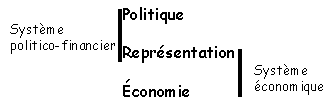
Dès lors le risque existe d'une coupure: la couche politique
peut vivre sans contact avec la couche économique, à laquelle elle demande seulement de
fournir les signaux alimentant le jeu politique. Alors la couche " représentation
" se coupe en deux.
Coupure entre politique et économie
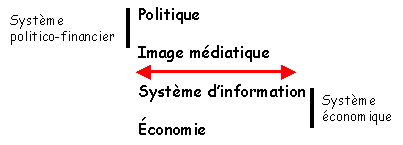
La partie qui colle à la politique, et qui définit les
sphères de légitimité et la production d'images par lesquelles ces sphères se font
reconnaître, devient médiatique : la réalité économique de l'entreprise y est
représentée par un double symbolique, une image, qui mène sa vie propre selon la
mécanique de la communication, exactement comme l'image d'un homme politique, d'une
vedette, mène en tant que symbole une vie indépendante de la vie réelle de la personne
qui en est support ou prétexte.
La question des tableaux de bord
Voici le témoignage d’un homme d’expérience :
" Je suis profondément malheureux de ne pas avoir, comme à Paribas, un tableau
de bord permettant de piloter en temps réel la marche de l'entreprise [...] Pendant cinq
ans, je me suis acharné, tout en sachant que je heurtais de front l'instinct de survie de
la banque commerciale à l'ancienne [...] j'ai relancé impitoyablement François Gille
pendant des années, j'ai réclamé des notes, organisé des réunions d'office, inscrit
la question aux séminaires du comité exécutif. [...] Ce n'est pas mauvaise volonté,
mais incapacité collective non seulement à exécuter, mais à concevoir
l'exécution [...] Ainsi je me trouve dans la situation du Titanic, naviguant dans un
océan parsemé d'icebergs avant l'invention du radar [...] cette affaire des instruments
de gestion est mon plus grand échec. [...] J'apprends donc la plupart des drames de la
maison par des rétroviseurs, six à neuf mois après, du fait de la mécanique des
comptes semestriels et annuels eux-mêmes décalés de trois mois. […] Je me
reproche, malgré un long combat de cinq ans pour les obtenir, de n'avoir pas agi avec
plus d'autorité, voire avec la violence de l'instinct de survie, pour obtenir les
indispensables comptes de gestion qui m'ont fait défaut jusqu'au dernier
jour. "
Le partage du pouvoir entre dirigeants à l'intérieur de
l'entreprise obéit à la même logique médiatique. Les zones de légitimité sont des
territoires dont les frontières se défendent par des procédés symboliques : qui figure
ou non sur la liste de diffusion de telle note ; qui participe ou non à telle réunion ;
M. X prend-il ou non M. Y au téléphone ; dans quel délai M. X accorde-t-il un entretien
à M. Y si celui-ci le lui demande, etc. Voilà les questions importantes!
La partie de la couche de représentation liée à l'économie
de l'entreprise n'est autre que le système d'information lui-même, qui fournit le cadre
conceptuel, l'outil d'observation et de synthèse dont elle a besoin pour être
représentée, c'est-à-dire pensable, partageable, communicable, mémorisable.
La coupure entre la couche politique et l'économie -
c'est-à-dire la coupure entre le milieu des dirigeants de l'entreprise et le
fonctionnement économique de celle-ci - est manifeste lorsque le système d'information
ne parvient pas à communiquer avec les dirigeants. La pierre de touche est ici la
qualité des tableaux de bord. Le fait qu'une direction d’entreprise n'accorde pas
d'importance à l'observation des faits, à leur synthèse, à l'analyse des tendances, à
la confrontation des modèles explicatifs, révèle que pour ses dirigeants la réalité
se résume au politique, à leur image auprès des actionnaires, des banquiers ou du
gouvernement. Il est d'ailleurs bien naturel et très fréquent, observons le en passant,
qu'une personne se conforme aux critères de jugement de ceux à qui elle doit son emploi.
Il arrive ainsi que les couches économique et politique
coexistent et mènent leur vie chacune de son côté, les frictions ne se produisant que
lorsqu'une décision économiquement nécessaire bute sur un refus à motivations
politiques. Si l'on sait éviter ce type de situation, l'entreprise peut prospérer - et
d'ailleurs, nous l'avons vu, la couche politique peut avoir une action favorable à la
survie de l'entreprise.
Décision et information
On peut illustrer le raisonnement ci-dessus en examinant la
façon dont sont prises les décisions. De nouveau, nous allons pouvoir confronter deux
modèles d'entreprise, " à la Française " et " à l'Américaine ".
Des dirigeants comme Robert Crandall (American Airlines) ou
Herbert Kelleher (Southwest) travaillent beaucoup pour préparer leurs décisions .
Crandall tient tous les matins une réunion de brainstorming avec les dirigeants de
l'entreprise. Ils épluchent les données, modèles, simulations concernant le
comportement des concurrents, des clients, des fournisseurs, et explorent les stratégies
possibles. Malheur à celui qui n'apporte pas à l'instant les données nécessaires à la
réflexion. C'est cette méthode qui a permis à American Airlines d'inventer presque tous
les procédés économiques nouveaux du transport aérien : GDS, yield management,
b-scale, etc. De même, Kelleher procède avant d'ouvrir une navette à des études
soigneuses sur les synergies possibles entre les deux villes que la navette va relier, et
l'externalité croisée qui peut en résulter entre la navette et l'économie de ces
villes.
Ces dirigeants, qui travaillent beaucoup sur l'information, sont
des experts dont les réflexes sont affûtés par l'examen anticipé des scénarios
possibles et par la connaissance des ordres de grandeur et des réactions du marché. La
qualité de leurs décisions est élevée; nous les avons représentés par le point en
haut à droite sur le graphique ci-dessus.
Le dirigeant " à la Française " vit dans le monde de
la politique ; il ne se soucie pas de l'information, ne réclame pas et ne regarde pas les
tableaux de bord. Il décide " au pif ", ce qui ne veut pas dire que la qualité
de ses décisions soit déplorable : l'intuition, affinée par des contacts informels avec
des collaborateurs et par des visites sur le terrain, peut permettre d'éviter les plus
graves erreurs. Cependant ses décisions ne peuvent pas avoir la précision, l'énergie,
la continuité que l'on trouve chez des dirigeants comme Crandall ou Kelleher. Nous
représentons donc le dirigeant " à la Française " par le point situé à
gauche sur le graphique.
Supposons que ce dirigeant, conscient de ses lacunes, se mette
à compulser des statistiques, à regarder des tableaux et des courbes. Cet effort
méritoire a d'abord un effet négatif : la fraîcheur, le bon sens qui soutenaient son
intuition sont détruits sans qu'il soit pour autant devenu un expert. L'arbre lui cache
la forêt, tel détail vu dans les tableaux de nombres le préoccupe à l'excès. Il se
trouve au point bas du graphique ci-dessous. La qualité de ses décisions a baissé, et
ses collaborateurs regrettent le temps où il travaillait moins, mais où il était plus
raisonnable.
Le dirigeant qui commence à regarder l'information passe ainsi
par une phase pénible durant laquelle ses décisions seront moins bonnes, son intuition
moins fidèle. Il fait la même expérience que le chercheur, parti plein d'espoir sur une
piste prometteuse, et qui ne peut parvenir au résultat qu'après une période aride où
ses idées simples sont détruites avant qu'il puisse les remodeler. L’effort finira
par payer s'il est poursuivi avec sérieux - et alors le dirigeant sera devenu un expert
redoutable.
Système d'information et qualité de la décision
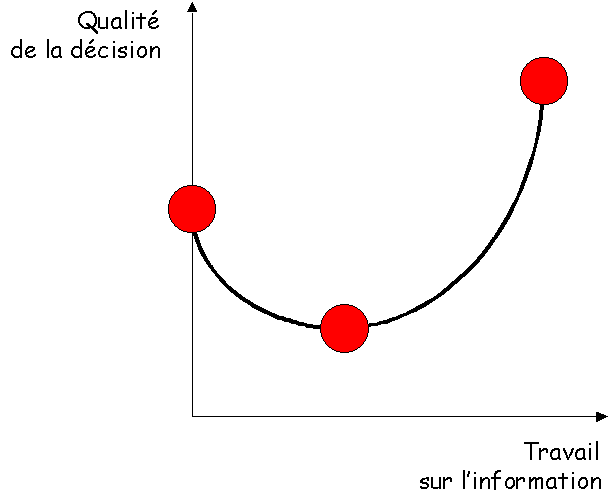
Mais cet idéal n'est pas celui du dirigeant " à la
Française ", car ce n'est pas ce qu'attendent de lui les pouvoirs qui l'ont nommé.
L'expertise fonde des convictions fortes, incompatibles avec la " souplesse "
que souhaitent avant tout les politiques. Il ne perçoit donc pas la possibilité ou
l'utilité d'une position analogue à celle de Crandall ou Kelleher. Sa position naturelle
est maintenue à gauche de notre graphique, où le rendement marginal du travail est
négatif. Si l'entreprise est disciplinée, si la légitimité des dirigeants n'est pas
écornée par leur manque d'expertise (il suffit pour cela qu'ils sachent bien jouer le
rôle médiatique qui leur est reconnu), les choses ne se passent pas trop mal - tant que
l'entreprise n'est pas en concurrence avec une autre dirigée par un expert, car alors sa
direction ne pourra plus faire le poids.
Les trois règles du conformisme
Dans une entreprise où la direction est essentiellement
politique, les métiers eux-mêmes sont incités à s'écarter de la rigueur
professionnelle et à obéir aux trois règles fondamentales du conformisme : " Pas
de vagues ", " Pas vu, pas pris ", " Après moi le déluge
".
Illustrons-les par des exemples. Ceux qui évitent avec pudeur
les vérités désagréables les jugeront de mauvais goût, d'autres y reconnaîtront
certaines expériences.
" Pas de vagues "
Le premier devoir d'un responsable est de couvrir les fautes de
ses subordonnés ; il n'y a jamais de sanctions - sauf envers ceux qui " font des
vagues ", " du zèle ", et font ainsi apparaître des problèmes qu'il
vaudrait mieux ignorer.
Le mot " compétence " possède une acception
administrative qui s'écarte de l'usage courant. En français courant, une personne
compétente est celle qui a le savoir nécessaire pour faire son travail. En français
administratif, la personne compétente pour traiter une question est celle dont cette
question relève selon l'organigramme. Lorsque la compétence administrative entre en
conflit avec la compétence du savoir, c'est à la première que l'on donne raison, car
sinon ce serait l'anarchie.
Une innovation risque toujours d'entraîner des
réorganisations, donc un changement des conditions d'utilisation de la force de travail.
La meilleure tactique pour combattre l'innovation, c'est d'évoquer les " problèmes
sociaux " qu'elle risquerait de susciter. Il est opportun de se rengorger lors de
cette manœuvre (le " goitre du dirigeant " donne à la voix un
son grave) et de prendre un air très préoccupé.
" Pas vu, pas pris "
Le pouvoir ne procure de plaisir que s'il est arbitraire. Faire
appliquer une décision rationnelle, ce n'est pas vraiment du pouvoir, puisque ceux
auxquels elle s'applique peuvent y adhérer en se fondant sur leur propre raison. Les
contraindre à appliquer une décision absurde, par contre, c'est du plaisir à
l’état pur. Il serait naïf d'ignorer le penchant de l'être humain pour de telles
voluptés - qui, comme l'adultère, sont sans conséquences tant qu'elles restent
indécelables.
La rétention d'information, le retard des signatures,
transforment les collègues en suppliants et constituent des monnaies d'échange : c'est
ainsi que l'on devient quelqu'un d'important.
Il ne faut jamais se sentir tenu par un engagement. Prendre un
engagement ne coûte rien, et permet de se débarrasser d'une trop forte pression,
l'essentiel étant que la promesse soit oubliée (ou qu'il soit de mauvais ton de la
rappeler) lorsque l'engagement arrivera à échéance.
Si l'entreprise contraint à faire des reportings, il faut en
retarder la fourniture en alléguant les difficultés de la collecte d'information et les
urgences opérationnelles, et entourer les évaluations d'un tel flou qu'elles échappent
à la discussion.
" Après moi, le déluge "
La légèreté des informaticiens qui ont continué à coder les
années sur deux caractères alors que l'an 2000 approchait illustre à elle seule cette
rubrique.
L'insouciance avec laquelle les entreprises poussent à partir
les " anciens " qui emportent avec eux la compétence des métiers, ainsi que la
lenteur dans l'embauche des jeunes qui apporteraient des compétences conformes à l'état
de l'art en sont un autre symptôme.
L'insouciance se trahit dans les attitudes velléitaires qui
associent discours volontariste et pratique de l'immobilisme. La violence du discours est
d’ailleurs un sûr symptôme de velléité : l'homme volontaire n'a pas besoin de se
montrer violent.
4. Évolution de l'organisation
Nous allons maintenant considérer les entreprises d’un
autre point de vue, plus proche de la chronologie, en montrant comment peuvent se
succéder des formes d’organisation reliées chacune à une époque de notre
histoire, et comment se fait le passage de l’une à l’autre.
Nous utiliserons des modèles qui se conjuguent en proportions
variables selon l’entreprise considérée, l’histoire ayant déposé dans
chacune des strates plus ou moins épaisses et plus ou moins récentes.
Système des caciques : A
L'entreprise A est dirigée par des " anciens ".
Chacun a durant sa carrière construit un réseau de relations et négocié sa zone
d'influence. Le directeur général est un arbitre qui veille à l'équilibre des pouvoirs
en donnant raison (et budget) tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Il divise pour régner.
L'énergie de l’entreprise A se consume en négociations internes.
Les qualités demandées au personnel y sont discipline,
dévouement, fidélité, égalité d'humeur. Ses compétences, acquises avant l'entrée
dans l'entreprise, y progressent peu car elles ne constituent pas un critère
d'avancement.
La dynamique de l’entreprise A peut coïncider par hasard
avec son intérêt à long terme. En général, l’entreprise A ne peut survivre que
si elle est protégée. C'était le cas des monopoles publics avant que la concurrence
n'arrive, c’est le cas de certaines entreprises protégées par un monopole local.
Système " rationalisé " : B
L'entreprise B est divisée en centres de résultat dotés
chacun d'objectifs et d'une comptabilité permettant d'évaluer l'efficacité des
managers. Pour construire la comptabilité analytique, il a fallu définir des conventions
âprement négociées ; une fois ces choix faits, la négociation concerne la décision
d'investir, que le calcul éclaire sans ambiguïté sinon sans incertitude.
B est caractérisée par la décentralisation des
responsabilités au sein du management. L'organigramme qui définit les entités et
désigne leurs responsables est la pièce maîtresse de l'organisation. Il doit être
assez stable dans le temps pour que l'on puisse confronter engagements et résultats.
L'emblème de l’entreprise B (organigramme et noms propres)
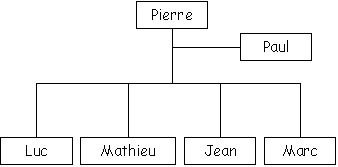
Ce système convient à des entreprises produisant en série des
produits standards sur des marchés à évolution lente. Il facilite la gestion des
infrastructures, l'organisation d'une force de travail spécialisée, la préparation des
plans d'investissement.
Les compétences demandées sont des savoir-faire correspondant
chacun à des tâches définies. L'entreprise dispense les formations nécessaires ; des
qualifications standardisées rendent les individus interchangeables.
Le passage de A à B a des avantages : rupture avec
l'inefficacité des caciques ; transparence facilitant la décision stratégique ;
compression des coûts. Il se fait souvent, sous la pression d'une concurrence par les
prix, pour diminuer les coûts et restaurer la marge. Il implique l'élimination des
caciques, la mise en place de centres de résultats et de procédures de planification. Il
comporte un changement des critères de gestion, donc des points de repère du personnel.
Système " organique " : C
Pour l'entreprise C, le mot clé est processus, au sens de
" suite des opérations permettant de traiter une affaire " : un processus part
d'un événement extérieur (réclamation d'un client, demande d'un agent) et parcourt une
boucle qui se ferme lorsque l’événement extérieur a reçu la réponse appropriée.
Identifier les processus, les organiser, les équiper, tels sont les enjeux de C.
L'emblème de l’entreprise C (boucle d'un processus)

Beaucoup de ces processus sont transverses à l'organigramme :
une structure de projet, une décision d'investissement, la relation avec un client,
demandent que s'enchaînent des opérations relevant d'entités diverses. Alors que toute
présentation de l’entreprise B commence par l'organigramme, la présentation de
l’entreprise C commence par les processus. Pour l’entreprise C l'activité
essentielle réside dans le système d'information.
La réalisation d'un processus implique une succession de
décisions. Il n'est pas possible de faire prendre chacune par la hiérarchie: elles
doivent donc être prises par le personnel. Le contrôle hiérarchique joue a
posteriori, et répond aux dysfonctionnements en adaptant le processus.
La hiérarchie est courte, le contact entre base et sommet est
facile. Le travail est qualifiant : les personnels se forment en travaillant. Les
qualités qui leur sont demandées sont l'adaptabilité (pouvoir activer des processus
divers) ; le bon sens (prendre la décision juste face à un cas particulier imprévu) ;
l'esprit de responsabilité (assumer les décisions sans angoisse).
Dans l’entreprise B, la responsabilité était
décentralisée, mais seulement au sein du management. Dans l’entreprise C, elle est
décentralisée vers les exécutants eux-mêmes.
Le passage de B à C est difficile. B résiste à la mise en
place des processus, d'autant plus qu'elle est mieux organisée. Pour une entité jugée
sur ses comptes analytiques, tout échange avec l'extérieur doit en effet être
valorisé. Un processus qui traverse sa frontière doit être muni de compteurs. Or la
mesure, aisée lorsqu'il s'agit de biens, est délicate lorsqu'il s'agit de services
(comment évaluer une expertise ? si plusieurs entités coopèrent à un même processus,
comment en partager la responsabilité ?). Il est difficile dans l’entreprise B de
mettre en place des structures de projet, et pratiquement impossible de trouver le centre
de résultat qui accepterait de porter une dépense nécessaire pour l'entreprise, mais
qui aurait un effet négatif sur ses propres comptes.
Il avait fallu casser le système des caciques pour passer de A
à B ; il faut casser le système des entités et des comptes pour passer de B à C.
Chacun de ces passages suppose sacrifices et destructions.
Culture de l'entreprise C
Dans l'entreprise C, la règle ne passe pas par des consignes à
appliquer automatiquement, ou par une hiérarchie à laquelle il s’agit
d’obéir : il s’agit de processus dont la mise en œuvre suppose le
traitement responsable des cas particuliers. L'exercice de cette liberté suppose une
discipline plus exigeante que l'obéissance à une règle.
Le fonctionnement organique de C se rattache à la modernité,
terme auquel nous donnons le sens suivant : " conception du monde, et de l'insertion
de la personne dans ce monde, qui donne la priorité à la liberté et à une éthique de
la responsabilité ". Dans cette phrase, le terme " personne " désigne
l'être humain qui, affranchi des caractéristiques accidentelles de son individualité
(état civil, tempérament, époque), découvre l'humanité qu'il partage avec tous et qui
est en ce sens universelle. Ce point de vue permet de fonder une réflexion éthique
rigoureuse.
La personne n'est pas seulement responsable de ses actes dans le
cadre du processus, mais elle est responsable aussi du processus lui-même, qu'il faut
faire évoluer. Si chacun est conscient de l'utilité des règles, chacun doit percevoir
aussi leur caractère construit, conventionnel. La règle, la hiérarchie ne sont pas
idolâtrées; ce sont des instruments subordonnés au service de l'entreprise.
Cette conception de la responsabilité concerne aussi les
représentations et le langage qui sert à les partager. La construction d'une
représentation est le fait d'une " intentionnalité " qui reflète à la
fois la situation particulière d'une personne et l'action que cette personne entend
conduire. L'intentionnalité ne se réduit pas à l'individualisme subjectif (la
modernité rompt avec le romantisme), mais implique la prise de conscience objective d'une
situation particulière. La représentation ne se réduit donc pas à une algèbre de
concepts conditionnée sociologiquement : elle se réfère selon un critère de pertinence
à la situation particulière de la personne et à l'action responsable dont elle vise à
fournir le cadre.
Cette démarche suppose une méthode permettant de créer des
règles pertinentes. L'art moderne a donné l'exemple : le créateur définit librement,
mais non arbitrairement, les règles qu'il va respecter. Les exigences éthiques et
intellectuelles de l'entreprise C invitent ainsi à dépasser la banalité cynique du
" business is business " et les habitudes du corporatisme ou de
l'autoritarisme.
Les modèles A, B et C entretiennent dans chaque entreprise un
contrepoint complexe. Dans C, avec la décentralisation des responsabilités, la
qualification par le travail, l'adaptabilité etc., le lieu de travail rejoint la culture
de notre temps. Ce n'est pas facile : la culture de la liberté est exigeante, même si
des personnes à l'esprit un peu rigide lui trouvent les apparences du laisser-aller.
Dans B, avec l'organisation de compétences spécialisées,
c'est le règne de la règle explicite. On est dans le monde industriel, avec sa force de
travail embrigadée, son efficacité dans un cadre fixe. Ce monde fait peu de place à la
liberté et, s'il est moderne, c'est dans un autre sens que celui que nous associons au
mot " modernité ".
Un système féodal permet aux caciques de déployer leur
originalité individuelle, et la culture n'est pas absente de A - mais elle renoue avec
des formes archaïques.
En lisant ce qui précède, on aura bien senti que nous jugeons
le modèle C plus intéressant que les deux autres. Pourtant, nous percevons bien quelques
dangers et quelques pièges. Il peut être bien commode, dans la situation risquée de
l’économie du STC, de faire porter par les salariés une part de risque ; ils
en paieront le prix psychologique, et l’entreprise économisera des frais
d’assurance. Il peut être bien tentant, pour des pervers (et il s’en trouve
dans toutes les entreprises) de conjuguer un discours décentralisateur avec une pratique
oppressive de contrôle indiscret, d’autant plus que les nouvelles technologies en
donnent tous les moyens. La mise en œuvre du modèle C doit s’accompagner de
précautions et de vigilance, et s’ancrer sur les fondements éthiques solides que
nous évoquerons au chapitre XV.
5. La " tache aveugle "
Les mécanismes sociologiques que nous venons de décrire sont
bien connus des cadres des entreprises ; ils alimentent les conversations
humoristiques ou désabusées qui se tiennent à la cafétéria - et qu'il convient
d'écouter attentivement, car elles sont symptomatiques. Si ces mécanismes perdurent,
c'est parce qu'ils ont pour racine un problème non sociologique, mais philosophique, et
donc difficile à poser simplement. Pour le tirer au clair, nous allons devoir suivre une
progression un peu délicate.
Le système d'information d'une entreprise réside dans l'espace
des représentations. À sa base se trouve un socle sémantique, avec la définition des
" populations " et des " individus " qui les composent ("
individus " et " populations " s'entendent ici au sens qu'ils ont en
statistique; l'" individu " peut être un client, une entreprise, un franc de
dépense, un îlot d'habitations, etc.), les nomenclatures selon lesquelles s'organisent
les concepts, les procédures d'identification etc.
Ce socle sémantique est mis en œuvre sur une plate-forme
technique constituée par les bases de données, la répartition des mémoires et
puissances de calcul, l'architecture client-serveur, les réseaux. Cette plate-forme doit
fournir une qualité de service convenable (taux de panne, durées d'attente, coupures de
communication), pour un prix acceptable: elle doit être dimensionnée pour une "
période de pointe ".
Or le dimensionnement des ressources doit anticiper sur le comportement
des utilisateurs. En effet, leur réseau n'obéit pas à des lois déterministes ; il ne
réagit pas comme un circuit hydraulique où la transmission de la pression respecte des
proportions prévisibles : l'utilisateur d'un réseau " se comporte " comme un
automobiliste. Si une route nationale se bouche, certains prendront leur mal en patience,
d'autres la quitteront pour une route secondaire ; la distribution de ces comportements
est aléatoire. Si le débit des routes secondaires est suffisant, ils soulageront la
route nationale ; sinon, ils encombreront aussi les routes secondaires et étendront le
blocage à tout le réseau.
Il en est de même sur un réseau informatique. Si le serveur de
communication tombe en panne, certains chercheront à passer par le serveur de
télécopie; si celui-ci est trop peu dimensionné il tombera lui aussi en panne ; s'il
est solidaire des serveurs applicatifs, la panne se généralisera jusqu'au blocage de
tout service.
Ainsi le dimensionnement doit tenir compte du comportement des
utilisateurs en cas de panne. Le calcul suppose une manipulation des probabilités (des
trafics, des pannes, des comportements en cas de panne etc.) à laquelle on se livre
rarement. L'expertise remplace donc le calcul. L'expert est déjà tombé dans les pièges
et s'en est sorti, à chaud, sous les lazzi des utilisateurs. Il a appris à anticiper,
par l'intuition, les accidents possibles sur un réseau.
Cette intuition peut parfois s'exprimer de façon simple : il
peut ainsi prévoir que si une entreprise met en place un nouveau système sans former les
utilisateurs, ceux-ci commettront des erreurs, et que le " help desk " sera
surchargé de questions élémentaires.
Mais certaines des certitudes de l'expert sont plus difficiles
à communiquer. Supposons que l'entreprise souhaite construire un système d'information
sur sa clientèle. L'expert sait qu'il faut un répertoire pour identifier les clients et
réaliser au moindre coût les fusions de fichiers pour rassembler l'information que l'on
a sur un client, quelle que soit sa source. Cependant la construction de ce répertoire a
un coût et un délai, et des managers impatients peuvent ne pas en percevoir l'utilité.
Il en sera de même des hypercubes qui accélèrent
l'utilisation des bases de données moyennant quelques limitations ; de l'administration
des données et de la modélisation des processus, qui clarifient la sémantique d'une
opération avant tout développement technique ; de l'équipement des utilisateurs en
interfaces multimédia qui élargit la gamme des fonctionnalités possibles ; du
dimensionnement de l'infrastructure de serveurs et du réseau ; d'outils qui, comme le
serveur de télécopie, économisent le temps et l'attention de l'utilisateur ; de
l'unification des messageries, qui permet à l'utilisateur de trouver tous ses messages
dans une même boîte aux lettres ; de la documentation électronique et des forums ; de
l'équipement des processus en workflows, etc.
Sur tous ces sujets, l'expert est éclairé par une évidence
aussi simple et forte que celle qui s'impose à l'architecte qui équilibre des forces en
leur fournissant des points d'appui ; mais sauf exception cette évidence ne sera pas
partagée par les non-experts.
Pourtant d'autres expertises sont partagées par tous. Si, dans
une compagnie aérienne, quelqu'un proposait de faire voler les avions sur le dos "
parce que les passagers trouveraient cela amusant et que cela nous distinguerait de la
concurrence ", il serait déconsidéré car chacun sait que les passagers
n'apprécieraient pas cette acrobatie d'ailleurs impossible. Par contre, dans le domaine
du système d'information, l'expert entend dire des énormités équivalentes à "
faire voler des avions sur le dos ", et qui passent pour des hypothèses à
considérer (" on fera le répertoire en dernier ", " il ne faut pas
installer de serveur de fax parce que cela ferait croître la dépense en télécoms
", " il ne faut pas formaliser le processus sous la forme d'un workflow parce
que cela reviendrait à graver en dur les erreurs que le processus comporte ", "
il faut des économies opérationnelles immédiates, la recherche de la cohérence relève
d'une démarche intellectuelle et donc superflue ", " la maîtrise d'ouvrage
doit être faite par l'informatique ", " l'administration des données peut
attendre la fin du développement ", " je ne crois pas à l'Internet ",
etc.).
Il est difficile de communiquer l'expertise sur le système
d'information parce qu'il s'agit d'une spécialité nouvelle. En outre, le système
d'information entoure les tâches pratiques, matérielles (faire une réparation, livrer
un produit, transporter un paquet) de représentations fournissant la grille conceptuelle
selon laquelle sont effectuées observations et mesures. Il n'est pas facile de comprendre
ce que l'on gagne en redoublant ainsi des tâches pratiques par leur image, structurée
par un cadre conceptuel. L'efficacité matérielle d'une représentation immatérielle
sera parfois perçue au coup par coup, mais rarement dans son principe et sa
généralité. Chacun peut à la rigueur comprendre que le calendrier de maintenance d'un
équipement soit enregistré dans un programme informatique qui édite les documents
techniques, produit les " fiches de travail " permettant de travailler dans le
bon ordre (démonter une pièce, puis les pièces que ce premier démontage dégage,
exécuter les travaux sur les pièces dans l'ordre inverse du démontage, etc.),
enregistre les opérations, met à jour le programme d'entretien etc. Mais il ne sera pas
facile de comprendre que le système d'information obéit à une " physique "
qui lui est propre, celle du dimensionnement des ressources et du modèle en couches de la
représentation. Que les contraintes de la sémantique soient aussi rigoureuses que celles
de la physique, c'est un fait que peu de managers sont prêts à reconnaître.
Lorsque l'expert exprime une évidence relevant du bon sens, il
observe le regard distrait de son interlocuteur, son empressement à parler d'autre chose
; on lui enjoint finalement d'être " plus concret ". Cet emploi du mot "
concret " est révélateur. Ce mot a en effet une acception différente selon que
l'on utilise le langage de la philosophie, où il a un sens technique précis, et le
langage courant. Dans le langage philosophique, " concret " s'oppose à "
abstrait " comme " individuel " s'oppose à " conceptuel ".
Est concret cet objet-ci, que je peux manipuler s'il est devant moi (cet ordinateur, cette
tasse de café). Est abstrait le point de vue sous lequel je considère un objet, et le
concept sous lequel je vais le classer (forme, poids, couleur, matière, etc.). Tout objet
individuel (concret) réalise de facto la synthèse de diverses catégories
conceptuelles (abstraites).
Or dans le langage courant " concret " est synonyme
d'" habituel ", abstrait est synonyme de " nouveau ". Rien de plus
concret, pour un cadre qui s'inquiète de sa carrière, que des catégories comme "
cadre supérieur ", ou même " C6 ", qui n'ont de sens que dans la
convention collective. Ainsi les catégories abstraites fréquemment utilisées par le
raisonnement (types d'actifs pour un financier, types d'outils pour un ouvrier,
subtilités de la mode pour une personne coquette) usurpent le qualificatif " concret
".
Place de la tache aveugle
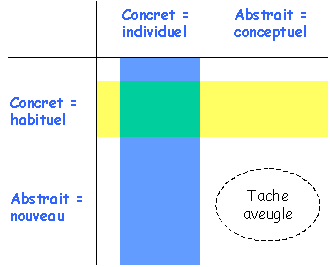
Croisons les deux acceptions des termes " concret " et
" abstrait ". Chacun est à l'aise dans le monde de ses objets habituels, monde
en somme doublement concret. Les catégories abstraites dont il a l'habitude déterminent
la grille de représentation qui associe à chaque objet concret les concepts dont il
relève ; pour lui, ces catégories sont " concrètes ", car elles délimitent
ses intentions, désirs, craintes, répulsions, et confèrent un sens à son action.
Les objets individuels dont il n'a pas l'habitude, concrets au
sens philosophique, se plient mal à sa perception parce qu'il ne dispose pas de grille
pour en rendre compte. Il ne saura pas les classer par rapport à ses désirs, intentions
etc., il ne saura pas quoi en faire. Si ses sens les perçoivent, son entendement ne sait
pas les " penser ". Ils seront donc ignorés ou jugés " abstraits
", ce qui est une façon de dire qu'ils le mettent mal à l'aise.
Quant aux concepts dont il n'a pas l'habitude, ils n'existent
pas. Inhabituels et imperceptibles (puisque à la différence des objets individuels ils
ne se présentent pas devant les sens), ils se trouvent dans la " tache aveugle
" de l'intellect. Leur évocation lui semble futile, du " bavardage ", du
" bruit ". Il attend qu'elle cesse pour pouvoir parler des " choses
réelles ", c'est-à-dire de celles dont il a l'habitude.
Regardez ce père de famille qui parle avec son fils de dix-sept
ans. L'adolescent vit avec ses copains, pense à son habillement, à la musique qu'il
aime. Si le père cherche à lui expliquer que ce qu'il apprend au lycée sera utile, plus
tard, dans sa vie professionnelle, il évoque quelque chose qui se trouve très loin de ce
que l'adolescent est prêt à entendre... que le père soit éloquent, habile, clair dans
ses explications n'y changera rien. Lorsque l'interlocuteur est sourd, l'éloquence est
inutile.
L’aveuglement devant l’inhabituel
Jeanne Favret-Saada a bien décrit l'aveuglement devant l'inhabituel:
" Les notes que je pris en 1971 d'après la bande magnétique que j'avais
enregistrée au cours de cet entretien portent alors cette mention étonnante,
significative de la surdité qui m'affecta si souvent au cours de mon travail :
" Suit une histoire inaudible [ ... ] ". Il me paraît invraisemblable
aujourd'hui que seul ce passage ait été inaudible : quand, plus tard, j'y entendis le
ronronnement de la machine à laver des Babin, cela ne m'empêcha pas de comprendre leurs
paroles. Au pire, Joséphine m'avait alors parlé avec un débit précipité [ ... ].
L'hypothèse la plus probable est donc que je ne voulais pas entendre le récit de cet
épisode capital - sur lequel je ne posai d'ailleurs aucune question - parce que de le
prendre en considération m'aurait conduite à réviser la version que je m'étais alors
constituée de l'histoire des Babin. "
Nous construisons durant notre formation la grille à travers
laquelle nous percevons le monde ; elle structure ce que nous pouvons voir. Cette grille
indispensable, imperceptible comme nos lunettes (" qui nous permettent de voir, mais
que nous ne voyons pas ", dit Heidegger), nous enferme dans les perceptions qu'elle
autorise. Lorsque quelqu'un tient devant nous un discours relevant d'une autre grille,
nous cessons d'écouter, nous sommes agacés, nous croyons perdre notre temps, nous avons
hâte de retrouver le terrain familier des représentations habituelles.
Le penseur sait interpréter ses propres réactions de
distraction, d'agacement, de surdité. Elles lui indiquent les voies par lesquelles il
pourra sortir de la prison de ses représentations ; cela lui demande un travail
parfois pénible mais crucial. C'est d'ailleurs à cette ouverture, à cette "
simplicité " que l'on reconnaît le penseur. Mais les dirigeants ne sont pas tous
des penseurs. Ils ont reçu une formation dite supérieure, et la jugent suffisante
puisqu'elle leur a permis de " réussir ". Les représentations qui sortent des
habitudes de leur milieu leur semblent sans intérêt.
Le système d'information se trouve dans la tache aveugle des
dirigeants parce que la formation au système d'information ne fait pas partie de leur
bagage initial. Mais surtout la démarche qui fonde le système d'information suppose que
l'on soit libre envers les représentations, que l'on sache les manipuler comme des
instruments de l'action. Cette relativisation des représentations, cette souplesse, vont
de pair avec l'aptitude à les reconcevoir, donc avec une attitude dont à présent seuls
des penseurs sont capables.
Pour que l'entreprise assimile la logique du système
d'information et sache en faire un instrument de l'action, il faut que ses dirigeants
deviennent dans une certaine mesure des penseurs, et qu'ils soient à l'aise pour créer,
réviser et détruire les concepts et catégories qui fondent leurs représentations.
L'importance que prend le système d'information dans la vie des entreprises aidera cette
évolution, mais celle-ci ne sera certainement ni facile, ni rapide.
Annexe 1 du chapitre XII : Sottisier des nouvelles
technologies
Nous avons noté méthodiquement, dans l'esprit du
" dictionnaire des idées reçues " de Flaubert, des phrases que nous
avons entendues sur les nouvelles technologies. Le langage de l'entreprise mérite d'être
écouté attentivement, car il est révélateur des situations de crise (cf. annexe 2 de
ce chapitre).
Administration des données :
" L'administration des données n'est pas prioritaire. Elle relève d'une
démarche intellectuelle, donc superflue. Ce qu'il me faut, c'est des économies
immédiates dans l'opérationnel " (un DG, 1995)
Annuaire : " Pas question de faire un
annuaire de l’entreprise : si les numéros de téléphone des gens sont connus, ils
recevront des appels et ne travailleront plus " (un directeur régional d'une
administration)
Annuaire (bis) : " Les syndicats
s’opposent à ce que l’on mette sur l’annuaire, en face du nom d’une
personne, l’indication de sa fonction. Qu’y faire ? " (un autre
directeur régional)
Client serveur : " Proposition A): Le
client-serveur sera bientôt une technologie du passé. Or 99% de nos clients n'en sont
pas encore là. Proposition B) : Dans seulement 20 à 30% des grands groupes on accepte de
parler de technologie au niveau du top management " (un représentant d'une
grande entreprise de consulting)
Cœur de métier : " Nous nous recentrons
sur notre cœur de métier ; eh bien exprimer des besoins, ce n'est pas notre
cœur de métier "
Commerce électronique : " Le commerce
électronique ne nous sert à rien, car il ne fait pas croître le trafic sur le
réseau " (directeur chez un opérateur télécoms, 1995)
Compléments de service : " Je vais essayer
de vous transférer " (phrase courante ; la prononcez-vous parfois ?)
Compléments de service (bis) : " Moi, mon
téléphone, tout ce que je lui demande c’est de ne pas tomber en panne.
D’ailleurs personne ne sait utiliser les compléments de service ".
Consultants : " Tous incompétents et vendus
aux constructeurs. D’ailleurs, ils rédigent leurs études en recopiant la
documentation technique donnée par les constructeurs " (un installateur
télécom ; voir " installateurs ").
Culture : " Je suis sûr qu'on n'est pas une
entreprise culturelle puisqu'on est une entreprise de conseil et de service "
(un représentant d'une grande SSII)
Discrimination : " Depuis qu’on leur a
enlevé le 00, les gens défilent dans le bureau de leur chef de service pour pouvoir
appeler l’étranger ".
Documentation électronique : " Ces services
d’images, c’est très joli mais ça ne fait pas sérieux ".
Etudes : " Les études sont une
commodité " (un directeur, 1995).
Homologation : " Notre procédure
d'homologation est sérieuse, donc longue. Lorsque nous homologuons un produit il n'est
plus vendu sur le marché, qui a deux versions d'avance sur nous " (cf.
" messagerie électronique (ter) ")
Innovation : " Nous ne nous permettons jamais
de prescrire à un client l'utilisation d'une technologie nouvelle pour lui. Nous ne
sommes en aucun cas des prescripteurs. Notre doctrine absolue, c'est de ne jamais aller en
matière d'innovation plus loin que ce que le client est prêt à accepter " (un
représentant d'une grande SSII)
Informatique : " La satisfaction des
utilisateurs ne fait pas partie de mes dix premières priorités " (un
informaticien)
Installateurs : " Tous incompétents et
vendus aux constructeurs. Ils ne cherchent qu’à vendre du matériel et câblent
n’importe comment " (un consultant ; voir
" consultants ").
Intelligence : " Comprenez bien qu'ici (2200
personnes) les gens n'ont pas besoin de système d'information personnel, puisqu'ils n'ont
pas de données personnelles, car nous avons supprimé les disques dur : comme ça il n'y
a forcément que des données collectives sur les serveurs " (un responsable
d'une très grande entreprise).
Internet : " L'Internet, moi, je n'y crois
pas " (un DG, 1998)
Internet (bis) : " L’Internet,
c’est super, tout le monde est avec tout le monde sur le réseau, c’est la
démocratie, c'est le dialogue, c’est le commerce, c’est la vie, c'est la voie,
c'est la vérité, c’est Dieu ".
Internet (ter) : " Pas d'Internet chez nous :
les gens passeraient leur temps à regarder les serveurs pornographiques ".
Internet (quater) : " Je me suis fait
imprimer sur papier les pages de notre serveur Web et je les ai regardées pendant le
week-end. C'est formidable tout ce que nous avons mis sur notre serveur ! Je vous
félicite. Quand je serai à la retraite, il faudra vraiment que j'achète une de ces
machines " (un directeur d'administration centrale, 1999).
Maîtrise d'ouvrage : " La maîtrise
d'ouvrage [du système d'information] doit être faite par l'informatique " (un
DG, 1995).
Marche à pied : " Les gens ont trop tendance
à rester confinés dans leurs bureaux. C’est pour cela que nous ne leur donnons pas
de moyens télécom évolués : ça les oblige à sortir, à marcher, à se
voir " (le secrétaire général d'un centre de recherche, 1990)
Messagerie électronique : " Personne
n’utilisera la messagerie électronique " (voir " messagerie
électronique (bis) ").
Messagerie électronique (bis) : " Si
l’on installe une messagerie électronique, il faudra mettre comme sur le téléphone
des filtrages pour ne pas être submergé par les messages ".
Messagerie électronique (ter) : " La norme
de l'entreprise, c'est Windows 3.1. Donc si quelqu'un qui travaille sur Windows 95 vous
envoie un message comportant une pièce jointe que vous ne pouvez pas ouvrir, la marche à
suivre est : 1) copier le fichier sur une disquette ; 2) apporter cette disquette dans le
bureau de Mme Untel, qui est équipée de Windows 95 par faveur spéciale, elle
transcodera le fichier si elle en a le temps ; 3) revenir dans votre bureau avec la
disquette et copier le fichier transcodé sur votre disque dur ; 4) ouvrir le fichier et
le lire ". (service " support " de l'informatique d'une
grande entreprise, 2000)
Micro-ordinateur : " Jamais un directeur ne
se mettra à taper sur un clavier. C’est ma secrétaire qui se sert du
micro-ordinateur. Il lui est d’ailleurs très utile ".
Micro-ordinateur (bis) : " J’estime que
le micro-ordinateur doit marcher tout seul. Si je ne comprends pas la machine, c’est
la machine qui a tort ".
Micro-ordinateur (ter) : " C’est vrai
qu’il faut faire communiquer les micro-ordinateurs. Mais moi, ce qu’il me faut,
c’est des LL et X25 " (un informaticien)
Micro-ordinateur (quater) : " Pourquoi
chercher la cohérence ? Que chacun fasse comme il veut, qu’il y ait un peu de
pagaïe, c’est super ! " (un autre informaticien).
Muette (voici pourquoi votre fille est) :
" L'informatique est de trop bas niveau pour pouvoir être enseignée aux
managers et aux décideurs "
Notice d’utilisation : " Votre
correspondant est occupé. Vous pouvez obtenir le rappel automatique : consultez la
notice " (message enregistré sur le PABX d’un centre de recherches
spécialisé dans les télécoms).
Notice d’utilisation (bis) : " Les
gens ne liront pas la notice, et il sera impossible de les faire venir à une réunion
dont l’objet serait d’apprendre à se servir du téléphone. On n’aura que
les secrétaires : les chefs ne veulent pas passer pour des ignorants ".
One to One : " Le one to one, c'est que quand
vous entrez dans la cafétéria, on vous sert automatiquement le café qu'il vous faut en
fonction de l'heure, sans vous adresser la parole "
One to One (bis) : " c'est formidable ! vous
entrez dans un magasin, votre carte à puce sans contact a donné vos coordonnées. Le
système retrouve que vous avez un problème de cheveux, et dès que vous vous approchez
d'une caisse, l'écran vous propose la promotion du jour pour résoudre votre problème
capillaire " (directeur marketing d'une SSII spécialisée dans le conseil en
stratégie et en système d'information, 1999)
Plan qualité : " Excusez moi mais je ne sais
plus très bien ce que fait mon projet parce que je suis en train de rédiger son plan
qualité "
Recherche de personnes : " Pas question de
porter un " bip " sur moi : je ne veux pas que l’on me prenne
pour le pompier de service ".
Répondeur : " A quoi ça sert, les
répondeurs ? Moi, quand je tombe sur un répondeur, je raccroche aussitôt ".
Responsabilité : " Les gens sont
irresponsables. Si vous ne les faites pas passer par le standard, ils téléphoneront tout
le temps à l’étranger pour avoir des nouvelles de leur famille qui est en
vacances " (le directeur régional d'une administration)
Serveur de télécopie : " Il ne faut pas
installer de serveur de télécopie parce que cela fera croître la dépense en
télécommunications. Si les cadres veulent envoyer des fax, eh bien ils n'ont qu'à
bouger leurs fesses jusqu'au télécopieur " (un DG, 1997)
Système d'information : " Vos histoires de
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre commencent à me faire suer : ce ne sont
que des conflits de pouvoir. Ce que je vois de clair, c'est que tout ça, c'est de
l'informatique e basta " (un DG, 1998)
Télécommunications : " Je ne veux pas
savoir ce qui se passe du côté de la téléphonie : moi, avec les LL et X25, j’ai
exactement ce qu’il me faut et ça marche très bien " (un informaticien).
Télécopie : " Les gens envoient déjà des
notes sans enregistrement, sans signature, sans date et sans liste de destinataires :
imaginez la pagaïe si, en plus, on leur donne la télécopie ! " (secrétaire
général d'une administration, 1992)
Télécopie (bis) : " On ne va tout de même
pas mettre des télécopieurs dans les ateliers. C’est réservé aux
directeurs ". (DG d'une entreprise industrielle, 1990)
Trop bonne idée : " Cette idée de service
est excellente, mais comme il pourrait être commercialisé par deux branches différentes
de l'entreprise chacune attend que l'autre finance le développement. Donc il ne verra
jamais le jour ". (1999)
Versions : " Un bon outil est un outil qui
permet de développer un projet dans un temps inférieur au délai entre deux versions de
l'outil " (un vendeur de progiciels)
Workflow : " Il ne faut pas formaliser les
processus sous la forme de workflow, parce que cela revient à graver en dur les erreurs
que le processus comporte " (un DG, 1997)
Annexe 2 du chapitre XII : Crise de l’entreprise et
crise du langage
La cause première d'une crise de l'entreprise, c'est que
son processus de décision est perturbé. Lorsque les missions sont mal définies,
les personnes mal choisies, les processus de production mal maîtrisés, la réalité se
venge au travers d’incidents qui, non résolus, s’accumulent :
-
Incidents classiques en cas de crise
- procédures longues et incertaines
- délais et budgets incontrôlables et dépassés
- négociations qui ne convergent pas
- remise en question des décisions
- désaveu des mandataires
- ajournement des rendez-vous
- absentéisme en réunion
- réunions sans ordre du jour, durée limite ni compte rendu
- pannes sans responsable identifié
- messagerie et courrier infidèles
- documentation non à jour
- "certification qualité" substituant une sécurité illusoire à la
vigilance et à l'esprit de responsabilité
- informatique désordonnée (ressaisies manuelles, ergonomie pénible,
référentiels redondants)
|
Chacun cherche alors non à résoudre les problèmes - tâche
devenue impossible - mais à en faire porter par d’autres la responsabilité.
Le naïf qui s’obstine à l’efficacité se désigne ipso
facto comme bouc émissaire. Les dirigeants eux-mêmes sont comme quelqu'un qui,
perdu dans le désert, marcherait dans la direction opposée à celle du salut. Même
s'ils sentent où se trouve la solution, sa simplicité leur inspire une sorte de crainte
et ils changent son signe comme s’ils inversaient Sud et Nord d’une boussole. Le
meilleur, ils le rejettent. Le pire, ils le choisissent.
Crise du langage
Lorsqu'il y a crise de l'entreprise, cela se manifeste par un
symptôme qui ne trompe pas : le langage parlé dans l'entreprise se dégrade. Il suffit
donc d'observer le langage pour confirmer le diagnostic de crise. Si le vocabulaire est
pollué par des synonymies et homonymies, si les données que fournit le système
d'information sont ambiguës - ou, ce qui revient au même, s’il faut des
redressements préalables pour les utiliser - les réunions sont encombrées de
discussions stériles et l’incertitude sur les faits entraîne la légèreté des
décisions. On observe aussi des illogismes et de l'inflation :
Manifestations de la crise du langage
- quand les mots " sérieux ",
" professionnalisme ", " méthodologie ",
" rigueur " reviennent souvent, c’est signe que ces qualités
font défaut : quelqu’un de sérieux ne perd pas de temps à les prononcer.
- ceux qui ont peur d'être en position de faiblesse si on les comprend cherchent
à se protéger par du jargon (débauche d'acronymes, d'anglicismes, de noms propres).
- certains, pour impressionner, remplacent le mot propre par un terme abstrait
(" méthodologie " pour méthode,
" problématique " pour problème, " technologie "
pour technique, " générique " pour général,
" spécifique " pour particulier ou pour local,
" commanditaire " pour donneur d'ordres, etc.). Les dégâts sont ici
plus graves que ceux causés par le jargon, car c'est le vocabulaire courant lui-même qui
est dégradé.
- le recours systématique au superlatif (" très
grave ", " très important ", " très
sérieux "), voire au double superlatif (" c'est très très
important ") aplatit le langage, le manque de contraste interdisant la
perception des priorités.
- certaines expressions s’autodétruisent : " principes
concrets ", " schéma exhaustif ", " synthèse
détaillée ", etc. Ces petites bombes sémantiques ont pour détonateur une
contradiction entre substantif et adjectif (nécessairement un
" principe " est abstrait, un " schéma "
sélectif, etc.) ; en disloquant la phrase elles fissurent l’ensemble du discours.
- la dégradation des concepts accompagne celle du langage. On dit
" organisation " mais on dessine un organigramme ;
" processus " sans définir livrables, acteurs ni délais ;
" qualité " (ou mieux " méthodologie de démarche
qualité ") sans indiquer de critères d'évaluation.
- on confond données comptables (biaisées notamment par le principe de prudence)
et indicateurs économiques ; gestion (suivi de l’opérationnel) et expertise ;
observation (constat des faits) et explication (utilisation d’un modèle) ; donnée
statistique (sur une population) et donnée individuelle ; etc.
|
La " langue de bois " empêchant
l'évaluation pondérée des problèmes, il faut un bouc émissaire. Son exécution (mise
au placard, dépression puis départ) se prépare dans son dos avec jubilation. Elle
procure une détente momentanée mais ne résout rien : il faut alors une nouvelle victime
expiatoire. Les énergies s'usent dans la destruction des personnes.
Comment sortir de la crise ?
Peut-on soigner le mal en corrigeant le langage ? Non, car il
n'est qu'un symptôme. Si l'on restaure le processus de décision, le langage suivra.
Cependant le langage des dirigeants conditionne le processus de décision : c'est à eux
en effet qu'il revient de " donner du sens " à l'entreprise. Il
s’agit non d'apporter un " supplément d’âme ", expression
un peu méprisante (comme quand on dit de celui qui signale une difficulté qu'il a des
" états d'âme " ), mais de structurer l’architecture
de l’entreprise : processus de production et de gestion, outils de connaissance et
d’interprétation, élaboration de la stratégie.
Or pour une entreprise, comme pour un bâtiment, l'architecture
a deux aspects : ce qui a été construit s'impose par son évidence et sa pérennité
apparente ; ce qui se conçoit, puis se construit, relève de l'imagination et de la
volonté. Ceux qui manquent d'imagination ne voient que l'existant (ils appellent cela du
" pragmatisme ") et ignorent le possible. L'histoire, en montrant les
origines de l'existant, permettrait de percevoir la dynamique de sa conception ; mais
l'expérience montre que les conformistes sont imperméables à ses enseignements.
Mieux vaut donc progresser par petits changements pour faire
comprendre (" réaliser ", selon un anglicisme ici opportun) puis
accepter de nouvelles perspectives. Il ne s'agit alors que de débloquer les conditions
pratiques élémentaires du processus de décision :
- tableaux de bord sélectifs et clairs pour les dirigeants ;
- comités équilibrés : l’expertise technique s’exprime, la
légitimité politique décide ;
- qualité sémantique du système d’information (administration des données)
;
- équilibre des responsabilités et pouvoirs entre maîtrise d'ouvrage et
maîtrise d'œuvre du système d'information ; etc.
Nous ne détaillerons pas ces conditions : nous voulions
seulement montrer que l'examen du langage contribue au diagnostic de crise.
Si l'entreprise fonctionne comme un organisme sain, son langage
est sans enflure ; les gens ne parlent plus de " sérieux ", de
" méthodologie " ni de " qualité " ; ils disent
: " la boîte marche bien ", " c’est
simple ", " on sait ce qu’on a à faire ",
" on est bien outillés ", " on est bien
dirigés ", " c'est efficace ", " ça
tourne ", " c'est organisé ". Cette clarté, cette
simplicité sont le meilleur actif de l'entreprise. Il se construit progressivement, puis
s'entretient, par un processus de décision fin et vigilant.
Annexe 3 du chapitre XII : Approche médicale de
l’entreprise
Chaque
entreprise a une " personnalité ". Bien que l'entreprise ne soit pas
réductible à un individu, cette personnalité est bien distincte. Les discussions
ambiguës sur son " cœur de métier " montrent à la fois que
cette personnalité existe puisque l'on s'efforce de la cerner, et qu'il est très
difficile de la définir.
L'entreprise est un être vivant et donc elle évolue ;
pourtant, une fois passée l'ère des pionniers, l'organisation a besoin de stabilité, et
le conservatisme la tente toujours. Il peut donc arriver que l'entreprise se bloque et
qu'elle serve des finalités qui la parasitent. Alors elle est malade.
Qu'une entreprise puisse être malade ne doit pas surprendre,
puisqu'il s'agit d'un organisme vivant. Pourtant les catégories de pensée héritées de
notre formation résistent à cette évidence. L'entreprise, croit-on, c'est le domaine de
l'efficacité et du sérieux. La pensée économique fait de cette efficacité un
postulat, alors que celle-ci ne peut s'obtenir en pratique qu'après beaucoup d'efforts.
Ceux qui évoquent la pathologie de l'entreprise risquent de passer pour de mauvais
esprits : il est vrai que comme l'on ne sait ni penser ni dire cette pathologie, ils
s'expriment le plus souvent sur le mode peu crédible de l'imprécation.
On expliquera alors après coup, par la fatalité ou par la
malhonnêteté de quelques-uns, des catastrophes que l'on aurait pu prévenir si l'on
avait su prendre une attitude tranquillement et posément médicale. Le système
d'information est une aide puissante pour porter un diagnostic sur l'entreprise, puis
définir et administrer les traitements curatif et préventif dont elle a besoin. |
Représentations de l’entreprise
Il existe plusieurs représentations de l’entreprise.
L’économiste dit qu’elle a pour but de maximiser le profit, ce qui lui permet
de recourir aux mathématiques une fois le profit défini comme fonction d’autres
variables. Le dirigeant, reproduisant le système de commandement des armées et des
églises, y voit une structure hiérarchique : cela le conforte puisqu’il est au
sommet de la hiérarchie. Le financier la considère comme une entité fiduciaire qui doit
susciter la confiance pour avoir du crédit ; son raisonnement associe une mathématique
poussée à un souci de l’image proche de la logique des médias. Pour le salarié
cadre, elle est le lieu de sa carrière : elle lui offre l’échelle qu’il
s’efforce de gravir, un terrain de compétition, le socle institutionnel de son
existence sociale (" cadre supérieur à Air France ",
" directeur chez Alcatel ", " associé chez
McKinsey ", " ingénieur à Framatome " etc.). Le salarié
non cadre y voit la " boîte " qui lui donne les moyens de sa vie
matérielle en échange d’une partie de son temps. Le syndicaliste la perçoit comme
un terrain de lutte ; selon sa tendance, il défendra le salarié non cadre, le salarié
cadre, ou le syndicat lui-même qui ambitionne de cogérer l’entreprise, voire de la
diriger.
L’homme du marketing la perçoit comme une
" marque ", une image, capables de séduire et fidéliser divers
segments de clientèle. L’ingénieur pense qu’elle produit biens et services à
partir des consommations intermédiaires, de la main d’œuvre et des techniques
incorporées dans les machines. L’informaticien, qu’elle utilise les ordinateurs
et les applications dont il est le maître. Le comptable, qu’elle émet et reçoit
des effets de commerce qu’il classe pour évaluer, conformément aux règles admises,
les flux s’accumulant dans le bilan.
Le dirigeant, qui incarne la légitimité, doit pactiser avec
d’autres pouvoirs : le territoire, la " plate-bande ", que
s’approprie chaque directeur et qui, suivant l’arbre hiérarchique, se subdivise
en fiefs d’ampleur décroissante mais toujours bien gardés ; les réseaux tissés
autour des écoles d’ingénieurs, syndicats ou partis politiques, et confortés quand
l'occasion le permet par une corruption discrète mais habituelle.
Aux pouvoirs internes s’ajoutent des pouvoirs externes : le
conseil d’administration qui nomme le dirigeant et peut le révoquer ad nutum
; le pouvoir politique (gouvernement, élus) et administratif (préfecture, Bruxelles,
direction du Trésor, impôts, sécurité sociale, direction du travail etc.) ; le
banquier qui propose, accorde ou retire des liquidités dont il fixe le prix ;
l’actionnaire, sensible comme un cheval ombrageux, qui détermine le cours de
l’action ; les amateurs d’OPA à l’affût d’une baisse du cours.
Pouvoirs internes et externes communiquent : réseaux et directeurs ont des relations avec
les pouvoirs politique et administratif.
Etant tout cela à la fois, l’entreprise ne peut se
réduire à l’une ou l’autre de ses définitions, même si la trivialité du
" business is business ", le " sérieux " des
ingénieurs, l’ " autorité " des dirigeants, prétendent la
résumer chacun en quelques phrases. C’est une entité organique, historique,
culturelle, sociologique. Elle est le théâtre d’une Comédie humaine qui
n’a pas encore trouvé son Balzac : la littérature n’a pas rendu compte de la
vie de l’entreprise, à l’exception de quelques caricatures ou romans policiers
d’ailleurs intéressants. Il est surprenant que la production symbolique, qui
prépare l’imaginaire à interpréter l’expérience, ne se soit pas encore
intéressée au lieu où s’enracinent les projets, angoisses, désirs et
l’identité sociale de chacun.
Personnalité de l’entreprise
Car l’entreprise ne se réduit pas à la superposition des
structures. Elle est aussi une personne. Il s’agit certes d’une personne
collective et institutionnelle, et non d’un être humain ; les relations que chacun
entretient avec elle n’en sont pas moins affectives, comme avec un pays, un village,
une ville, qui " parlent " en reflétant les valeurs, les rêves et
l’esthétique de ceux qui les ont conçus.
Chacun perçoit à sa façon la personnalité de
l’entreprise. Certains sont sensibles au décorum, à l’architecture des
bâtiments, au sérieux des huissiers veillant autour de la direction, à la liturgie des
réunions ; leur fidélité s’enracine dans un sentiment de pérennité.
D’autres sentent la fragilité de l’entreprise, les menaces de la concurrence,
les empiètements de la holding, et une sorte de tendresse envers cet être qu’ils
sentent vivant mais fragile les pousse à le défendre. D’autres sont solidaires de
leur équipe, puis de leur service, de leur direction, enfin de l’entreprise, leur
fidélité variant en raison inverse du nombre des personnes concernées.
L’entreprise suscite ainsi des dévouements, des loyautés d’autant plus
méritoires qu’elle ne les reconnaît et les récompense pratiquement jamais.
C’est cette personnalité de l’entreprise que
l’on évoque lorsque l’on parle de " donner du sens ". Si
nous nous plaçons par exemple au point de vue de l’économiste et de
l’ingénieur, nous définirons cette personnalité par la valeur ajoutée que
l’entreprise entend produire, puis par le processus mis en œuvre pour
produire.
La
valeur ajoutée - écart entre la valeur de la production et celle de la consommation
intermédiaire - suppose qu’il existe une demande : s’il n’y avait pas de
clients pour acheter la production, son prix serait nul et la valeur ajoutée serait
négative.
La compréhension du besoin du client dans la conception du
produit et la détermination de son prix supposent que le marketing contribue à la valeur
ajoutée.
La définition du processus décrit comment les ressources de
l’entreprise - compétences, machines, main d’œuvre - sont organisées et
utilisées. |
Les décisions prises sur ces deux composantes de la
personnalité de l’entreprise (valeurs ajoutées, processus) sont
" stratégiques " au sens précis du terme, car elles impliquent la
responsabilité du dirigeant, du " stratège " dont les décisions
déterminent pour le meilleur ou pour le pire le positionnement de
l’entreprise : types de clients, gammes de produits, partenariats, fournisseurs,
techniques, choix des innovations.
La question du " cœur de métier "
Au centre de ces choix se trouve l’identification du cœur
de métier de l’entreprise : parmi les diverses activités qui s’articulent
dans ses processus, parmi ses produits, quels sont ceux qu’elle considère comme
emblématiques, auxquels elle s’identifie ? Attention : si cette question redoutable
reçoit une réponse erronée, toutes les orientations de l’entreprise seront
faussées.
Or il n’est pas facile de définir le cœur de métier
d’une entreprise. Considérons une administration ou une entreprise produisant un
service public. Quel est son cœur de métier : être au service du public ?
représenter la puissance publique ? conforter le pouvoir d’une corporation ? Elle dira
qu’elle est au service du public, mais ce propos sera souvent contredit par un
comportement méprisant ou indifférent envers l’" usager ".
Quel est le cœur de métier d’un juge : appliquer la
loi, ou évaluer chaque cas particulier à la lumière de la loi en faisant appel à son
bon sens ? Quel est le cœur de métier de l’administration pénitentiaire :
amender ou punir ? s’il s’agit de punition, quelle est sa nature : privation de
liberté ou humiliation de la personne ?
Parfois la définition du cœur de métier subit
l’évolution technique et économique. Les opérateurs télécoms situaient leur
cœur de métier dans le téléphone. Cependant leur réseau est devenu multiservice
avec les données et l’image ; le commerce électronique en a fait une place de
marché qu’il faut équiper pour sécuriser les transactions et faciliter les
médiations. Ceux qui se sont cramponnés au téléphone, et qui ont fait du trafic un
objectif stratégique concrétisé par un critère de gestion (le " delta
minutes "), ont fait prendre du retard à leur entreprise en l’incitant à
se concentrer sur un produit dont le prix diminuait rapidement.
La relation avec le client fait aussi partie du cœur de
métier. Mais lorsqu’une entreprise prend pour slogan " mettre le client au
cœur de l’entreprise ", c’est mauvais signe : si le client était
vraiment " au cœur ", on n’éprouverait pas le besoin de le
dire d'une façon aussi sentimentale. Cela fait penser à ce pays désertique dont la
devise était " Pourvu qu’il pleuve ".
Lorsqu’un opérateur télécom refuse d’introduire
l’identifiant de l’entreprise cliente dans la facture téléphonique, et émet
une facture par ligne, il révèle sa vraie priorité : la ligne compte plus que le
client, puisqu’on s’interdit de le connaître et de le traiter de façon
personnalisée. Il en est de même dans un hôpital lorsqu’on désigne un patient par
le numéro de son lit au lieu de son nom propre.
Les évolutions des métiers, des techniques, de la concurrence
obligent l’entreprise à redéfinir sa personnalité. Les distributeurs automatiques
de billets ont changé les banques ; l’Internet change la relation avec la clientèle
; le TGV a changé la SNCF ; la déréglementation a bouleversé le transport aérien et
les télécommunications. De l’agriculture à l’industrie pharmaceutique, de la
sidérurgie au transport maritime, les entreprises ont été obligées de remettre en
question leurs acquis historiques. Ces mises en question sont difficiles, pénibles, car
modifier la personnalité de l'entreprise a des conséquences sur son organisation
(attributions des directions, structure des compétences) : des plates-bandes sont
piétinées, certaines carrières se ferment et d'autres s'ouvrent.
Mécanismes du changement
Ces changements se font plus facilement par mort et naissance
que par évolution. Certaines entreprises préfèrent couler pavillon haut plutôt que de
s’adapter. IBM, qui avait mis son cœur de métier dans la vente, a failli en
mourir : des vendeurs, même habiles, ne pouvaient pas percevoir les orientations les plus
fécondes du marché alors que le possible technique évoluait dans de nouvelles
directions. Les disparitions de Pan Am, Eastern Airlines, People Express, et de banques
qui furent glorieuses avant de mourir puis d’être oubliées, montrent qu’un
passé prestigieux ne garantit pas la pérennité.
Créée par des pionniers qui pesaient risques et opportunités,
l’entreprise était à l’origine modeste et aventureuse. Après le succès, les
pionniers se sont ennuyés et sont partis ; leur formule a été érigée en recette par
des administrateurs qui en ont fait une paisible routine. Puis les financiers sont venus :
ils ont transformé l’entreprise en vache à lait. Alors ses dirigeants ne cherchent
plus à " changer le monde ", mais à " faire du
business " en accumulant au passage une fortune personnelle. Ses cadres savent
que pour réussir il faut se conformer aux dogmes maison et surtout ne pas faire de zèle.
Les réseaux politiques, syndicaux, corporatistes l’enserrent pour y pomper toute la
richesse et le pouvoir possibles. Ils réagissent devant la nouveauté, la réflexion,
comme des reptiles d’autant plus dangereux que leur cerveau minuscule abandonne tout
le travail à la moelle épinière. Gare au naïf dont l’initiative touche un point
du corps du crocodile : il sera fauché par un mouvement réflexe et broyé
instantanément.
Toute entreprise traverse, durant son histoire, des situations
dont ces notations illustrent la diversité. La direction générale est animée de
conflits dont l’enjeu final est bien, à travers l’entrelacement des intérêts
particuliers, la personnalité de l’entreprise. Sur le terrain et au jour le jour,
cette personnalité paraît stable comme la surface d’un lac qui cache courants et
tourbillons, les échos des conflits internes à la direction s’estompant avec la
distance.
Entreprise et marché
Certains économistes négligent ce qui précède. Leur théorie
suppose les agents rationnels ; une fois choisis le produit et la technologie, ces agents
utiliseraient la combinaison de facteurs qui minimise le coût de production et
produiraient la quantité qui maximise le profit. Cependant, si la concurrence est
parfaite avec libre entrée, le prix finit par être égal au coût moyen minimal, le
profit est nul, et c’est le consommateur qui en dernière analyse bénéficie des
efforts de l’entreprise. On peut enrichir ce schéma en considérant le monopole, la
concurrence monopoliste etc. Peu importe : dans tous les cas, l’économiste fait un
raisonnement statistique et tendanciel ; il postule que les écarts à la rationalité se
compensent à court terme, ou bien s’ajustent à long terme par tâtonnement.
Cependant toute la vie quotidienne de l’entreprise, toute
l’activité de ses cadres et de ses dirigeants, sont absorbées par les tâches que
l’économiste suppose déjà réalisées. Minimiser les coûts de production
n’est pas une mince affaire. Choisir la technologie la plus efficace, déterminer les
programmes d’investissement, cela demande travail et réflexion, et Dieu sait si cela
se discute. Concevoir le produit à commercialiser, définir la politique de prix,
organiser la distribution, c'est construire la personnalité de
l’entreprise.
Comme le raisonnement économique commence lorsque ces
tâches-là sont terminées, il ne les éclaire pas. L’économiste s’intéresse
à l’équilibre général qui leur fait suite, non à la vie même de
l’entreprise. Nous prenons ici un point de vue médical (examiner les
conditions de la santé de l’entreprise) alors que le point de vue de
l’économiste, légitime dans son ordre mais limité, est social (il
considère la contribution de l’entreprise au bien-être de la société).
Ceci explique un paradoxe. Les partisans du
" marché ", qui souhaitent la disparition de toute réglementation,
se disent en même temps partisans de l’ " entreprise " ;
mais l’entreprise à laquelle ils pensent, c’est celle des économistes qui par
hypothèse a déjà fait ses choix internes de façon optimale ; ce n’est pas
l’entreprise en train de faire ses choix, de construire sa personnalité. Cette
entreprise-là est antérieure au marché auquel elle se prépare ; les clés de sa
démarche interne ne sont pas " marché " et
" liberté ", mais " organisation " et
" décision ". Il s’y produit certes des échanges
(d’idées, d’informations, de documents) mais ils ne sont pas marchands. Il
s’y crée un équilibre (des forces en présence), mais ce n’est pas celui que
les prix d’équilibre instaurent sur le marché. Le marché, c’est l’espace
externe à l’entreprise dans lequel elle se meut. Elle s’y réfère, y trouve
des points de repère ; toutefois sa logique interne n’est pas marchande.
Pathologie de l'entreprise
Par ailleurs, si " rationalité "
et " information parfaite " sont deux postulats qui permettent de
construire un modèle économique simple et puissant, il est par contre difficile de
modéliser une économie où les agents ne sont pas rationnels (par exemple, de prendre en
compte les erreurs d’anticipation et les réactions qu’elles suscitent a
posteriori) et où l’information est imparfaite (incomplète, dissymétrique
etc.) : ces modèles se présentent sous forme d’arbres de choix dont
l’exploration est fastidieuse et dont il est difficile de tirer une synthèse. Le
modèle rationnel s’impose dans l’enseignement de l’économie non parce
qu’il représente fidèlement la vie de l’entreprise, mais par sa simplicité et
sa puissance logique.
Il est alors difficile pour un économiste de se représenter
une entreprise malade. Ceux qui témoignent des pathologies sont soupçonnés
d’exagération. L’entreprise bénéficie d’ailleurs, outre le préjugé de
rationalité, d’un préjugé de sérieux. Elle impose à ses salariés des règles
salubres de discipline et de ponctualité. Les normes de sécurité sont rappelées dans
ses bâtiments. Le formalisme comptable passe pour une garantie d’objectivité. La
hiérarchie bénéficie d’une légitimité que seuls de mauvais esprits peuvent
mettre en doute, tant l’unité de commandement semble nécessaire.
D’ailleurs l’entreprise produit. Les trains ROULENT
circulent, les avions volent, les machines à laver lavent, les automobiles sortent des
usines prêtes à circuler. Rien de tout cela n’aurait lieu, croit-on, si les
entreprises étaient malades.
Et pourtant il arrive qu'elles le soient, qu’un dirigeant
soit un incapable, qu’une règle soit erronée, qu’une convention comptable
aille au rebours de la réalité économique et suscite des décisions fausses, que
l’autorité de la hiérarchie couvre des abus. Ainsi une entreprise qui marche
certes, et même dégage le profit sans lequel elle ne pourrait longtemps survivre, peut
pourtant ne pas être efficace en ce sens qu’elle gâche une partie des ressources
qu’elle utilise.
Lorsque l’énergie d’un directeur est consacrée à la
défense de sa plate-bande, c’est autant de perdu pour l’efficacité (il
faudrait un miracle permanent pour que l'efficacité résultât d'une conjonction de
tactiques défensives : pourtant les économistes, lorsqu'ils veulent faire taire les
considérations médicales, postulent ce miracle). Les entreprises malades marchent, mais
leurs coûts de production ne sont pas minimisés, leur profit n’est pas maximisé,
elles ne contribuent pas de leur mieux au bien-être social, et ceci sans même évoquer
les externalités (environnement etc.).
Pour bien nous comprendre, considérons les gens dans la rue.
Ils n’ont peut-être pas tous bonne mine, mais ils marchent, font leurs courses, vont
travailler. Il faut être médecin et les voir en consultation pour déceler les maladies
dont ils souffrent et leur recommander un traitement. Il en est de même des entreprises.
Derrière la façade de sérieux et de professionnalisme, l’examen médical détecte
les pathologies. Souvent elles sont très visibles de l'intérieur ; elles ont été
signalées par des personnes de bon sens, mais comme elles sont utiles à certains
pouvoirs elles perdurent. Le consultant redit ce que disaient déjà des personnes de
l’entreprise - mais il le dit à partir d’un point neutre, car il ne fait pas
carrière dans l’entreprise et il est aisé de l'en faire partir. Si sa parole semble
une révélation, c’est que sa neutralité la rend audible alors que l’on était
resté sourd au bon sens interne.
S’intéresser à la pathologie des entreprises, ce
n’est pas faire du mauvais esprit, mais manifester envers ces êtres vivants la
sollicitude, le respect, la délicatesse que le médecin doit éprouver envers son
patient.
|