|
Commentaire sur :
Edward N. Luttwak, Le grand livre de la
stratégie, Odile Jacob 2002
18 décembre 2002
Luttwak m'avait enchanté par le brio de Turbo
Capitalism, même si je ne partage pas son pessimisme radical. Le
grand livre de la stratégie est intéressant, mais sans brio ; peut-être
est-ce dû à la traduction.
L'analyse stratégique de Luttwak se fonde sur le
concept de "point culminant de la victoire" inventé par Clausewitz : l'agresseur
s'étant mieux préparé au combat que son adversaire, l'attaque est d'abord
victorieuse. Mais à mesure que l'armée avance dans le pays conquis, ses forces
déclinent en raison de l'allongement des lignes de communication et de la
fatigue des soldats. Par contre les forces du pays agressé s'accroissent : il
apprend à déjouer les tactiques de son ennemi, ses lignes de communication se
raccourcissent, sa volonté de résistance augmente. Il arrive un moment où les
deux forces s'équilibrent : alors le pays agressé peut passer à l'offensive.
Cette analyse s'applique parfaitement aux campagnes de Russie de l'armée
napoléonienne et de la Wehrmacht.
Luttwak l'applique aussi aux innovations
techniques : elles donnent un avantage momentané à celui qui possède le
meilleur canon, le meilleur radar, le meilleur sous-marin etc., mais après un
délai l'ennemi trouve la parade et l'innovation est neutralisée. Ainsi la
durée de vie pratique d'une innovation technique est, dans le domaine
stratégique, d'autant plus courte que cette innovation est plus importante. Par
contre, des innovations de moindre portée peuvent avoir une durée de vie
longue parce que l'ennemi ne se soucie pas de les contrer. C'est l'un de ces
"paradoxes de la stratégie" que Luttwak se plaît à relever.
Alors que l'ingénieur est confronté à la
nature, à une matière dont il s'agit de tirer le meilleur parti économique,
le stratège est confronté à un ennemi qui se comporte, qui réagit à
ses initiatives et s'efforce de les contrecarrer. Certes le
travail sur la matière peut apporter des surprises, aucune théorie ne pouvant rendre compte de toutes ses propriétés ; mais du moins la matière n'a
pas l'intention de réduire à néant les efforts de l'ingénieur (la conception des systèmes d'information se
heurte, notons le, au même problème de comportement ; certes les
utilisateurs ne sont pas les ennemis du SI, mais ils ont d'autres priorités que
son bon fonctionnement et il arrive qu'ils prennent des initiatives
déconcertantes).
Luttwak distingue cinq couches dans la stratégie
: la technique qui concerne la conception des armes ; la tactique
qui concerne la mise en oeuvre des armes (et des êtres humains) sur le terrain
; l'opérationnel qui traite de la coordination des divers éléments
tactiques (chars, avions, approvisionnements etc.) nécessaires pour livrer
bataille ; la stratégie de théâtre, qui embrasse l'ensemble des
opérations dans la longue durée et sur une surface géographique étendue
(pays ou continent) ; la grande stratégie enfin, où s'opère la
jonction entre la dimension militaire et la dimension politique et où se
déterminent les buts de guerre.
A l'intérieur de ce modèle en couches, l'analyse
peut être soit verticale (relation entre les dimensions technique, tactique,
opérationnelle etc. de la stratégie), soit horizontale (exigence de cohérence
à l'intérieur d'une même couche, qu'elle soit technique - cohérence des
armements -, tactique - articulation de la mise en oeuvre des armes,
etc.).
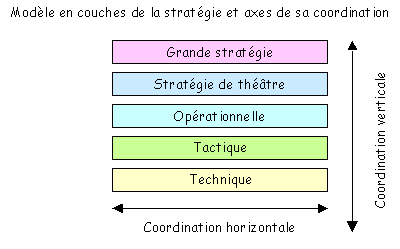
La contrainte de cohérence horizontale la plus
forte est celle qui réside dans la "grande stratégie". C'est en
effet dans l'articulation entre le militaire et le politique que se gagnent ou
se perdent des guerres entre le fort et le faible, entre une armée moderne,
bien équipée au plan technique, et une armée de résistance ou de guérilla.
L'armée du pays fort est potentiellement victorieuse puisqu'elle est
physiquement en mesure d'exterminer le pays faible. Mais elle est contrainte à
contenir l'usage de sa force par des considérations politiques : le pays fort
qui exterminerait un pays faible serait victime d'une réprobation universelle, voire d'une crise d'identité de sa propre population.
La grande stratégie doit tenir compte, dans l'évaluation du rapport des forces,
non seulement de l'équilibre physique des armes mais de l'équilibre
psychologique ou culturel des populations. C'est ainsi que le Vietnam, incapable
de bombarder les États-Unis alors que ceux-ci pouvaient le bombarder autant
qu'ils le voulaient, et donc physiquement inférieur, a pourtant vaincu.
La défaite du pays fort sera d'autant plus
probable que celui-ci supporte moins bien la mort de ses soldats. L'opinion des
grands pays, dit Luttwak, a radicalement changé : pour les familles nombreuses
de naguère, la mort d'un fils au combat était certes un drame mais elle ne
compromettait pas la survie de la lignée ; alors que c'est le cas
aujourd'hui où les familles ont peu d'enfants, voire un fils unique. D'où la
doctrine du "zéro mort" dont Luttwak ne relève d'ailleurs pas le
caractère odieux : certes, personne ne souhaite la mort d'un soldat, mais
que penser des militaires qui bombardent et tuent sans prendre aucun risque
personnel, comme
si la guerre était un jeu vidéo ? Si un pays fort adopte la
doctrine du "zéro mort",
le pays faible qui accepte la mort de ses soldats pourra le faire plier. Si les
États-Unis décident de faire la guerre à l'Irak et si celle-ci se
révèle coûteuse en vies américaines, que penseront en effet les
Américains ?
Il arrive qu'une victoire tactique soit une
catastrophe stratégique : comme le Japon était incapable d'envahir le
territoire des États-Unis, il aurait mieux valu pour lui rater l'attaque contre
Pearl Harbor et négocier une paix de compromis. Il arrive aussi qu'un nom de
bataille acquière un tel poids symbolique que les chefs militaires s'estiment contraints de
lui consacrer des moyens, et d'accepter des sacrifices, hors de proportion avec
l'intérêt stratégique du site : ce fut le cas, dit Luttwak, pour Verdun et Dien Bien Phu.
L'un des passages les plus intéressants est
celui qu'il consacre à l'analyse de la Blitzkrieg ("guerre éclair"),
stratégie utilisée par la
Wehrmacht contre la Pologne, la France puis la Russie. Face à une armée qui
s'aligne le long d'un front continu, la Wehrmacht concentre ses moyens sur quelques
points où elle opère une percée tout en menant sur d'autres points des
opérations de diversion ; elle lance dans chaque percée une colonne
blindée qui avance rapidement ; l'ensemble convergent de ces percées découpe
le territoire cible comme en autant de parts de tarte.
La riposte adéquate serait d'attaquer
les
percées sur leurs flancs et de colmater le front pour couper les blindés de leur approvisionnement : en panne d'essence,
ils deviendraient
inoffensifs. Mais l'État-major croit préférable de céder du terrain pour reconstituer un
autre front continu. Il donne donc un ordre de repli ; cette manœuvre difficile suscite un désordre que l'ennemi s'ingénie
à accroître et qui entraîne l'effondrement de l'armée cible (voir "L'étrange défaite",
de Marc Bloch).
La profondeur géographique de l'URSS lui a
permis, repli après repli, d'user la force de l'assaillant puis de mettre au
point une stratégie efficace. La dimension de la France était trop réduite, sa
capitale trop proche de la frontière, sa doctrine d'emploi des armes trop
désuète pour qu'elle ait le temps de trouver une parade aux innovations de la
Wehrmacht.
|