|
L’être humain est, sans doute, conscient de son
individualité depuis la naissance de l’humanité voici trois millions d’années.
Le précepte de Socrate, « connais-toi toi-même », « γνωτι σεαυτον », l’invite
depuis l’antiquité à observer et étudier son individualité. Les stoïciens, tout
comme les épicuriens, avaient pour but le perfectionnement de l’individu ; le
salut, but de la foi chrétienne, est lui aussi individuel.
L’individualisme n’a donc jamais pu constituer
une nouveauté radicale. La nouveauté de l’individualisme moderne consiste à
attribuer à l’individu la primauté métaphysique, à l’identifier à l’être
lui-même, à faire de lui le centre et le pivot de l’univers à tel point qu’il
est devenu difficile, une fois ce point de vue adopté, de penser des
phénomènes collectifs par nature comme la formation et l’apprentissage des
langues, l’éducation des enfants, voire la simple (si l’on peut dire) relation
d’altérité dans le couple ou la vie sociale.
Rôle libérateur de
l’individualisme
Pour mesurer la nouveauté de l’individualisme
moderne, il faut se remémorer l’organisation sociale et les valeurs contre
lesquelles il s’est construit.
Les structures sociales de la société médiévale
ont, tout en se transformant, survécu en France jusqu’à la Révolution[1].
Or si l’individu existait bien sûr dans cette société, il n’y occupait pas la
place principale. Vivant dans un monde où la violence était quotidienne, il
était en effet très instable[2].
Ses serments étaient aussi peu fiables que sa mémoire, qui s’appuyait rarement
sur l’écrit. La forte mortalité infantile, la vulnérabilité devant les
épidémies, violences et famines, interdisaient de s’attacher à lui.
La famille offrait des repères plus solides, une
pérennité plus sûre. Elle pouvait, mieux que l’individu, respecter des
engagements et donc conclure des contrats. L’existence de l’individu était ainsi
soumise à celle de la famille : chez les nobles l’honneur du nom, qui se
défendait sur les champs de bataille ou dans les duels, importait plus que la
vie de l’individu. La carrière de celui-ci était délimitée par la situation
sociale de sa famille, situation dont il ne pouvait s’émanciper que de façon
exceptionnelle et en prenant les risques que court tout aventurier[3].
Cependant l’économie moderne, industrielle et
mécanisée, exigeait que pût s’affirmer l’autorité des « talents », des personnes
compétentes (artistes, ingénieurs, organisateurs, entrepreneurs, officiers)
seules capables de maîtriser les nouvelles techniques de création, de
production ou de combat : la promotion de l’individu était donc nécessaire à
l'épanouissement de cette économie.
Revenir au sens étymologique du mot
« technique »
La
racine de ce mot est le grec Τεχνη qui signifie savoir-faire, art,
talent, aptitude à l’action. Si l’on débarrasse le mot
« technique » des connotations qui l’encombrent pour revenir à sa racine, la
technique, c’est le savoir-faire[4].
Le
savoir-faire n’a pas de dimension morale puisqu’il peut être mis au service
des buts les plus divers, qu'ils soient bons ou mauvais. Personne cependant ne
peut faire l’apologie de la maladresse, pas plus que l’on ne peut faire
l’apologie du gaspillage. Pourtant nombreux sont ceux qui exècrent la
technique : ils lui associent la pollution de la nature, l’exploitation de la
force de travail, l’étroitesse d’esprit etc. Ces connotations proviennent non
de la technique elle-même, mais d’une industrialisation mal conçue ou d’une
spécialisation excessive.
On peut dater l’origine de l’individualisme
moderne du Quattrocento de la Renaissance italienne. Il s’agissait, certes,
d’une libération, mais elle fut payée par la rupture de la cohésion culturelle
de la société médiévale. La classe « cultivée », férue d’humanités antiques,
s’est détachée alors du peuple pour rechercher la « distinction » qui culminera
à la Cour des rois[5].
La première formulation explicite de
l’individualisme se rencontre chez Montaigne : « C’est moy que ie peinds (...)
ie suis moy-mesme la matiere de mon Liure[6] » ;
cette affirmation sera reprise par Rousseau : « Je veux montrer à mes semblables
un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi[7] ».
L’individualisme a rencontré de vigoureuses
résistances. Pascal contredira Montaigne : « Le moi est haïssable[8] ».
Au XXe siècle l’individualisme devra lutter contre la coalition
hétéroclite, mais puissante, du marxisme, de la psychanalyse, de la sociologie,
de la linguistique et du surréalisme[9].
Il finira cependant par s’imposer vers la fin du siècle avec le triomphe du
libéralisme économique.
* *
La théorie économique s’est en effet bâtie sur
l’individualisme méthodologique d’Adam Smith[10] :
« (...) He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases,
led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention
(...) By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society
more effectually than when he really intends to promote it. I have never known
much good done by those who affected to trade in the publick good ». Les racines
de cet individualisme plongent dans la religion protestante qui, postulant une
relation directe entre Dieu et l’individu, a libéré celui-ci des contraintes
sociales et familiales ainsi que de la tutelle de l’Église[11].
L’individualisme s’épanouit au plan culturel au
XIXe siècle avec le romantisme, nourri des intuitions « géniales » et
des émotions de l’individu comme des troubles et crises qui accompagnent la
formation de sa personnalité.
Si les talents furent ainsi libérés au bénéfice
de l’économie, de la science, de la technique et de la création artistique, ce
fut en soumettant l’individu à une tension psychologique des plus pénibles.
Libéré des contraintes sociales, il ne pouvait plus en effet s’expliquer ses
éventuels échecs que par une incapacité dont la conscience était inévitablement
douloureuse. La société se divisait non plus entre nobles et roturiers mais
entre « gagnants » et « perdants », les premiers n’étant eux-mêmes jamais sûrs
de la pérennité de leur succès[12]
: l’individu libéré porte seul l’angoisse de la réussite tout comme le
protestant porte seul l’angoisse du salut[13].
La mort, qui certes n’a jamais été pour personne
une perspective réjouissante, est devenue sous le règne de l’individualisme une
monstruosité métaphysique et un objet d’horreur : comment en effet comprendre
que l’être, que l’on a condensé dans l’individu, puisse cesser d’être ? L’Église
offrait sans doute des perspectives consolantes mais le doute torturait même les
croyants. La médecine, la justice firent de la vie biologique un absolu au
détriment du sens de la vie lui-même[14].
Parallèlement le remplacement de la noblesse par
l’élite bourgeoise de l’argent, de la compétence, puis plus récemment des
médias, a suscité la crise des valeurs qui a fourni l’essentiel de ses thèmes à
la littérature du XIXe siècle et du début du XXe siècle[15].
Toute nouvelle élite étant en effet illégitime du fait même de sa nouveauté, sa
prise de pouvoir s’accompagne d’une perte des repères sociaux, esthétiques et
moraux[16].
Cette crise a provoqué à la fin du XIXe siècle, chez les personnes
les plus sensibles, les troubles que Freud a diagnostiqués : hystérie, névrose,
perturbation de la sexualité etc.
Freud a cru ces troubles causés par la
civilisation : l’individu civilisé, contraint de réprimer ses instincts,
vivait pensait-il « au dessus de ses moyens psychiques ». Il a tenté d’expliquer
la guerre mondiale, qui le déconcertait, par un retour en force des instincts :
« la guerre emporte les couches d'alluvions déposées par la civilisation pour ne
laisser subsister en nous que l'homme primitif[17] ».
On peut proposer une autre hypothèse : la guerre
qui a par deux fois ravagé l’Europe au XXe siècle serait plutôt la
tentative de suicide, presque réussie, d’une société qui ne parvenait pas à
assumer les responsabilités dont l’individualisme avait chargé les individus, ni
les possibilités économiques et techniques qui en étaient résultées, ni non plus
les changements sociaux et culturels que ces possibilités rendaient nécessaires.
Lisons Keynes : « Quel extraordinaire épisode de
progrès économique pour l’humanité que celui qui s’acheva en août 1914 ! La
majorité de la population, il est vrai, travaillait dur et vivait de façon
inconfortable, tout en étant semble-t-il raisonnablement satisfaite de son sort.
Cependant tout homme ayant une capacité et un caractère hors du commun pouvait
entrer dans les classes moyenne ou supérieure où la vie offrait, pour un coût
modique et sans trop de tracas, des commodités, un confort et des agréments hors
de la portée du plus riche et du plus puissant des monarques d’autres époques[18]
». Mais cette période heureuse a abouti à la catastrophe : la prospérité ne
suffisait pas à combler le besoin de sens.
Dégradation de l’individualisme
A la fin du XXe siècle, la phase
créatrice de l’individualisme n’est-elle pas achevée ? N’est-il pas parvenu à la
limite de sa fécondité ? N’est-il pas devenu un obstacle pour nos sociétés, ces
sociétés qu’il a contribué à créer en libérant l’individu ?
Dans les pays riches où les problèmes matériels
que pose l’existence ont été pratiquement résolus, où (au moins en moyenne)
chacun peut se loger, se vêtir, se nourrir et élever des enfants, où les ménages
sont équipés d’appareils électriques et électroniques dont naguère les
entreprises elles-mêmes n’auraient pas pu disposer, où l’attention est accaparée
par le spectacle audiovisuel, l’individualisme n’est plus comme jadis sollicité
pour surmonter des difficultés pratiques et acquérir des biens jugés
nécessaires.
Dès lors l’individu se replie sur lui-même,
fasciné par l’apparence que présentent les médias, accaparé par ses émotions,
enfermé dans une représentation du monde qui malgré son caractère abstrait lui
semble naturelle. La culture, excluant le rapport direct entre les êtres
humains, ou entre eux et la nature, se médiatise. L’individualisme se
dégrade.
* *
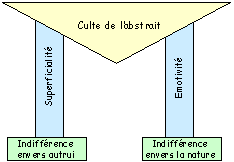
Lorsque l’individualisme arrive en bout de
course, l’émotivité (fondée sur l’indifférence envers autrui) s’associe à la
superficialité (fondée sur l’indifférence envers la nature) pour soutenir le
culte de l’abstrait. Le rapport immédiat entre les individus ou entre eux et la
nature disparaît. L’être humain est alors bloqué comme l’illustre le schéma
ci-dessus : le fronton où s’inscrit le culte de l’abstrait, tournant le dos à
l’action sur le monde, pointe vers le bas.
La dégradation de l’individualisme n’est pas un
phénomène individuel : étant collective, elle frappe les civilisations, les
cultures, les sociétés. La crise des valeurs s’accompagne alors du désarroi, du
désespoir que suscite la perte du sens de la vie.
* *
Nous retrouvons aujourd’hui une situation
analogue à l’avant-guerre que Keynes a décrite : la « nouvelle économie » a
introduit, avec l’évolution de l’informatique, l’automatisation de la
production, l’ubiquité que procurent les réseaux, des possibilités d’une
nouveauté comparable à celle qu’offrait l’industrie au début du XXe
siècle. Les tensions auxquelles les individus et la société sont soumis sont du
même ordre. Même si l’histoire ne se répète jamais, notre début de siècle est
lourd de menaces. Saurons-nous éviter une nouvelle tentative de suicide ? Pour
surmonter la crise de l’individualisme, nous devrons fonder solidement un
humanisme
[1]
Saint-Simon (1675–1755), Mémoires ; Alexis
de Tocqueville (1805-1859), L’ancien régime et
la Révolution, 1856
[3]
Un exemple type des aventuriers de l’ancien régime est fourni par Giacomo
Casanova (1725-1798) : voir ses Mémoires, Brockhaus-Plon 1960.
[4]
Ce mot double, où se condensent la connaissance et la pratique, est (même si
l’habitude nous incite à la considérer comme banale) l’une des expressions les
plus utiles de la langue française : elle fournit au raisonnement une
articulation bien placée. On peut fonder l’édifice des valeurs sur les deux
expressions savoir-vivre et savoir-faire, à condition de les
prendre au pied de la lettre et non à leur sens courant.
[5]
Frantz Funck-Brentano (1862-1948), La Renaissance, Librairie Arthème
Fayard 1935
[6]
Michel de Montaigne (1533-1592), « L’aucteur au
lecteur », Essais, 1580.
[7]
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Les confessions, 1782
[8]
Blaise Pascal (1623-1662), Pensées (n°
455)
[9]
Qui tous ont polémiqué (finalement en vain) contre l’individualisme : le
marxisme en renvoyant l’individu à l’idéologie de sa classe ; la psychanalyse,
en le confrontant à un inconscient pour lui montrer qu’il n’est pas ce qu’il
croit être ; la sociologie, en lui faisant percevoir les conditionnements qui
l’enserrent ; la linguistique, en lui montrant avec le structuralisme comment
la forme de son langage détermine le contenu de sa pensée ; le surréalisme
enfin, en le réduisant à être l’acteur de sa propre imagination.
[10]
Adam Smith
(1723-1790), An Enquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh 1776, vol. IV chapitre II,
(vol. I, p. 456 de l'édition Oxford University Press, 1979)
[11]
Max Weber (1964-1920),
Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1905
[13]
Søren Kierkegaard (1813-1855), Le concept d’angoisse, 1844
[14]
Que reste-t-il du sens de la vie lorsque le médecin prolonge la survie
biologique du malade incurable qui préfèrerait en finir ? Et la prison
n’est-elle pas, plus qu’une privation de la liberté de déplacement, une
privation du sens de la vie ?
[15]
Honoré de Balzac (1799–1850), La comédie humaine, a été suivi par
Marcel Proust (1871-1922), A la recherche du temps perdu (plus
précisément Le temps retrouvé, 1927). Lorsque Mme Verdurin, bourgeoise
qui s’élève dans le champ culturel non sans y commettre des fautes contre le
goût et le tact, devient princesse de Guermantes, et que la duchesse de
Guermantes, incarnation de la culture aristocratique, se met à dire
« énormément de sottises », le remplacement de la noblesse par la bourgeoisie
est accompli.
[16]
Thomas Mann (1875-1955), Buddenbrooks, Verfall einer Familie, 1901 :
dans ce roman, Thomas Mann illustre la thèse selon laquelle l’énergie
conquérante des familles bourgeoises se dissipe lorsque, les générations se
succédant, ces familles s’intellectualisent pour s’adonner enfin au culte de
l’art.
[17]
Sigmund Freud (1856-1939), Considérations actuelles sur la guerre et la
mort, 1915
[18]
John Maynard Keynes
(1883-1946), The Economic Consequences of the Peace, 1919
|