Dans l’économie contemporaine, le capital est devenu le seul
facteur de production des biens : avec l'automatisation, il a évincé le travail. Il en résulte un
bouleversement de la vie en société comme des relations internationales.
Ce phénomène doit attirer notre attention au moins autant,
sinon plus, que ne le fait le réchauffement climatique.
Qu’est-ce que le « capital » ?
Qu’entend-on par « capital » ? Le sens de ce
mot est altéré par les images qui flottent dans notre mémoire : le
« capitaliste » ventripotent, avec son cigare et son haut de forme, enrichi par
la sueur du « travailleur » qu’il épuise ; le « capital financier », source de
tous les maux…
La comptabilité désigne dans le bilan, par
le même mot « capital », un poste du passif (l’apport financier des
actionnaires) et un autre poste qui appartient à l’actif, le « capital fixe »
(les équipements, machines et bâtiments, que l’entreprise met en œuvre). Cette
homonymie provoque des malentendus.
Dans la langue des économistes, par
ailleurs, la « fonction de production » de l’agent « entreprise » distingue deux
« facteurs de production », le capital K et le travail L ; dans les modèles le
volume produit Y est une fonction du capital et du travail, Y = f(K, L), et les
économistes en utilisent diverses spécifications (fonction de Cobb-Douglas,
fonction à facteurs complémentaires etc.).
Dans cette fonction le facteur K est le
capital fixe. Comme nous sommes des économistes, c’est cette dernière acception
du mot « capital » que nous retiendrons : il est vrai cependant que pour pouvoir
se procurer des machines et des bâtiments l’entreprise doit disposer d’un
minimum de « capital financier », éventuellement complété par
l'emprunt.
Capital et travail
Quelle est, dans la fonction de production,
la différence entre « capital » et « travail » ? Le « capital », c’est du
travail stocké, incorporé aux machines et aux bâtiments que l’entreprise
utilisera pour produire - et aussi dans son organisation et son système
d'information, du travail congelé, du travail mort. Le « travail » qui
figure dans la fonction de production, c’est un flux de travail vivant,
c’est le temps de travail nécessaire pour assurer la production.
Bref : le capital, c’est un stock ;
le travail, c’est un flux. Dans une entreprise qui produit des
automobiles, par exemple, les machines, les bâtiments, l’organisation du
travail, le plan du modèle à produire, sont mis en place par un travail qui est stocké
avant que la production ne commence : c’est du capital. Puis les ouvriers
et contremaîtres fournissent, dans la durée, le flux de travail nécessaire à la
production : c’est ce flux qui constitue le travail de la fonction de
production.
Ainsi l’opposition entre capital et travail
n’oppose pas la machine à l’homme, ni la finance à l’être humain. Elle distingue
deux formes sous lesquelles le travail intervient dans la production : le stock
de travail accumulé dans le capital ; le flux de travail qui met en œuvre le
capital pour produire.
Si l’on disait « stock » et « flux » au lieu
de « capital » et « travail », les choses seraient plus claires, les
connotations moins destructrices. Il faut opérer mentalement la traduction
chaque fois que l’on utilise ces mots dangereux. Le raisonnement gagne alors en
vigueur autant qu’en clarté.
Le capital dans la fonction de production
Le flux de travail se mesure selon le nombre d’heures
travaillées L : si le salaire horaire chargé est w, le coût du travail sur un
intervalle de temps (disons, une année) sera wL. On peut distinguer divers flux de
travail selon le niveau de qualification du travailleur : cela dépend du but
que vise la modélisation. Ici nous n’avons pas besoin d’introduire cette
distinction.
Le capital se mesure selon le nombre d’heures de travail K
qu’il incorpore, et son coût d’achat est donc wK. Mais comme il s’agit d’un
stock, et non d’un flux, on ne doit pas imputer la totalité de ce coût à un
intervalle de temps. Si le capital s’use, on doit imputer sa perte de valeur à
l’intervalle de temps (amortissement). En outre si l’on n’avait pas immobilisé
dans le capital fixe la somme wK on aurait pu la placer sur le marché
financier et elle aurait rapporté un intérêt : stocker le capital suscite un
manque à gagner dont il faut tenir compte. Le coût d’usage du capital est
donc, sur une année, (δ + r) wK, où r est le taux
d’intérêt et où δ mesure l’usure et le rythme
d’obsolescence (perte de valeur par écart à l’état de l’art) du capital.
On peut, comme pour le travail, distinguer divers types de
capital : ici nous pourrons supposer le capital homogène, faisant comme si
l’économie considérée utilisait un seul type d’équipement.
Supposons que le capital ne s’use pas (δ
= 0) et mesurons-le en prenant pour unité de volume la quantité de travail U
telle que wU = 1. Alors l’expression du coût des facteurs de production sera wL
+ rK.
Si le produit se vend au prix p, l’entreprise qui veut produire
la quantité Y choisira combinaison de K et de L qui maximise l’expression pY –
wL – rK sous la contrainte Y = f(K, L). La solution de ce programme détermine
K et L en fonction de Y ; elle détermine donc aussi la fonction de coût
c(Y) = wL(Y) + rK(Y). Le profit sera alors Π(Y) = pY –
c(Y), expression qui permettra à l’entreprise de déterminer le niveau de
production qui maximise son profit.
Forme de la fonction de coût
La forme de la fonction de coût dépend de
celle de la fonction de production f(K, L). Or celle-ci a évolué dans
l’histoire : l’importance du capital ayant crû relativement au travail, le
« stock » a pris une place de plus en plus importante par rapport au « flux ».
L’importance relative du capital par rapport
au travail s’évalue par le rapport K/L que l’on appelle « intensité
capitalistique ». Plus une économie est capitalistique, plus la part du travail
stocké est importante par rapport au flux de travail vivant, et plus le travail
vivant est en principe « productif » (puisqu’il dispose d’un outillage plus
puissant).
L’examen de l’histoire est éclairant ; nous
procéderons à très grandes mailles.
A l’époque de nos lointains ancêtres
chasseurs-cueilleurs, le prélèvement opéré sur la nature était pratiquement
fonction du seul flux de travail vivant et le travail stocké était négligeable.
Au néolithique, avec la naissance de
l’agriculture et de l’élevage, de premières formes de capital fixe
apparaissent : stocks d’animaux (« cheptel »), de semences, d’instruments
agricoles, construction des villages puis des villes autour des places de
marché. Le travail se partage alors entre l’élaboration du stock et le flux de
travail vivant.
L’industrie naît au XVIIIe siècle
avec la mécanique et la chimie. A travers les péripéties de la lutte des classes
s’établit progressivement, entre les maîtres du capital fixe (« capitalistes »)
et les fournisseurs de travail (« travailleurs »), un équilibre dont chacun tire
parti : le « marché du travail » fournit à l’industrie le flux de travail
nécessaire, les salaires distribuent le pouvoir d’achat qui procure un débouché
à la production. Le système éducatif fournit à l’industrie la main d’œuvre
compétente et (autant que possible) disciplinée dont elle a besoin.
Il en résulte un type de société spécifique,
diversifiée en variantes dont certaines étaient extrêmes (l’organisation
nationale-socialiste de la Wehrwirtschaft était dominée par la production
d’armements, la planification soviétique considérait l’ensemble de l’économie
comme une seule entreprise), mais toujours fondée sur la maîtrise des techniques
de la mécanique et de la chimie ainsi que sur les formes d’organisation qui
conviennent à leur mise en œuvre.
A partir de 1975 se met en place, avec
l’informatisation, une nouvelle forme d’économie. Les outils fondamentaux de
l’informatique que sont les composants microélectroniques et les logiciels
stockent un travail de conception après lequel il n’est pratiquement plus besoin
de faire intervenir le travail vivant : leur production étant purement
capitalistique, le capital est devenu le seul facteur de production – ou,
pour être plus explicite, le travail est désormais intégralement stocké et
n’intervient plus dans la production sous forme de flux.
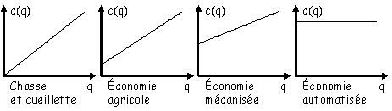
Cette forme de production s’étend, depuis
les techniques fondamentales, vers les produits qui les utilisent intensivement
(ordinateurs, réseaux) ; puis elle se dissémine vers tous les autres produits :
dans le coût de production d’un avion, d’une automobile, la part de la
conception est prédominante et le coût marginal de production est faible.
Conséquences de la production « à coût
fixe »
Pour modéliser efficacement cette économie,
il est judicieux de supposer que le coût marginal de production des biens est nul : la production de
l’entreprise est alors « à coût fixe ».
Il en résulte une économie présentant des
traits inédits et même déroutants (voir
e-conomie). Le
travail est entièrement stocké : plutôt qu’une économie de l’information, il
s’agit d’une économie de la conception (ou si l’on veut du design).
La valeur ne s’exprime plus selon la quantité disponible de chaque produit
(puisque le coût marginal est nul), mais selon la diversité et la qualité des
produits disponibles.
Comme le volume de l’emploi n’a plus de
rapport avec le volume de la production des biens (une même conception peut, selon la
réponse du marché, donner lieu à une production faible ou importante), le lien
qui dans l’économie industrielle reliait l’emploi au volume produit se trouve
rompu.
La recherche du débouché maximal, associée à
la baisse du coût du transport (que l’on peut supposer nul tout comme le coût
marginal), incite l’entreprise à se placer sur le marché mondial : la
mondialisation en est la conséquence naturelle. Elle introduit une deuxième
rupture sur le marché du travail : l’économie, cherchant son débouché dans le
monde, ne voit plus dans les salaires le gage d’une demande future mais
seulement un coût qu’il convient de réduire pour être compétitif.
Les effectifs dont l’économie a besoin pour
concevoir des produits de qualité sont compétents et peu nombreux : un système
éducatif conçu pour procurer à l’industrie des exécutants qualifiés et dociles
est inapte à former des concepteurs, et les exécutants qu’il produit en masse
risquent de ne pas trouver d’emploi.
Dans l’entreprise, les relations n’obéissent
plus au formalisme de la discipline mécanique « à la prussienne » que l’on avait
pu croire nécessaire dans l’industrie : un concepteur ne pouvant être fécond que
s’il se sent écouté et respecté, le « commerce de la considération » devient un
élément important de la gestion.
La conception de produits efficaces repose
sur une analyse fine des besoins, sur une segmentation de la clientèle : le
marketing, entendu au sens de « science des besoins », devient une discipline
clé.
Capital et risque
Le risque va croissant avec
l’intensité capitalistique. L’acquisition de capital fixe, c’est-à-dire
l’investissement, est en effet toujours un pari sur le futur : celui qui
investit suppose qu’il sera possible de réunir le travail vivant nécessaire pour
faire fonctionner les équipements, et que les produits pourront se vendre à un
prix permettant de rémunérer les facteurs de production et, si possible, de
dégager en outre un profit extra.
Mais c’est là raisonner sur des anticipations, donc sur un futur
essentiellement incertain.
A l’incertitude du futur s’ajoutent les
aléas d’une violence qui, elle aussi, va croissant avec l’intensité
capitalistique. Dès le néolithique le stock accumulé (troupeaux, semences) a été
une proie tentante pour les prédateurs : s’il y avait eu des conflits entre
tribus de chasseurs-cueilleurs, l’examen des blessures sur les squelettes montre
que la guerre proprement dite est née au néolithique. L’économie industrielle a
dû maîtriser son approvisionnement en matières premières et les débouchés de ses
produits : d’où l’impérialisme, le colonialisme, et des guerres auxquelles
l’industrie a apporté des armes d’une puissance meurtrière inédite.
Le niveau du capital d’une économie
résultera donc d’un arbitrage entre la productivité que le capital fixe procure
au travail vivant, et le risque que tout investissement comporte. Il résultera
aussi, bien sûr, de l’état de l’art des techniques à l’époque que l’on
considère : l’apparition du machinisme au XVIIIe siècle, celle de
l’informatique au XXe siècle, ont transformé la panoplie des options
possibles et donc modifié la fonction de production.
L’économie du risque maximum
L’économie contemporaine, étant
intégralement capitalistique, est l’économie du risque maximum : les
entrepreneurs qui la dirigent sont des personnes habiles pour anticiper, des
joueurs qui aiment à parier sur l’avenir. Ils devront aussi, pour limiter les
risques, faire ce qu’il faut pour se garantir des approvisionnements (en
compétence) et des débouchés : le recours à la corruption devient une tentation
forte et, pratiquement, irrésistible car celui qui ne corrompt pas est fortement
désavantagé.
Le marché s’équilibre sous le régime de la
concurrence monopoliste qui
détermine le nombre des variétés de chaque produit ainsi que son prix. A chaque
variété correspond, dans l’espace des besoins, un domaine analogue à ce qu’a été
le fief dans l’espace géographique de la féodalité. La concurrence est violente,
chacun des monopoles tentant d’élargir son domaine au détriment des
autres.
Les stocks accumulés par les entreprises
attirent les prédateurs qui pour s’emparer des produits, de la marque, des
compétences, du réseau commercial, des actifs sous-évalués etc. utiliseront des
techniques nouvelles : truquage des comptes, OPA, contrefaçon etc.
Cependant les produits sont devenus des
assemblages de biens et de services, l’avant-vente et l’après-vente ainsi que la
qualité de la relation avec le client devenant essentiels sur un marché où
l’offre s’est diversifiée et où les produits se sont complexifiés. Or la
production à coût fixe ne concerne que les biens : dans les services, et une
fois payé le dimensionnement initial du réseau, on retrouve un coût marginal
significatif. Ainsi l’adéquation fine aux besoins du client, l’utilisation de la
segmentation à des fins de personnalisation (au moins statistique) des produits
génèrent de l’emploi.
Cette économie « nouvelle » (qui est en fait
l’économie contemporaine) possède ainsi des traits dont certains peuvent être
jugés négatifs, et d’autres positifs : rupture de l’équilibre de l’emploi dans
la production des biens, mais création de nouveaux types d’emploi dans les
services ; violence de la concurrence, mais soin dans l’analyse des besoins des
clients, finesse de la segmentation et émergence, dans les entreprises, du
commerce de la considération. Rien n’est joué !
* *
Il n’est pas surprenant que la transition
entre l’économie industrielle et l’économie contemporaine s’accompagne de
crises, de violences. On peut interpréter ainsi les guerres, les tensions
ethniques, ainsi que la place prise par la violence dans le spectacle
audiovisuel. On peut interpréter également ainsi la floraison de la prédation.
Le « laisser faire, laisser aller » du dogme
néo-libéral, appuyé sur une interprétation grossièrement partielle de la « main
invisible » d’Adam Smith, fait le jeu des prédateurs.
Parmi les néo-libéraux, il
se trouve beaucoup d'extrémistes qui voudraient que l'État ne jouât aucun rôle
dans l'économie. Ils oublient que la « main invisible » ne peut contribuer au
bien-être général que si elle est guidée par des règles : la recherche de
l'enrichissement personnel, lorsqu'elle se concrétise par la corruption, les
commissions et rétrocommissions, la contrefaçon des médicaments, la prédation
des ressources naturelles, la mise en coupe réglée des pays pauvres, ne fait que
détruire le bien-être. Il revient à la société elle-même, et donc à l’État qui
est son bras exécutif, de définir les règles qui tiendront les prédateurs en
respect. Pour contrôler l’équité de ces règles on peut s’appuyer sur les
principes qu’a énoncés John Rawls.
Mais même si les règles du
football sont excellentes, quand l’arbitrage est défaillant les parties sont de
mauvaise qualité. Il ne suffit donc pas de disposer de bonnes règles : il faut
aussi qu’elles soient convenablement appliquées. La compétence, l’efficacité de
l’appareil judiciaire sont donc elles aussi des enjeux.
Ce propos contrariera ceux qui
ont subi, dans le cabinet du juge d’instruction, l’incompétence et l’étroitesse
d’esprit d'un magistrat. Mais il ne s’agit pas de donner davantage de pouvoir à
des personnes qui, plus sensibles à la forme qu’au fond, instruisent à charge
plus qu’à décharge et prennent plaisir à tracasser quiconque est plus
riche qu’elles. Pour lutter contre la prédation qui est endémique dans
l’économie contemporaine, il faudra des magistrats d’un type aujourd’hui trop
rare, travaillant avec des outils qui n’existent pas encore en s’appuyant sur
des lois qui restent à définir.
|