|
Paradoxe de l'innovation
Le cerveau individuel est le lieu de naissance de
toute idée véritablement nouvelle. Seul cet organe est capable, en relation
dynamique avec son environnement, d’assurer la synthèse d’un édifice théorique
depuis le choix des concepts qui structurent son langage jusqu’à l’énoncé des
hypothèses qui les relient.
Il arrive que la même
idée naisse simultanément dans deux cerveaux différents parce qu’elle était dans
« l’air du temps » : ce fut le cas de l’invention simultanée du calcul
différentiel et intégral par Newton et par Leibniz, ainsi que de celle du
téléphone par Graham Bell et Elisha Gray. Mais ils ne s’étaient pas concertés
et, si leurs inventions furent simultanées, elles n’en étaient pas moins
individuelles.
Que devient l’idée
nouvelle lorsque que son inventeur l’exprime ? Parfois elle est adoptée comme
une évidence et bientôt elle deviendra banale. Le plus souvent – et surtout si
elle implique des enjeux importants - elle sera considérée comme une
incongruité, une erreur de jugement. Un silence réprobateur l’accueille et on se
détourne de l’inventeur.
Il en est souvent
ainsi lorsque l’idée nouvelle s’exprime dans une entreprise et, plus
généralement, dans une institution. Toute institution est en effet soucieuse
avant tout de stabilité. Son organisation est fragile, les savoirs qu’elle
articule ont été définis de longue main, ses programmes de formation et
processus de travail sont rodés. L’idée nouvelle perturberait cet agencement
délicat. Elle est donc d’abord très naturellement rejetée, parfois avec
violence. Malheur à l’innovateur.
La créativité du
cerveau individuel est donc confrontée à la résistance de l’institution. Cette
confrontation a quelque chose de dramatique si l’on pense aux talents ainsi
broyés – le talent de l’inventeur bien sûr, mais aussi celui des personnes, bien
plus nombreuses, qui auront préféré bloquer leur cerveau pour ne pas prendre le
risque de s’exposer à l’adversité.
Cependant l’idée,
aussi ingénieuse qu’elle soit, ne portera ses fruits que si elle est mise en
œuvre par une institution. Le moteur à réaction, le TGV, le circuit intégré :
ces idées ne pouvaient avoir de conséquences pratiques que si des institutions
industrielles, commerciales, financières se mettaient en branle pour les
réaliser. Ce qui est vrai pour l’évolution technique est vrai aussi pour les
produits culturels : on peut toujours peindre, écrire, composer de la musique,
mais cette activité individuelle restera stérile – et sans doute sera-t-elle
découragée – s’il ne se trouve pas une galerie pour exposer, un éditeur pour
publier, un orchestre pour interpréter les œuvres.
Laissons les produits culturels pour revenir à
l’entreprise. Les historiens qui ont décrit les origines de la machine à vapeur,
du moteur à explosion, du moteur électrique, de l’informatique, de la
commutation de paquets[1]
ont tous évoqué le même phénomène : l’idée qui se
condense dans le cerveau d’un individu est dans un premier temps refusée par
l’entreprise. L’armée française a longtemps refusé l’avion, AT&T le réseau de
données, IBM la communication entre ordinateurs, France Télécom l’Internet etc.
Il est dans l’ordre
des choses que l’entreprise ne comprenne pas l’inventeur. Ce qui est plus
difficile à expliquer, c’est comment cette incompréhension finit par
céder et pourquoi, malgré tout ce qui incite l’entreprise à rester identique
à elle-même, il se produit des innovations et même beaucoup d’innovations. AT&T
a fini par s’intéresser aux réseaux de données, IBM à la communication entre
ordinateurs, France Télécom à l’Internet etc.
Comment bascule
l’opinion d’un dirigeant ? Comment se condense la décision d’un comité de
direction ? Comment une proposition auparavant inaudible devient-elle une
évidence ? Il faudrait, pour le décrire en détail, plonger dans la psychologie
et la sociologie, et aussi dans ce Saint des Saints de la conscience où se
délimite l’évidence.
Nous ne considérerons ici qu’une des dimensions
de l’innovation, la dimension économique : certes l’entreprise ne se réduit pas
à la seule économie, mais c’est sur le terrain de l’économie que se tranche, en
dernier ressort, l’évaluation de son efficacité ; et l’efficacité, c’est l’enjeu
de l’entreprise[2],
le ressort qui anime les phénomènes sociologiques dont elle est le théâtre.
Concurrence, monopole et
régulation
Il semble facile d’expliquer l’innovation par
l’économie : « si l’entreprise innove, c’est parce que l’innovation procure du
profit ». Nous verrons qu’il y a du vrai dans cette proposition banale, mais
elle semble contredire les enseignements de la théorie économique – de cette
partie de la théorie consacrée à la concurrence parfaite qui pèse si lourd dans
les premières années de sciences éco, dans la spécification des modèles comme
dans l’opinion des économistes, car ils ne prêtent pas tous une attention
suffisante aux théories de la concurrence imparfaite[3].
Selon la théorie de
la concurrence parfaite, l’équilibre qui s’instaure lorsqu’un marché est servi
par de nombreuses entreprises et que de nouvelles entreprises peuvent y entrer
librement est un équilibre à profit nul : s’il était possible d’y faire du
profit de nouvelles entreprises y entreraient, l’offre augmenterait et le prix
baisserait jusqu’à ce que le profit s’annule.
Le profit étant nul, le prix est égal au coût de
production. Or on démontre qu’à l’équilibre le coût de production est minimal.
La concurrence parfaite apparaît donc comme la clé de l’efficacité, d’une
efficacité tout entière au service du consommateur puisque le produit lui est
proposé pour le prix le plus bas possible[4].
Il n’en serait pas de
même si le marché considéré était non pas sous le régime de la concurrence
parfaite, mais sous celui du monopole. Il n’y aurait alors sur le marché qu’une
seule entreprise et bien sûr il n’y aurait pas de libre entrée. L’entreprise
pourrait fixer le prix au niveau qui maximise son profit plutôt qu’au niveau le
plus favorable au consommateur.
C’est ce
raisonnement, très simple, qui fonde les politiques en faveur de la
concurrence. « Le monopole, c’est mal ; la concurrence, c’est bien ». Il est
vrai que les abus de monopole abondent dans l’histoire économique : de
Rockefeller à Microsoft, de nombreux magnats ont fait de gros profits sur le dos
des consommateurs. Les législations anti-monopolistes ne manquent donc pas de
fondement.
Toutefois lorsque le
marché est sous le régime du « monopole naturel » - c’est-à-dire lorsque la
fonction de coût du produit est telle qu’il est efficace qu’une seule entreprise
assure la totalité de la production – il serait inefficace de s’opposer au
monopole ; mais il faut alors contraindre l’entreprise, par la voie
réglementaire, à partager avec les consommateurs les fruits de l’efficacité en
pratiquant un prix raisonnable.
Les plus libéraux des
économistes reconnaissent la nécessité d’une réglementation mise en œuvre par un
« régulateur ». Cette agence du gouvernement a pour mission (a) de contraindre
les monopoles naturels à pratiquer un prix raisonnable, (b) de promouvoir la
concurrence dans les secteurs où n’existe pas de monopole naturel, et d’éviter
qu’un monopole de fait ne vienne s’y instaurer par des moyens frauduleux ou
violents.
Efficacité du monopole temporaire
Mais ce raisonnement
suppose que la définition des produits, ainsi que celles de la fonction de
production et de la fonction de coût, soient pérennes. Or l’innovation introduit
des produits nouveaux ou modifie la fonction de production des produits
existants (innovation de procédé).
Lorsqu’une entreprise innove, c’est pour rompre
le cercle dans lequel l’enferme la concurrence. Si elle crée un produit nouveau,
c’est pour bénéficier d’un monopole temporaire pendant le délai
nécessaire aux concurrents pour réagir par une offre comparable, et réaliser sur
ce produit un profit supérieur au profit normal, un surprofit. Si par une
innovation de procédé elle réduit son coût de production, c’est encore pour
réaliser un surprofit pendant le délai qui sera nécessaire aux concurrents pour
adopter le nouveau procédé.
Seule la perspective d’un surprofit explique
que l’entreprise fasse l’effort pénible qui accompagne l’innovation : elle
devra payer le coût de l’investissement, réorganiser ses usines et circuits de
distribution, acquérir des compétences nouvelles, redéfinir les missions et
contours des directions, et tout cela pour un résultat incertain. Pour
récompenser cet effort, il faudra un surprofit élevé.
Le surprofit dépend
du délai pendant lequel l’entreprise pourra bénéficier du monopole temporaire.
Si ce délai est trop court, le surprofit s’évanouit, l’effort de l’entreprise
n’aura pas été payé de retour. Si ce délai est très long, le monopole n’est plus
temporaire : l’innovation aura alors suscité un monopole durable.
Supposons que le
délai soit tout juste suffisant pour que le surprofit rémunère convenablement
l’effort de l’entreprise. A la fin de ce délai, les concurrents auront riposté à
l’innovation soit par une autre innovation, soit par l’imitation. Le profit sera
revenu à son niveau normal. Le rapport qualité/prix du produit s’étant accru, le
pouvoir d’achat du consommateur se sera accru d’autant. Le consommateur sera,
en fin de compte, le bénéficiaire de l’innovation.
Moteur de l'entreprise innovante
Si le surprofit a
convenablement rémunéré l’effort de l’entreprise, celle-ci sera incitée à
innover de nouveau. Ainsi s’amorce le moteur de l’entreprise innovante.
On peut le représenter par un schéma à quatre temps :
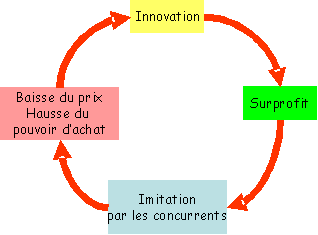
Le caractère
temporaire du monopole est essentiel au bon fonctionnement du moteur de
l’innovation. Pour que le surprofit récompense l’innovation, il faut que
l’entreprise bénéficie d’un monopole ; mais pour qu’elle soit incitée à innover
de nouveau, il faut que celui-ci ne s’éternise pas. Si en effet l’entreprise
bénéficiait d’un surprofit durable, pourquoi se donnerait-elle la peine
d’innover de nouveau ? Un monopole durable fait d’elle une rentière : elle
devient incapable d’évaluer les risques, donc de prendre le moindre risque.
Considérons une économie qui par les effets d’une
réglementation bien conçue, d’un système de brevets bien pensé, ou de tout autre
mécanisme favorable, garantisse aux entreprises innovantes le délai raisonnable
pendant lequel elles pourront faire un surprofit. Alors s’amorce un type de
croissance spécifique, fondé sur l’amélioration renouvelée des produits et/ou la
baisse renouvelée des coûts de production. Le surprofit réalisé pendant un cycle
finance l’effort d’innovation qui sera réalisé pendant le cycle suivant ; puis
le bénéfice de l’innovation est, après chaque cycle, transféré aux consommateurs
sous la forme d’une hausse de leur pouvoir d’achat.
La plupart des modèles économiques de croissance[5]
postulent que la fonction de production et la nature
des produits sont constantes. Si la fonction de coût est à rendement décroissant
– hypothèse qui, au niveau macroéconomique, est vérifiée en raison de la hausse
du prix des facteurs de production lorsque leur demande s’accroît – la
croissance de la production s’aligne à terme sur celle de la population active,
et la production par tête se stabilise.
Pour échapper à une conclusion que l’expérience
des XIXe et XXe siècles contredit trop visiblement, Solow
a introduit le progrès technique comme un résidu et Romer a développé la théorie
de la croissance endogène. Mais il ne semble pas que les économistes aient
modélisé le moteur de l’entreprise innovante. Il ne fait pourtant que formaliser
une expérience familière aux entrepreneurs, chercheurs et ingénieurs, même s'ils
ne la formalisent pas
Il est vrai que le
cycle que parcourt ce moteur peut surprendre ceux qui sont habitués à raisonner
sur une économie à l’équilibre. Lorsque ce moteur tourne, l’économie n’est pas à
l’équilibre mais dans un déséquilibre dynamique qui propulse un régime de
croissance endogène.
Comment le moteur peut être
bloqué
L’un des apports du
formalisme est de mettre en évidence les conditions sous lesquelles le modèle ne
pourra pas fonctionner. Le cycle du moteur de l’entreprise innovante peut être
rompu en deux points : alors il s’arrête.
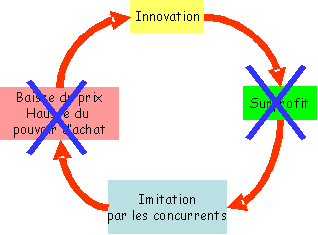
Supposons que
l’entreprise ne parvienne pas à instaurer un monopole temporaire et à tirer un
surprofit de son innovation. Alors elle n’a plus aucune raison d’innover. Cela
peut se produire si, par exemple, le régulateur pousse trop loin le combat
contre le monopole : il faut que le régulateur contienne sa force pour laisser
l’entreprise innovante tirer de son effort un surprofit raisonnable.
Supposons que
l’entreprise parvienne à prolonger indéfiniment son monopole – et elle est
naturellement encline à le faire, car cela accroît ses perspectives de profit
pour un effort moindre. Le cycle sera désamorcé car l’entreprise sera tentée de
se reposer sur ses lauriers
Pour que l'économie puisse bénéficier du régime
de croissance que l'innovation alimente, il faut
que le monopole temporaire dure assez
longtemps, mais pas trop longtemps. La croissance endogène dépend
essentiellement de ce délai, tout comme la puissance que dégage un moteur dépend
de la position de l’accélérateur.
Un petit modèle sans
prétention - et certainement perfectible - permettra d’illustrer le propos.
Modèle de l’entreprise innovante
Considérons une entreprise appartenant à un
secteur où l’innovation est possible. Dans ce secteur, la prime de risque de
l’exploitation courante est π. La prime de risque qui équilibrerait le risque de
l’innovation est π’ > π. Le TRI[6]
d’un investissement courant dans ce secteur doit
donc être au moins égal à i + π, en notant i le taux d’intérêt du marché
monétaire. Le TRI d’une innovation doit être au moins égal à i + π’.
Supposons que le coût de chaque innovation (coût
de l’investissement plus coût de l’effort d’organisation) soit C et que chaque
innovation puisse, tant que dure le monopole temporaire, rapporter rC par an.
Supposons que la phase de monopole temporaire dure d et qu’à l’issue de cette
phase l’innovation ne rapporte plus rien à l’entreprise[7].
Pour que l’innovation
ait lieu, il faut que la VAN (valeur actuelle nette) de l’innovation pendant la
durée d, en prenant pour taux d’actualisation i + π’, soit positive. Cette VAN
est donnée par :
VAN = rC[1 - 1/(1+ i
+ π’)d]/(i + π’) - C
Si d est trop court,
la VAN est négative : l’entreprise ne peut donc pas innover. Si la VAN est
positive, l’entreprise innove.
Supposons que les actionnaires attendent que
l’innovation apporte à l’entreprise une valeur supplémentaire dont ils ont fixé
le montant[8].
Si ce montant est supérieur à la VAN d’une innovation, l’entreprise devra
réitérer l’innovation pour atteindre cet objectif. On vérifie que le rythme
d’innovation est maximal lorsque d est minimal, et décroît lorsque d augmente.
Application numérique
Supposons que i = 5
%, π = 10 %, π’ = 20 %, C = 100, r = 40 %, et que le surcroît de valeur attendu
par les actionnaires soit de 50.
Le surprofit annuel
est (r – i – π)C = 25.
Selon la durée d du
monopole temporaire, la VAN d’une innovation est :
|
d |
VAN |
|
1 |
-68 |
|
2 |
-42 |
|
3 |
-22 |
|
4 |
-6 |
|
5 |
8 |
|
6 |
18 |
|
7 |
26 |
|
8 |
33 |
|
9 |
39 |
|
10 |
43 |
|
11 |
46 |
|
12 |
49 |
|
13 |
51 |
Il faut donc que la
durée du monopole temporaire soit au moins de cinq ans pour que l’innovation
puisse être envisagée. Si d atteint 13 ans, l’objectif en terme de VAN est
dépassé avec une seule innovation.
Supposons que l'entreprise lance une innovation
nouvelle toutes les k années. La valeur ainsi créée est égale à :
VAN totale = VAN/(1-(1/(1+ i + π’)k))
L’intervalle k
nécessaire entre deux innovations pour que l’effort d’innovation dégage une VAN
totale de 50 est d’autant plus faible que d est plus court. Si l’on estime le
nombre N d’innovations par décennie en fonction de d, on trouve le tableau
suivant :
|
d |
N |
|
1 |
0,0 |
|
2 |
0,0 |
|
3 |
0,0 |
|
4 |
0,0 |
|
5 |
13,6 |
|
6 |
5,0 |
|
7 |
3,0 |
|
8 |
2,1 |
|
9 |
1,5 |
|
10 |
1,1 |
|
11 |
0,9 |
|
12 |
0,6 |
Le nombre d’innovations par décennie est maximal
lorsque d = 5 ; il décroît lorsque la durée du monopole temporaire augmente :
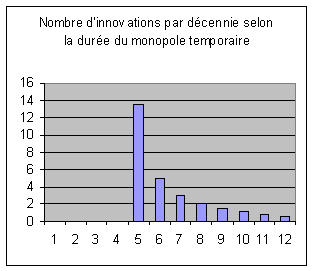
Une fois terminée la période de monopole
temporaire, le surprofit de l’entreprise disparaît en raison de la baisse du
prix et le pouvoir d’achat des consommateurs augmente d’autant. Si le délai du
monopole est de cinq ans, l’entreprise doit lancer une nouvelle innovation tous
les 9 mois. Il en résulte que tous les 9 mois le surplus du consommateur
s’accroît de 25, avec un retard de cinq ans sur la date de l’innovation. Si le
délai du monopole est de six ans, l’augmentation du surplus se produit tous les
deux ans, avec un retard de six ans sur la date de l’innovation.
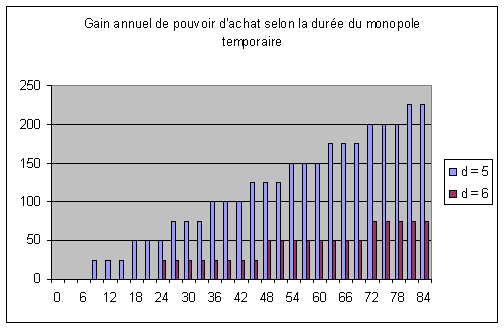
Le gain de pouvoir d’achat des consommateurs,
bénéficiaires ultimes des innovations, croît avec la
fréquence de celles-ci. Il est maximal si le délai du monopole temporaire est le
plus petit de ceux qui rendent positive la VAN d’une innovation.
Bibliographie
Stanley Fischer et Olivier Blanchard, Lectures
on Macroeconomics, MIT Press 1989
Michael D. Intriligator,
Mathematical Optimization and Economic Theory, Prentice-Hall 1971
Paul Romer, "Endogeneous technical change", Journal of Political Economy,
1990
Robert Solow, "A contribution to the theory of economic growth", Quarterly
Journal of Economics, 1956.
Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization, MIT Press 1988
Michel Volle,
e-conomie, Economica 2000
[4]
En fait, toute entreprise est la réalisation d’un
projet qui a fait l’objet d’anticipations incertaines ; le profit doit donc à
l’équilibre rémunérer le risque pris par l’investisseur. L’expression
« profit nul » est inexacte : il faudrait dire « profit normal », le profit
normal étant égal au taux d’intérêt sur le marché monétaire augmenté de la
« prime de risque » jugée nécessaire en raison des incertitudes propres au
projet considéré. Voir
Valeur de l'entreprise.
[6]
Taux de rentabilité interne (Return on
Investment, ou ROI)
[7]
C’est là une hypothèse forte, faite pour
simplifier le raisonnement. En fait, l’entrée de la concurrence ramène le
rendement de l’innovation au taux normal i + π.
|