Résumé
Pour l’entreprise, l’ordinateur n’est pas
une machine de plus, les TIC ne se réduisent pas à une collection de
gadgets : après 1975 l’informatisation a fait émerger l’entreprise
contemporaine qui met en scène l’alliage de l’organisation et de
l’automate en réseau. La nature des produits, la structure de l’emploi et des
qualifications, la forme de la concurrence en sont transformées. Cette
évolution, qui est loin d’être achevée, nous confronte à des possibilités et
des menaces qu’il faut percevoir clairement.
The computer is not
just another machine; IT is not just a collection of gadgets. After 1975 the
contemporary firm resulted from the computerization, putting in action
an alloy between its organization and the networked automaton. Products,
employment and qualifications – as well as the mechanisms of competition –
have been modified. This evolution, far from being accomplished, confronts us
with opportunities and dangers which we have to perceive clearly.
*
*
D’un système technique à l’autre
Qu’il y ait eu une cassure en 1975,
beaucoup d’observateurs le confirment. Selon Nicolas Baverez cette année-là
sépare les « trente glorieuses » des « trente piteuses ».
Mais quelle est la nature de cette cassure ?
Pour l’interpréter prenons pour outil le
modèle des « systèmes techniques » qu’a proposé Bertrand Gille :
chaque époque de l’histoire est caractérisée par une synergie entre quelques
techniques fondamentales. Dans les temps modernes l’entreprise industrielle
naît au XVIIIe siècle de la synergie entre la mécanique et la
chimie ; s’y ajoute vers la fin du XIXe siècle l’électricité, et
cela donne naissance à l’entreprise moderne. En 1975 enfin naît
l’entreprise contemporaine qui exploite la synergie toute nouvelle entre
la microélectronique et le logiciel.
Chaque système technique suscite
progressivement une structure institutionnelle qui lui est adaptée. Lorsque le
potentiel que procure la synergie s’épuise, cette structure résiste de toute
la force de son inertie à l’émergence du système technique suivant : il est en
effet dans la nature des choses qu’une institution, créée au départ pour
remplir une mission, s’organise puis se fossilise, la mission étant perdue de
vue au bénéfice de la reproduction de l’organisation à l’identique.
C’est pourquoi l’invention, qui rend de
nouvelles techniques possibles, ne suffit pas pour faire naître un nouveau
système technique. Il faut aussi qu’une catastrophe inaugurale ait
liquidé les institutions existantes, ou les ait tout au moins suffisamment
affaiblies pour que leur résistance ne puisse pas bloquer la mise en œuvre des
possibilités nouvelles.
Si l’industrie naît avec la
Grande-Bretagne vers 1707, c’est à la suite de la longue révolution qui,
pendant les XVIe et XVIIe siècles, avait bouleversé
l’Angleterre en mettant à bas la cléricature catholique et en exterminant
l’aristocratie pour aboutir enfin à la Glorious Revolution de 1688.
Alors il est devenu possible, dans ce pays et celui-là seul, d’exploiter à
fond les possibilités qu’avaient ouvertes la redécouverte de la pensée
rationnelle à la Renaissance, puis l’invention de la démarche expérimentale
par Galilée.
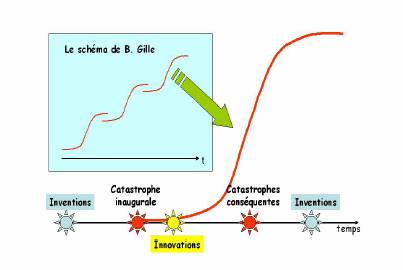
Graphique 1 : dynamique d’un système technique
Quand un nouveau système technique
s’épanouit dans le pays qui, le premier, a su exploiter une synergie féconde,
il lui confère de tels avantages commerciaux et stratégiques qu’il est
inévitablement imité par d’autres pays ; mais dans ces pays-là sa rencontre
avec les institutions en place provoque des catastrophes conséquentes –
c’est une des clés de la révolution française.
L’entreprise moderne, elle, naît dans le
loop de Chicago après l’incendie du 8 octobre 1871 (catastrophe
inaugurale). Elle s’épanouira à partir de 1895 avec la deuxième révolution
industrielle, celle de l’électricité. Chicago a été le premier en date des
centres d’affaires modernes : grâce aux chemins de fer, et surtout après
l’invention du wagon frigorifique en 1877, il est devenu le pivot du négoce
mondial des produits agricoles et de la viande. Autour de ce négoce se sont
créés en quelques années des banques, des assurances, une bourse, des services
administratifs, une université, des industries, bref toutes les activités
propres à la très grande ville y compris la délinquance. L’organisation
méthodique du travail de bureau s’y concrétisa dès 1884 par l’édification du
premier gratte-ciel.
* *
Bien avant 1975, des inventions avaient
préparé des techniques qui étaient prêtes à former une nouvelle synergie : le
premier langage de programmation (Fortran) date de 1954, le circuit intégré de
1958, Arpanet (précurseur de l’Internet) de 1969, le microprocesseur de 1971,
Ethernet de 1973, le micro-ordinateur enfin de 1974.
Mais il fallait une catastrophe inaugurale
pour que ces inventions, donnant naissance à des innovations, fussent mises en
œuvre : la catalyse a été déclenchée par l’embargo sur le pétrole décidé par
l’OPEP le 17 octobre 1973, pendant la guerre du Kippour. Les entreprises
virent alors dans l’informatique une planche de salut.
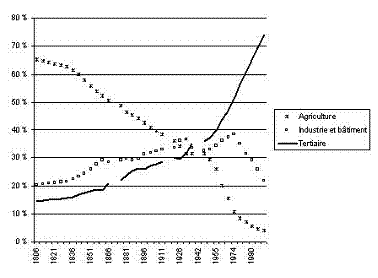
Graphique 2 : évolution de la structure de la population active
Le choc a été violent. L’emploi dans
l’industrie et le BTP,
dont la part dans la population active avait crû de façon pratiquement
continue depuis le début du XIXe siècle, atteint en 1975 son
maximum à 39 % ; puis il entame une décroissance qui ne sera pas même ralentie
par le « contre-choc pétrolier » de 1986. La cassure tendancielle qu’on lit
sur le graphique ci-dessus est révélatrice : en 1975, l’économie française a
changé de nature, tout comme d’ailleurs les économies des autres pays riches.
En 2006, alors que le secteur tertiaire emploie 74,5 % de la population active,
l’industrie et le BTP n’en emploient plus que 21,3 %.
* *
L’esquisse ci-dessus est sommaire. Nous
avons fait l’impasse sur nombre de points importants comme, par exemple, le
rôle du moteur dans la géographie et l’organisation de l’entreprise
industrielle, ou encore l’influence de l’industrie dans le domaine de
l’armement etc. : nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à des travaux
approfondis
et le prier d’accepter, au moins comme une hypothèse dont il explorera avec
nous les conséquences, le schéma que nous proposons. Résumons le :
(A) l’histoire économique se découpe en
épisodes caractérisés chacun par le déploiement d’une synergie entre quelques
techniques fondamentales et cette synergie constitue un système technique ;
(B) chaque système technique met en place
progressivement les institutions nécessaires à son fonctionnement ;
(C) ces institutions, donnant la priorité
à la reproduction à l’identique de leur organisation, perdent leur mission de
vue ;
(D) le passage d’un système technique à
l’autre suppose (1) des inventions, qui rendent possible la mise en
exploitation de ressources naturelles nouvelles ; (2) une catastrophe
inaugurale qui liquide ou affaiblit les institutions en place ; (3) des
innovations concrétisant le potentiel que comportaient les inventions ;
(E) le nouveau système technique naît
d’abord dans un pays pionnier, lui conférant un avantage économique et
stratégique. Les autres pays l’imiteront, ce qui déstabilisera leurs
institutions et provoquera des catastrophes conséquentes.
* *
Pendant un siècle et demi la puissance des
nations s’est mesurée selon leur degré d’industrialisation. Le pays pionnier
était la Grande-Bretagne, qui s’était ainsi hissée au premier rang et que les
autres pays imitaient de leur mieux.
Aujourd’hui, la puissance des nations se
mesure selon leur degré d’informatisation. Les Etats-Unis sont le pays
pionnier. Les autres pays trottinent derrière eux, subissant des catastrophes
conséquentes.
Quels sont les facteurs qui catalysent une
nouvelle synergie, et pourquoi dans un pays plutôt qu’un autre ? Pour
expliquer l’avance prise par l’Angleterre, puis par les Etats-Unis, on peut
évoquer avec Max Weber l’éthique protestante
ou, avec Gramsci, l’hégémonie de l’entreprise parmi les institutions
américaines ;
le lieu où se produit la catastrophe initiale est lui aussi déterminant.
Lorsqu’une nouvelle synergie se déploie
elle est aussi indifférente aux priorités et valeurs humaines que ne peut
l’être un phénomène naturel. L’informatique n’est ainsi ni meilleure, ni pire,
que ne l’a été l’industrie : comme celle-ci le fit naguère, elle se plie aux
désirs de ceux qui la mettent en œuvre et présente donc, liés ensemble comme
un bouquet, autant de dangers que de possibilités.
De ce point de vue rien ne semble plus
nécessaire, aujourd’hui, que de prendre la mesure, de comprendre la nature du
phénomène de l’informatisation
et en tout premier des transformations qu’il provoque dans son lieu
privilégié : l’entreprise.
Alliage de l’APU et de l’EHO
Le mot « ordinateur » et l’anglais
« computer », tout comme l’adjectif « numérique », sont des termes
malencontreux car leurs connotations orientent l’intuition vers de fausses
pistes.
L’ordinateur ne crée pas de l’ordre :
si vous n’y veillez pas vous-même, un désordre inouï s’installe dans votre
répertoire et sur votre disque dur. On n’utilise pas l’ordinateur seulement ni
principalement pour des calculs, des computations : ni le traitement de
texte, ni la messagerie ne relèvent du calcul et s’il est vrai qu’ils se
concrétisent sous forme de 0 et de 1 dans les mémoires et processeurs ils ne
sont pas plus numériques que ne le sont les couleurs pour un peintre,
lequel ne raisonne pas sur des longueurs d’onde.
L’expression qui rend compte de
l’ordinateur, c’est automate programmable ; et comme il ne se sépare
plus aujourd’hui du réseau, nous dirons automate programmable doué
d’ubiquité, APU.
Le canard digérateur de Vaucanson était un
automate mais il n’était pas programmable ; le métier à tisser de Jacquard
obéissait à un programme mais ne pouvait rien faire d’autre que du tissage.
L’ordinateur est un automate essentiellement programmable, fait pour
exécuter tout ce qu’il est possible de programmer : traitement de texte,
musique, vidéo, pilotage automatique d’un avion, commande des robots etc. Il a
fallu un étonnant effort d’abstraction pour concevoir l’automate à tout faire,
sans finalité déterminée mais bâti pour commander des périphériques
spécialisés (écran, imprimante, hauts parleurs, ailerons d’un avion etc.).
L’ordinateur qui se trouve sur notre
bureau est relié, via le réseau local ou l’Internet, à des ressources de
puissance et de mémoire, des serveurs dont la localisation nous est
indifférente : il nous donne ainsi accès à un espace logique,
sémantique, où résident des documents (textes, images, sons) et où la distance
s’exprime non plus selon la géographie mais selon l’intelligibilité ou (ce qui
revient au même) l’intérêt d’un texte pour un lecteur.
L’ensemble que forment notre ordinateur,
le réseau et les serveurs constitue un seul automate, un seul APU car nous ne
faisons pas de différence, lorsque nous utilisons l’écran-clavier, entre les
ressources qui résident sur notre disque dur et celles qui résident sur un
serveur.
Devant l’APU, on ne fait jamais que trois
choses : lire, écrire, lancer des traitements ; mais s’il est tout simple
d’évoquer ces trois actions leur contenu se décline selon une infinie
diversité. Dans l’entreprise, l’APU assiste le travail des agents
opérationnels, des cadres et des dirigeants en leur donnant accès à l’espace
logique et à des outils de traitement.
Entre l’APU et l’être humain s’établissent
ainsi une coopération, une synergie, et pour qu’elles soient fécondes les tâches
doivent se partager selon les aptitudes de chacun des deux partenaires. L’APU
est infatigable dans l’exécution des tâches répétitives, il sait classer et
retrouver des documents, il calcule très vite. L’être humain, pour sa part,
sait comprendre, expliquer, décider. Chacun des deux est maladroit dans ce que
l’autre sait bien faire.
Précisons que l’être humain qui agit dans
l’entreprise n’est pas l’être humain entier, l’individu ineffable que chacun
porte en lui : c’est l’être humain inséré dans une organisation et qui met sa
compétence au service de la production, l’« être humain organisé », EHO.
On peut certes estimer que c’est là une conception limitée, mutilée de l’être
humain ; mais il est sans doute préférable que l’entreprise ne se soucie
pas de l’intimité de ses salariés, de leurs orientations personnelles. Le
fait est qu’elle ne considère que leur compétence professionnelle.
L’entreprise contemporaine se construit
autour de l’alliage « EHO - APU » tout comme l’entreprise industrielle s’était
construite autour de l’alliage « homme – machine ». Alors que la machine avait
pour fonction de soulager l’effort physique, l’APU assiste l’effort
mental que demande la production. L’APU n’est donc pas simplement une
machine de plus, son intervention dans l’entreprise est d’une autre nature que
celle de la machine. Il s’allie à une autre couche de l’être humain, plus
intime et plus délicate sans doute que ne le sont sa musculature et son
squelette.
Intellectualisation de l’entreprise
L’informatisation a suscité une
extraordinaire intellectualisation de l’entreprise. Tous les êtres que
l’action de celle-ci implique (produits, clients, fournisseurs, partenaires,
méthodes, processus etc.) sont en effet dotés d’une doublure informationnelle
qui les représente dans le système d’information (SI) et que l’EHO peut
construire, consulter, enrichir, modifier, commenter, faire circuler, partager
et soumettre à des traitements automatiques. Les processus de
production sont ainsi précédés, accompagnés et suivis par une opération
documentaire qui les prépare, les assiste et les contrôle.
Le système d’information (SI)
L’expression « système d’information » désigne la structure
et le fonctionnement de la doublure informationnelle de l’entreprise.
L’organisation d’un SI articule :
- la DSI, maître d’œuvre de la plate-forme informatique et télécoms
(mémoires, processeurs, réseaux, systèmes d’exploitation, logiciels) qui
rassemble les ressources physiques du SI ;
- les maîtrises d’ouvrage qui, dans chacun des « métiers » de l’entreprise,
sont responsables de la définition sémantique et logique (urbanisation,
modélisation, spécifications) qui guide la réalisation des logiciels dits
« applicatifs ».
Pour mettre au point un SI, il faut sélectionner les êtres
qu'il va
identifier puis choisir, dans la
diversité de leurs attributs, ceux qu’il retiendra et la façon dont il
les enregistrera (codages et nomenclatures). Cela suppose une
pratique de l’abstraction.
Mettre l’abstraction en œuvre au service de
l’action fait émerger, dans la pensée, une démarche sans doute
habituelle dans la vie courante mais que l’intellect a du mal à assimiler.
Alors que la pensée mathématique, sur laquelle s’appuie la philosophie héritée
des Grecs, est fondée sur des définitions et répond donc à la question
« qu’est-ce que c’est » (what is), l’informatique répond en effet à la
question « comment faire » (how to) qui indique à la pensée de tout
autres priorités.
L’algorithmique est par ailleurs un art d’autant plus complexe qu’il doit
jouer avec les limites de l’APU, notamment avec la dimension finie de sa
mémoire.
Orienté vers l’action, le SI accorde plus
d’importance au processus qu’aux concepts – plus précisément il met les
concepts en scène au sein du processus de production dans lequel ils évoluent.
L’« objet » informatique (en fait, le dossier) qui représente un client, un
agent, un produit etc. se transforme ainsi pour enregistrer les événements
survenus dans sa relation avec l’entreprise : il a un « cycle de vie ».
Articuler ainsi le même et la
différence, maintenir l’identité d’un être qui évolue, c’est une
expérience que chacun fait dans sa propre vie puisque nous ne cessons
d’évoluer de la naissance à la mort. Cependant notre pensée, suivant le chemin
inauguré par Parménide et Platon, place plus volontiers l’Être dans des
concepts qui, comme ceux du cercle ou du triangle, ne comportent aucun
changement. Il en résulte qu’elle peine à se représenter
l’évolution et la transformation. La dynamique du SI, le traitement des
questions de synchronisme, parallélisme, concurrence, persistance etc. posent
des problèmes parmi les plus délicats.
* *
Intellectualisation de l’entreprise,
doublure informationnelle, pratique de l’abstraction, approche du réel par les
processus plutôt que par les concepts : ces nouveautés se heurtent, dans
l’entreprise, au réalisme trivial du « business is business », aux
exigences sommaires de la « bottom line » et du profit à court terme, à
l’avidité des actionnaires et des dirigeants, aux soucis de carrière des
cadres etc.
Dans les DSI,
dans les SSII,
auprès des maîtrises d’ouvrage, des agents au statut modeste ou moyen
accomplissent un travail intellectuel que la plupart des entreprises ne
comprennent pas et qu’elles ne savent pas évaluer. Ils rencontrent des
blocages psychologiques, sociologiques, parfois philosophiques et ces derniers
sont les plus difficiles à surmonter. Les particularismes des directions et
établissements s’opposent à la bonne tenue des référentiels ; le goût du
secret et le petit pouvoir que confère le monopole d’une information
s’opposent à la production d’indicateurs ; la crainte du contrôle s’oppose à
la mise en place de workflows ;
la séparation que l’on croit devoir établir entre la pensée et l’action, entre
l’intellect et l’entreprise, s’oppose à la pratique de l’abstraction.
Il s’en faut donc de beaucoup que
l’informatisation soit comprise et bienvenue. Mais elle est à l’œuvre,
irrésistiblement ; elle pousse les entreprises et les fait avancer, même si
c’est à reculons, maladroitement, lentement, en trébuchant sur le moindre
obstacle.
Et si cette évolution interne ne suffit
pas, l’entreprise évoluera encore par le mécanisme des décès et naissances qui
renouvellent continuellement sa démographie.
* *
L’entreprise est une institution, une
organisation formée en vue d’une mission, et toute institution peut être
considérée comme une entreprise si l’on assimile sa mission à un produit.
C’est notamment le cas des grands systèmes institutionnels (parlementaire,
judiciaire, sanitaire, éducatif etc.) dont se sont dotés les pays
industrialisés et qui se sont, non sans luttes et tâtonnements, adaptés aux
besoins de l’économie industrielle.
Mais contrairement à l’entreprise ces
systèmes institutionnels jouissent d’une pérennité au moins apparente qui
s’oppose à leur renouvellement. Imitant l’Église qui en Europe a servi de
modèle à toutes les institutions, ils ont sacralisé leurs procédures ainsi que
la hiérarchie
des pouvoirs légitimes de décision et d’arbitrage. Selon la pente fatale à
toute institution, certains d’entre eux ont perdu leur mission de vue au
bénéfice de corporations auxquelles ils servent de forteresse.
Plus encore que l’entreprise, les grands
systèmes institutionnels résistent donc à l’informatisation de toute la force
de leur inertie. Ils ont milité pour détruire l’informatique, l’expulser comme
un corps étranger et dangereux, et ils ne sont pas pour rien dans l’échec des
tentatives européennes et françaises : Plan Calcul (1966-1975), Plan
« informatique pour tous » (1985).
La poussée de l’informatisation fera
craquer les forteresses et brisera les systèmes institutionnels qui lui
résistent, provoquant ainsi de ces catastrophes conséquentes qui se produisent
toujours lorsqu’un pays imite une synergie qui s’est d’abord déployée ailleurs
(ici, aux Etats-Unis) mais dont il n’a assimilé ni les ressorts, ni la
logique, et dont il se refuse à accepter les conséquences.
L’automatisation et ses effets
L’informatique a permis d’automatiser la
production des biens : c’est ce qui explique la baisse rapide de l’emploi
industriel depuis 1975. La structure de l’emploi s’est transformée. L’usine
automatisée emploie peu d’ouvriers si ce n’est pour l’entretien et l’emballage
des produits, tâches qu’il est difficile d’automatiser. Les usines ne sont
plus ses établissements les plus importants et d’ailleurs la production
physique est éventuellement sous-traitée.
Lorsque la production est automatisée le
coût marginal de production n’est rien d’autre que le coût de fonctionnement
de l’automate, qui est faible. L’essentiel du coût de production se trouve
alors dans l’étape antérieure à la production physique, dans la conception du
produit et la programmation de l’automate. C’est évident dans le cas des deux
produits qui fondent la synergie fondamentale du système technique
contemporain, les circuits intégrés et les logiciels : le coût marginal d’une
puce est négligeable, ainsi que le coût marginal du CD sur lequel est gravé un
système d’exploitation ; par contre leur coût de conception est très élevé (de
l’ordre de 10 milliards de dollars pour un microprocesseur).
Depuis les technologies fondamentales du
circuit intégré et du logiciel cette forme de la fonction de coût se répand
vers les produits qui les utilisent : ordinateurs, commutateurs et routeurs
d’abord, mais aussi automobiles, avions etc. Tendanciellement, la part du coût
de conception dans le coût total de production des biens s’est accrue. Le coût
marginal est devenu faible, parfois négligeable.
L’expression « économie de l’information »
que l’on utilise parfois pour désigner l’économie contemporaine reflète
maladroitement ce phénomène – car s’il est vrai que les travaux de conception
se concrétisent par des plans, programmes, organisations etc. et sont donc
constitués d’information, « économie de la conception » aurait été plus exact.
Comme le coût du transport est lui aussi
devenu faible ou négligeable, et que l’entreprise sera d’autant plus
profitable qu’elle pourra écouler le plus grand volume de son produit, elle va
chercher à desservir le marché le plus large possible : elle s’orientera vers
le marché mondial, qui tend à former une seule économie. Dans l’économie
contemporaine, la mondialisation est ainsi endogène.
En raison de la baisse du coût marginal,
la production se fait à rendement d’échelle croissant : le coût moyen de
production diminue lorsque le volume produit augmente. Il aurait pu en
résulter, dans tous les secteurs qui sont touchés, une situation de monopole
naturel : la plus grosse entreprise serait en mesure d’évincer ses
concurrents, car produisant un plus gros volume elle pourrait vendre à un prix
plus bas que le leur. Les autres entreprises n’ont donc pu survivre qu’en
pratiquant une diversification du produit en variétés correspondant chacune
aux préférences d’un segment de clientèle et en se taillant de petits
monopoles locaux dans l’espace des besoins.
L’offre de chaque produit s’est ainsi
éparpillée en une multitude de variétés, de structures tarifaires etc. entre
lesquelles il est devenu difficile pour un consommateur de trouver ce qui lui
convient le mieux. L’offre a donc dû être accompagnée de services qui aident
le consommateur : intermédiation et avant-vente pour le choix du produit,
installation éventuelle, assistance et formation, maintenance et entretien
périodique, assurances, crédit à la consommation etc.
Le produit
s’est ainsi enrichi d’une offre de services : il est devenu un assemblage
(package) de biens et de services
muni de sa propre doublure informationnelle. Le client qui achète une
automobile, produit physique s’il en est, achète en même temps le conseil que
donne un vendeur pour sélectionner le modèle, le service financier du crédit,
les alertes que le constructeur émettra si un défaut se révèle, une garantie
« pièces et main d’œuvre » pour les réparations, un entretien périodique, une
assurance etc. Le concessionnaire dispose, dans son atelier, de programmes
informatiques qui lui permettent de tester et entretenir le véhicule.
Lorsque le
coût réside dans la conception, le risque est élevé : l’essentiel du coût de
production est dépensé avant que l’entreprise n’ait mis une seule unité du
produit sur le marché, qu’elle n’ait reçu la première réponse des clients,
qu’elle n’ait pu connaître l’offre de ses concurrents. Le risque est d’autant
plus grand que la différenciation qualitative se fait non seulement de façon
horizontale, à coût de production équivalent (couleur d’une automobile, d’une
chemise etc.) mais aussi de façon verticale : la pression de la concurrence
incite à accroître le rapport qualité / prix et pousse le coût de production
vers le haut.
L’entreprise contemporaine est donc dans une situation de risque maximum
et, pour le réduire, elle va le partager avec d’autres entreprises. La plupart
des produits seront élaborés par des partenariats ; une ingénierie
d’affaire établit les contrats qui précisent les responsabilités des
partenaires, ainsi que le partage des dépenses et des recettes. Les processus
de production traversant les frontières des entreprises, les SI devront être
interopérables, le partage des données relatives aux coûts et recettes
devra être transparent.
Ainsi, à
l’alliage « EHO – APU » répondent, dans le produit, un alliage « biens –
services », et dans la production un alliage « partenaire – partenaire ». Une
doublure informationnelle, le SI, assure la cohésion de chacun de ces alliages
ainsi que leur articulation mutuelle.
* *
Le passage
du système technique mécanisé au système technique informatisé s’est
accompagné d’une transformation de la structure de l’emploi (cf. graphique 2).
Dans l’entreprise contemporaine elle tend vers une forme spécifique
(les pourcentages ci-dessous indiquent l’ordre de grandeur de chaque catégorie
; ils varient d’une entreprise à l’autre) :
Structure de l’emploi
– la
direction générale
(stratégie,
gestion des ressources humaines, finance, SI) est située dans le quartier
d’affaire d’une grande ville (10 %) ;
– la conception des
produits se fait dans un
bassin de compétence
où les
concepteurs trouvent un contexte intellectuel et universitaire favorable
(Silicon Valley, Sophia Antipolis, banlieue sud de Paris, Grenoble etc.) (20
%) ;
– la
production des biens
se localise n’importe où dans le monde en fonction des contraintes
juridiques, financières, fiscales, douanières etc. et du coût du transport
(10 %) ;
– un
réseau de services
relie des centres
d’exploitation (serveurs, centres d’appel, traitement du courrier et des
messages, intermédiation commerciale, supervision) dont certains sont
proches du bassin de compétence et d’autres disséminés selon les contraintes
linguistiques (20 %) ;
– les
services de proximité
(conseil,
assistance, installation, maintenance sur site), qui nécessitent de nombreux
emplois au contact de la clientèle, sont répartis sur le territoire
géographique selon une densité proportionnelle à celle des clients (40 %).
L’entreprise demande aux concepteurs d’être inventifs, aux agents
opérationnels de faire preuve d’initiative et de sens des responsabilités. Il
en résulte d’importants changements par rapport à la gestion des ressources
humaines de l’ère industrielle. Celle-ci visait à faire intervenir dans des
conditions sociales aussi paisibles que possible une main d’œuvre disciplinée
qui exécutait le travail répétitif nécessaire pour piloter et assister les
machines.
Dans
l’entreprise contemporaine, l’agent opérationnel intervient sur le terrain
dans un processus de production qui doit être rapide et, autant que possible,
sans défauts. L’entreprise lui attribue donc un pouvoir de décision, quitte à
débriefer a posteriori en cas d’incident.
Par
ailleurs les concepteurs et les experts de la direction générale sont des
spécialistes, ainsi que les agents qui travaillent dans les services supports
(à la DSI, la direction des ressources humaines etc.). Or un spécialiste ne
peut faire bénéficier l’organisation de sa compétence que si l’entreprise sait
l’écouter ; de même, elle doit savoir écouter les informations que les
agents opérationnels rapportent du terrain sur lequel ils interviennent.
En outre,
l’entreprise ne peut être efficace que si les diverses spécialités qu’elle
articule savent coopérer : il faut donc que les spécialistes soient capables
d’écouter ce que leurs disent des personnes appartenant à d’autres
spécialités.
Enfin, la
diversification des produits en variété suppose une segmentation de la
clientèle, fondée sur une connaissance approfondie des besoins des clients ;
la relation de service suppose que l’on sache les écouter.
« Écouter
quelqu’un en s’efforçant sincèrement de comprendre ce qu’il veut dire », c’est
la meilleure définition du respect. Dans l’entreprise contemporaine, le
respect envers les salariés, le respect des salariés entre eux, le respect
envers les clients sont devenus des conditions nécessaires de l’efficacité. La
discipline « à la prussienne » qui, pensait-on, s’imposait dans l’entreprise
industrielle de naguère n’est plus de mise.
Cette
économie du respect ne peut se maintenir que si le respect est
réciproque : cela nécessite un commerce de la considération, une écoute
mutuelle qui s’amorce et se prolonge dans la durée.
Ainsi les
contraintes de l’efficacité incitent, de façon certes fortuite, à obéir à
l’injonction morale qui concerne la qualité des rapports humains. Cette
coïncidence rencontre bien sûr l’opposition des prétendus « réalistes » qui,
confondant la violence et l’énergie, estiment que seule la brutalité puisse
être efficace : comme l’informatisation, le commerce de la considération
rencontre des obstacles et suscite des blocages.
Le fait est
cependant que la capacité à écouter, à motiver et animer une équipe d’experts,
que l’écoute attentive des clients sont de plus en plus souvent jugées
nécessaires.
L’expérience du logiciel libre, dont personne ne peut nier la réussite
économique, a confirmé la nécessité du commerce de la considération pour la
réussite des projets et permis de dégager la silhouette apparemment paradoxale
du « dictateur bienveillant », arbitre coopté ou accepté d’une équipe ou de
l’entreprise tout entière.
Violence
et prédation
L’entreprise, exposée au risque maximum, s’entoure de partenaires pour le
répartir. Mais elle sera aussi soumise à des tentations. Quand on n’est pas
sûr de la pérennité de son marché, quand on se sent menacé par les initiatives
des concurrents, il est tentant d’« acheter les acheteurs » – c’est à dire en
bon français de corrompre les personnes qui, dans les entreprises clientes,
sont chargées de comparer les offres des fournisseurs, de dépouiller leurs
propositions etc. Il faudra pour cela constituer une caisse noire, elle-même
alimentée par des rétrocommissions (part de commission qu’un corrompu
rétrocède à l’entreprise), par des versements en liquide effectués par des
personnes que l’entreprise aura obligées ou par divers procédés comptables
illicites (fausses factures etc.).
L’économie
du risque maximum suscite par ailleurs une ambiance particulière : les
entrepreneurs sont des joueurs qui doivent anticiper non seulement les
événements qui se produiront pendant la partie, mais les évolutions de la
règle du jeu elle-même.
Assumant des risques qui, les faisant chuter, peuvent leur faire perdre le
capital de réputation qui est leur principal patrimoine, ils jugent légitime
de s’attribuer des rémunérations parfois extravagantes et
confortées par des stock options. Ces dernières, les rendant solidaires des
actionnaires, les poussent à accroître au maximum la part du profit dans la
valeur ajoutée au détriment des salaires.
Par
ailleurs l’équilibre qui s’instaure sur le marché des produits obéit au régime
de la concurrence monopoliste :
chaque entreprise est en position de monopole envers les consommateurs qui
préfèrent les variétés qu’elle produit, en concurrence par les prix envers
ceux qui sont indifférents entre ses variétés et celles offertes par d’autres.
On retrouve ainsi, dans l’économie contemporaine qui est aussi la plus
efficace, la plus performante que l’humanité ait jamais connue, une structure
qui rappelle la topographie de l’ère féodale : l’entreprise contrôle un
territoire qu’elle domine (une segmentation tarifaire lui permet d’extraire de
chaque consommateur, comme le font les compagnies aériennes, le prix maximum
que celui-ci est disposé à payer) et cherche à évincer ses voisins contre
lesquels elle mène une guerre de razzias et de conquête.
L’économie industrielle a certes été
violente : la concurrence était rude entre les entreprises et entre les
nations, ses implications sociales et culturelles avaient suscité le désarroi
et on peut sans doute compter parmi les catastrophes conséquentes les guerres
auxquelles l’industrie avait d’ailleurs fourni des armes d’une puissance
inédite. Mais quelle que fût sa violence l’économie industrielle s’était
construite sur le principe de l’échange équilibré : nul n’est
contraint, sur le marché, de vendre ou d’acheter à un prix qui ne lui convient
pas.
On trouvait ainsi, à la base de cette
économie sinon dans tous ses développements, un principe paisible. Le fait est
que sous le règne de l’économie industrielle la population humaine a été
multipliée par six et l’espérance de vie par plus de trois : l’humanité
comptait un milliard d’individus en 1800, six milliards en 1999 ; L’espérance
de vie à la naissance
était de 25 ans en 1800, elle est aujourd’hui de 68 ans dans le monde et de 80
ans en France. Certes le nombre ne fait pas la qualité, mais sous l’aspect
quantitatif au moins l’industrialisation n’a pas nui à l’espèce humaine.
A la base
de l’économie contemporaine, on trouve par contre une violence endémique. De
nombreux témoins constatent depuis 1975 une montée de la criminalité en col
blanc,
de la prédation des patrimoines mal protégés (notamment les ressources
naturelles des pays pauvres),
le tout tirant parti des outils que fournit l’APU pour noircir et blanchir les
fonds, pour corrompre discrètement avec la complicité d’Etats devenus des
« paradis bancaires ».
La corruption, touchant l’entreprise et les grands systèmes institutionnels
eux-mêmes (parlementaires, magistrats, douaniers, policiers, journalistes),
sape l’apport d’efficacité de l’entreprise contemporaine.
* *
L’histoire
enseigne que l’humanité a tenté de se suicider chaque fois qu’un nouveau
système technique lui offrait des possibilités qui, étant nouvelles, l’obligeaient
à bousculer ses institutions et à modifier son organisation sociale, ses
échelles de valeurs et ses critères de légitimité. « Plutôt mourir que
changer », telle semble être la devise de notre espèce. Après la Renaissance
sont venues ainsi les guerres de religion ; après l’industrialisation sont
venus les totalitarismes et les guerres mondiales.
L’optimisme
serait donc coupable car les risques sont élevés. Mais le pessimisme n’est pas
de mise non plus : il ne convient pas d’assimiler comme l’a fait Paul Virilio
la « bombe informatique » à la bombe atomique,
ni de la diaboliser après l’avoir réduite à cette numérisation qui provoque
chez le littéraire un frisson d’horreur. L’informatique n’est pas,
répétons-le, bonne ou mauvaise par elle-même ; tout comme le marteau qui peut
aussi bien servir à planter un clou qu’à assassiner, elle fera ce qu’on lui
demande.
Comme elle est puissante, comme elle
transforme le monde dans lequel nous vivons – car, au-delà de l’entreprise sur
laquelle nous nous sommes focalisés ici, elle pénètre avec l’Internet et le
téléphone mobile notre vie quotidienne ainsi que celle de nos enfants – il
importe de la comprendre pour pouvoir la maîtriser et la mettre au
service des valeurs que nous entendons promouvoir.
Cela demande travail et minutie, temps et
patience : l’apprentissage d’un langage de programmation demande autant
d’effort que celui d’une langue étrangère et il faut puiser dans l’arsenal de
la philosophie si l’on veut comprendre les SI. Mais que les clercs prennent
garde, quelle que soit leur fierté professionnelle, à ne pas se comporter
comme ces théologiens qui ont
refusé de regarder dans la lunette astronomique que leur
tendait Galilée : cela ne pouvait rien leur apprendre, pensaient-ils, puisque
tout est déjà dans Aristote et saint Thomas.
D’après Eurostat, ce taux était en 2003 de 75,4 % en Grande-Bretagne et de
74,9 % en Suède alors qu’il était de 70,3 % en France – qui, à cet égard,
se trouve donc dans la moyenne des pays européens.
Gilles Pison
et Nadine Belloc, « La population mondiale...et moi? »,
Population & Sociétés
mai 2005.
Gilles Pison,
« France, 2004 : l’espérance de vie franchit le seuil de 80 ans »,
Population & Sociétés, mars
2005.
« The
theologians who declined, when invited, to look through Galileo’s
telescope, were certainly scholastics and therefore already, as they
thought, in possession of sufficient knowledge about the material
universe. If Galileo’s findings agreed with Aristotle and St Thomas there
was no point in looking through a telescope; if they did not they must be
wrong » (Joseph
Needham,
Science and Civilisation in China,
Cambridge
University Press 1962,
vol.
2 p. 90).