|
J’avais prévu que
John Kerry
gagnerait les élections présidentielles américaines de 2004. Si le résultat m’a
donné tort l’évolution ultérieure de l’opinion
des Américains a confirmé la tendance que j'avais repérée : à quelques mois près George W.
Bush n’aurait pas été réélu.
De même, le mouvement d’opinion qui se
dessine en faveur de François Bayrou annonce peut-être une prise de conscience
nécessaire.
* *
Il est utile, pour évaluer les enjeux de
l’élection présidentielle, de la situer sur la toile de fond de l’histoire
économique. Celle-ci comporte dans notre pays des éléments que l’on retrouve,
mutatis mutandis, dans les autres pays riches.
Elle a été marquée par une
rupture qui s’est produite en 1975 et que la statistique fait ressortir
clairement : jusqu’à cette date, la part de l'industrie dans l’emploi
avait crû. Après cette date, elle a continûment et fortement décru. La cassure qu'on
lit sur le graphique ci-dessous est d'une netteté que l'on voit rarement dans
les données macroéconomiques :
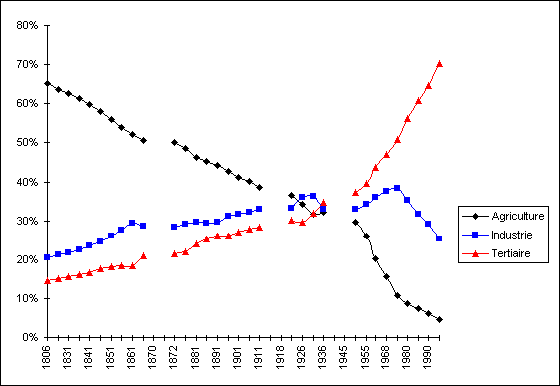
Nos économies, et avec elles nos sociétés,
sont en effet entrées alors dans une ère nouvelle. Elles avaient été tirées depuis le
XVIIIe siècle par l’industrialisation, terme qui désigne la
mécanisation et la chimisation de la production. En 1975 le moteur a changé :
l’informatisation a pris le relais de l'industrialisation, la microélectronique et le logiciel sont
devenues les technologies fondamentales en lieu et place de la mécanique et de
la chimie.
Cela n’implique pas que la production
industrielle ait reculé : elle n’a fait que croître. Mais la fonction de
production n'est plus la même, d’où entre autres phénomènes le changement de
la structure de l’emploi : à l'alliage
« homme-machine » a succédé l'alliage « homme-automate».
Les produits eux aussi ne sont plus
les mêmes. Dans l’économie industrielle, le bien-être
matériel résultait de la production et de la distribution massives de biens
standardisés dont le coût de production diminuait. Dans l’économie quaternaire,
celle qui se met en place depuis 1975, le bien-être résulte de la
diversification des produits en vue de leur adaptation qualitative aux besoins
des divers segments de clientèle ; en outre, les produits sont composés d’un alliage de biens et de
services.
J’ai décrit les grandes lignes de l’économie
quaternaire dans e-conomie, puis
j’ai fait un zoom sur l’informatisation dans
De l’Informatique. Je ne paraphraserai pas ici ces
ouvrages (ils sont accessibles sur ce site en texte intégral), mais je voudrais
exposer des résultats de cette recherche qui éclairent, me semble-t-il, la prochaine élection.
* *
L’industrialisation a fait craquer le cadre
institutionnel de l’ancien régime et suscité la révolution française.
Puis l’agriculture s’est industrialisée, les villes se sont développées, la classe
ouvrière est née. La distribution de la richesse ainsi créée a été l’enjeu de
la lutte des classes. Les syndicats, la gauche, ont défendu puis promu la
classe la plus démunie tandis que la coupure révolutionnaire suscitait une
réaction qui a structuré la droite.
L’économie agricole, soumise aux aléas du
climat et à la volatilité des cours, avait ancré dans les mentalités une
prudence habituelle : il fallait « mettre de l'argent de côté », épargner pour
se prémunir contre les aléas. Mais cette habitude ne correspondait pas aux
besoins de l'économie industrielle, qui est moins aléatoire que l'économie
agricole. La crise des années 30 a été causée par un excès d’épargne
qui étouffait la demande en même temps que la production et l’investissement :
il faudra l’après-guerre pour que les consommateurs, comme les entreprises,
« réalisent » enfin le potentiel de l’économie industrielle et lui
adaptent leurs comportements.
Les luttes sociales, la leçon des
événements, les réponses aux urgences ont par ailleurs modelé autour de cette
économie la structure institutionnelle (sanitaire, financière, juridique, culturelle, médiatique) qui
lui était adaptée.
* *
A partir de 1975, l'industrie n'est plus le
moteur de la société : le sol se dérobe sous ces
institutions. Mais le ciment du corporatisme, leur ayant fait perdre leur mission de
vue, les empêche de la redéfinir. Corsetées par leurs habitudes, elles se
fissurent debout.
Ainsi le débat entre gauche et droite,
expression des enjeux de l’économie industrielle, a perdu son contenu. Il ne
reflète plus qu’un conflit entre équipes semblables rivalisant pour le
pouvoir et dans lequel chacun s'exprime selon un vocabulaire convenu. Des intrigants se sont d’ailleurs glissés parmi les militants, puis
faufilés aux premières places pour parler en leur nom.
Certes, on trouve parmi les politiques des
personnes dévouées à leur mission et qui connaissent bien le fonctionnement des
institutions. Mais l'informatisation, étant moins spectaculaire que
l'industrialisation (un système d'information n'a pas la même évidence physique
qu'une usine), n'a pas encore attiré leur attention. Comme elles n’ont pas perçu
la nature, les enjeux de l’économie quaternaire, elles partagent le « désarroi »
des Français
et sont incapables de leur proposer une orientation constructive.
Le débat politique, stérilisé par une
dispute rituelle, tire alors bassement sur les ressorts de l’émotion : chacune
des catégories défavorisées fait l’objet d’un discours compassionnel cousu de
fil blanc. La plupart des « mesures » annoncées sont autant de cadeaux à l’une ou l’autre,
supposée prostituer son vote au plus offrant. D’autres « mesures » sont démagogiques (les 35 heures, l’ISF).
Les franges du politique,
enfin, cultivent des fantasmes (l’insécurité, la peur du nucléaire, la
décroissance etc.).
* *
Pas plus que ne l’était l’économie
industrielle, l’économie quaternaire n’est intrinsèquement bonne,
intrinsèquement conforme aux
exigences de la nature comme de l’humanité. Les possibilités qu’elle offre, les risques qu’elle
comporte sont donc autant d’enjeux d’une lutte nécessaire, mais il s’agit d’une
lutte nouvelle pour des enjeux nouveaux. Plutôt que des « mesures » et des
« programmes », le citoyen semble réclamer – certes confusément,
mais intelligemment peut-être – que ces enjeux soient éclairés afin qu'il puisse
promouvoir les orientations auxquelles il adhère.
Si l'on prend au sérieux l’économie quaternaire,
on voit se dessiner l’équilibre qui la rendra efficace : le
consommateur, sobre et exigeant, réclame de la qualité plus que de la
quantité ; les entreprises offrent des alliages diversifiés de biens et de
services, finement adaptés aux besoins ; le commerce s’organise en intermédiations.
Si la société « réalise » les possibilités
que cette économie lui présente, le marché du travail s’équilibre (la production de
services de qualité exige de nombreux emplois, y compris dans les services
publics), la sobriété favorise le respect de l’environnement, la mission
d’institutions aujourd’hui en crise est restaurée (système éducatif, système
judiciaire, système de santé etc.), l’Europe elle-même prend enfin son sens.
Mais nous sommes loin d’une telle
« réalisation ». La plupart des consommateurs, encouragés par la publicité, sont
encore à la recherche non de la qualité mais du prix le plus bas. La plupart des
entreprises s’automatisent non pour offrir les services que devraient comporter leurs produits, mais pour comprimer encore et
encore les effectifs. Ni la fiscalité, ni le droit du travail, ni plus
généralement l'appareil des lois ne sont adaptés à l'économie quaternaire. Les services publics eux-mêmes se sont lancés, sous
prétexte d’« économie », dans la baisse de la qualité.
Il en résulte un blocage selon un équilibre
aussi pervers, ou un déséquilibre, que celui que Keynes a diagnostiqué dans les années 30. Pour
que l’équilibre soit efficace il faut que l’offre et la demande, tirant toutes deux
parti des possibilités nouvelles, se soutiennent mutuellement comme les deux
moitiés d’une voûte. Or pour construire une voûte il faut un cintre, en
l’occurrence une incitation et un soutien politiques : si une moitié de voûte se
met en place avant l’autre sans être étayée, elle s’effondre.
* *
Il faut percevoir aussi les dangers que
comporte l’économie quaternaire. Cette économie, la plus productive qui
ait jamais existé, est l’économie du risque maximum (voir
e-conomie, chapitre 15).
Elle suscite à la fois la mondialisation et une concurrence d’une extrême
violence. On y voit ressurgir les formes archaïques de la société féodale. Si une volonté politique lucide ne la pilote pas, elle
peut provoquer un éclatement de la société non plus entre capitalistes et ouvriers
mais entre riches, personnes à l'aise et exclus.
Tout comme l’économie industrielle a
engendré l’impérialisme, le colonialisme, le totalitarisme, l’économie
quaternaire est porteuse de fruits dont certains sont empoisonnés : le « laisser faire laisser
passer » ne peut pas être efficace.
Une orientation politique étant nécessaire,
il faut d’autant mieux percevoir ce qui distingue l’entrepreneur fidèle à sa
mission civique, créateur de structures productives et d’utilité, du
prédateur qui pille les patrimoines et parasite des externalités positives
(voir Noir silence et
Révélation$). L’un comme l’autre
appartiennent à la classe des dirigeants et, tout comme l’escroc sait feindre l’honnêteté, le prédateur maîtrise le langage de
l’entreprise : faire la différence n’est donc pas facile mais dénigrer les
« patrons » en bloc, tentation à laquelle cède souvent la gauche, n’y aide en rien.
* *
Contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy
un président de la République n’a pas pour fonction de gouverner ni de gérer
mais d’orienter et d’arbitrer, action moins quotidienne mais plus profonde. Il ne me paraît donc pas nécessaire qu’il présente
un programme, moins encore une liste de « mesures ».
Mais il importe qu’il ait compris, ou tout
au moins senti, les questions que pose à notre pays l’atterrissage des économies
riches dans le monde de l’informatisation, de l’automatisation, des services, de
la qualité, ainsi que la montée en régime de la prédation.
Je guette, quand les candidats parlent, les
phrases qui expriment cette compréhension ou cette intuition, qui traduisent
aussi une conscience historique de la place de notre pays dans le monde et de
ses alliances naturelles - qui sont d'ailleurs, pour l'essentiel, celles que nos rois avaient déjà
cultivées.
Je n’entends cela, ou ne le sens, que chez
François Bayrou. C’est donc pour lui que je voterai, quitte à rester vigilant
par la suite. Chat échaudé craint l’eau froide et je n’ai pas oublié, chers amis
socialistes, les déceptions qui ont suivi l’élection présidentielle de 1981.
Voir Michèle Debonneuil, L'espoir économique, Bourin 2007.
Ce désarroi fait honte quand on sait que la France est l’un des pays les
plus riches du monde, quand on a vu comment vivent les habitants des pays pauvres.
|